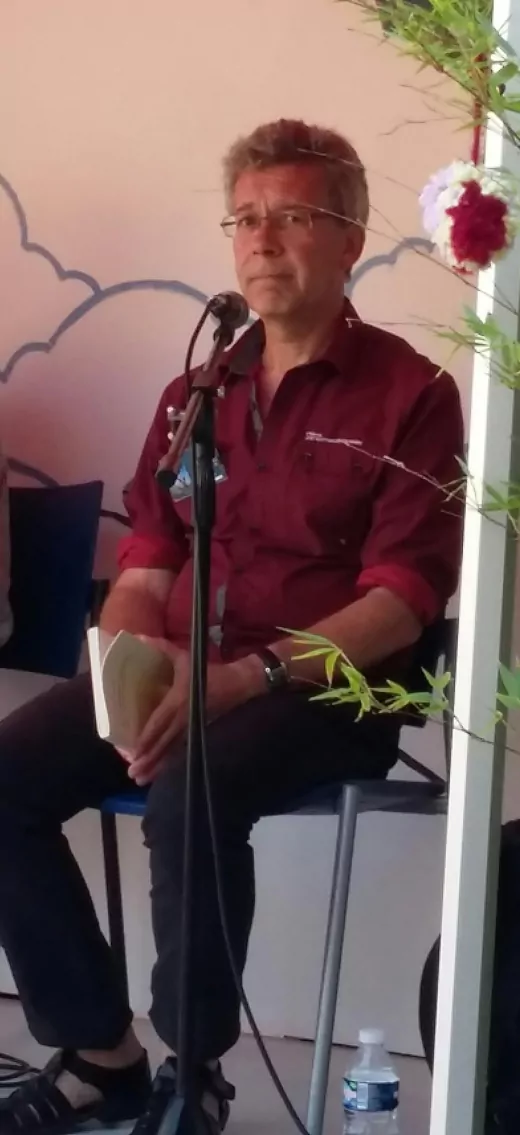Dans les Cévennes, je vais, je tourne sur les routes, les chemins à l’intérieur de l’enceinte fermée de ce paysage ouvert. Comme un puits qui en son fond s’évaserait en fontaine, en estuaire.
C’est comme si je ruminais un secret, je tournais dans tous les sens une énigme, une parole donnée, un message que j’essaierais de traduire avec mes mots à moi, inscrit non pas sur ce parchemin que je tiens dans la main mais dans la vie, sur les chemins réels, sur ces pentes, ces versants, ma propre existence.
Oui, c’est cela, je tourne autour d’un secret. Et je suis sans cesse sur le bord de le découvrir, avec à ma disposition tous ces plans, ces sentiers, ces flèches, ces indications : l’envol de l’épervier, les portes de ces maisons, les fruits des châtaigniers, une phrase de Rimbaud, nous savons à présent donner notre vie tout entière tous les jours…
Les châtaigniers aussi noueux, aussi puissants que des taureaux, se tiennent par les racines sur la pente et soutiennent ainsi, par leurs forces réunies, la montagne debout au-dessus du temps pour qu’elle ne s’écroule pas comme font parfois les maisons dans ce pays bien qu’elles résistent elles aussi à leur manière au désir de se faire poussières.
Ils ont passé jadis un pacte, au temps des guerres de religion, ils ont juré qu’ils tiendraient bon.
Et ils ont tenu, jusqu’ici, même s’il n’y a plus personne pour les protéger, nettoyer autour de leurs racines, recueillir leurs précieux fruits. Plus personne pour croire à la résurrection.
Et si certains, mais partiellement, sont tombés — lourdement, énormément comme tombent les éléphants, d’un coup, un soir d’orage ou, si c’est sous le poids de l’âge, comme sombre un navire, c’est-à-dire incomplètement — toujours ils remontent à la surface. Et c’est alors en tant qu’épaves qu’ils sont là ; ils servent de digues et arrêtent pour un temps encore l’écroulement toujours imminent.
Un bras, un bras puissant, même vieux, même fatigué, en travers du temps. Une longue chaîne continue qui traverse les Cévennes. Et si parfois ils jettent vers les hauteurs leurs barrissements silencieux, l’air triste sous la paupière ridée, c’est avec confiance qu’ils produisent en dehors d’eux comme les signes de leur joie invisible, ces soleils d’épines où nous commençons d’exister, lisses, aveugles et nus, nous les futurs nouveau-nés.
Je les vois, eux,
forçats de la contemplation,
des guetteurs, les derniers guérilleros
d’un combat qui n’intéresse plus personne,
acteurs en proie
au trop ou au trou de mémoire,
leur souffleur là, tout à côté,
qui leur tient les pieds
mais lui aussi a oublié le texte.
Il ne sait plus qu’une chose : cela,
souffler.
Feuilles qui bougent
étendards en guenilles,
seule leur attitude parle,
cette façon d’être debout dans la pente de la montagne
et de regarder devant, face au vide
comme quelqu’un qui attend
et n’éprouve plus aucune honte à attendre.
La promesse qui tacitement nous a été faite un jour lointain de notre enfance, elle est là, enroulée comme un ruban d’ADN avec son message clair dans toutes ces châtaignes, ces millions de soleils verts avec leurs piquants, agités par le vent, dans l’immense châtaignier ouvert que tu vois, en face de toi, au milieu de la pente. Il est au plein cœur de la montagne comme des bras que quelqu’un aurait écartés pour se faire plus grand, plus profond, plus accueillant, pour donner de l’amour, pour tâcher de se faire lui-même vallée, ou montagne, ou même monde, ouvrant tout grands les larges pans de la montagne, et nous, au milieu, notre vie vrillée sur elle-même au milieu des piquants, minuscule hérisson plutôt que soleil, nous voici abrités par la force de ces bras ou de ces branches, sous le couvert des millions de feuilles vernissées comme autant de paupières, attendant patients, rassérénés, notre naissance dans la lumière, certains de devenir arbres à notre tour sur la grande pente des temps.
*
Le vieux châtaignier, gros de tous les enfants qu’il n’a pas eus, auxquels il n’a pas pu donner naissance, et qui ont formé ces bosses, ces nœuds sur son tronc et qui étouffent, de l’intérieur, qui poussent encore, comme asphyxiés par on ne sait quel cordon ombilical trop tendu, ou trop court, qui voudraient tant parvenir à naître, donnant de la tête contre cette histoire qui les retient, n’en fait qu’à sa tête, n’accepte pas d’être plurielle comme le chant polyphonique des gouttes dans la pluie ou les clarines des bêtes quand elles rentrent le soir à la bergerie.
Ce troupeau de brebis noires et de brebis blanches, par exemple, près du gardon de Sainte-Croix. Curieusement, il remontait en direction du cimetière comme si là était la bergerie. Chaque bête avait une cloche accrochée au cou mais aucune de ces cloches n’était accordée dans le même ton. Chacune avait sa tonalité singulière. On aurait dit une avalanche de notes, une vraie cascade, un torrent, une averse sonore, le chant multiplié des aveux, le chœur-torrent de la différence, oui, une seule et même vie diffractée en mille et une gouttelettes tintantes qui remontaient toutes en sens inverse de la pente. Comme si la pluie, d’un coup, avait décidé, rebroussant chemin, de regagner le ciel sans passer par la vapeur.
*
Je marche seul, à pas très lents et très légers sur un sentier du second versant, précautionneusement, retenant mon souffle, ou plutôt suspendu à lui, mon souffle lent, comme font les indiens, sur la pointe des pieds pour ne pas déranger l’ordre de ce paysage bouleversant, à côté plutôt qu’en lui, un peu voyeur, un peu voyant et surtout volontairement très imprévoyant.
Marcher ainsi, dans ce paysage, en silence, avec le pas léger et discontinu, c’est comme suivre une phrase musicale ou prononcer une prière. Oui, c’est murmurer pour soi seul et sans mots une question dont l’espace entier serait la réponse.
Réponse qui ne se donne que si on l’écrit.