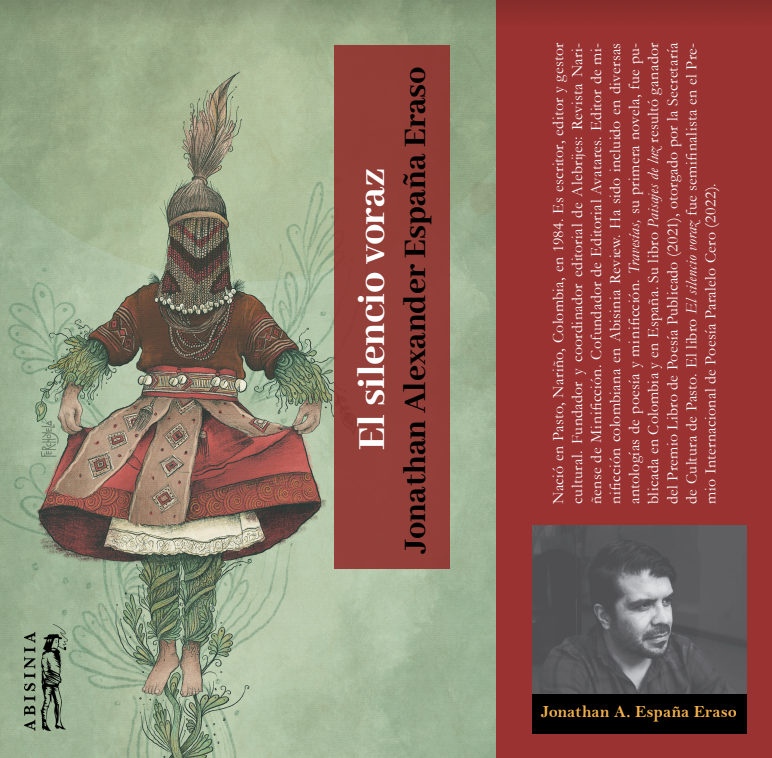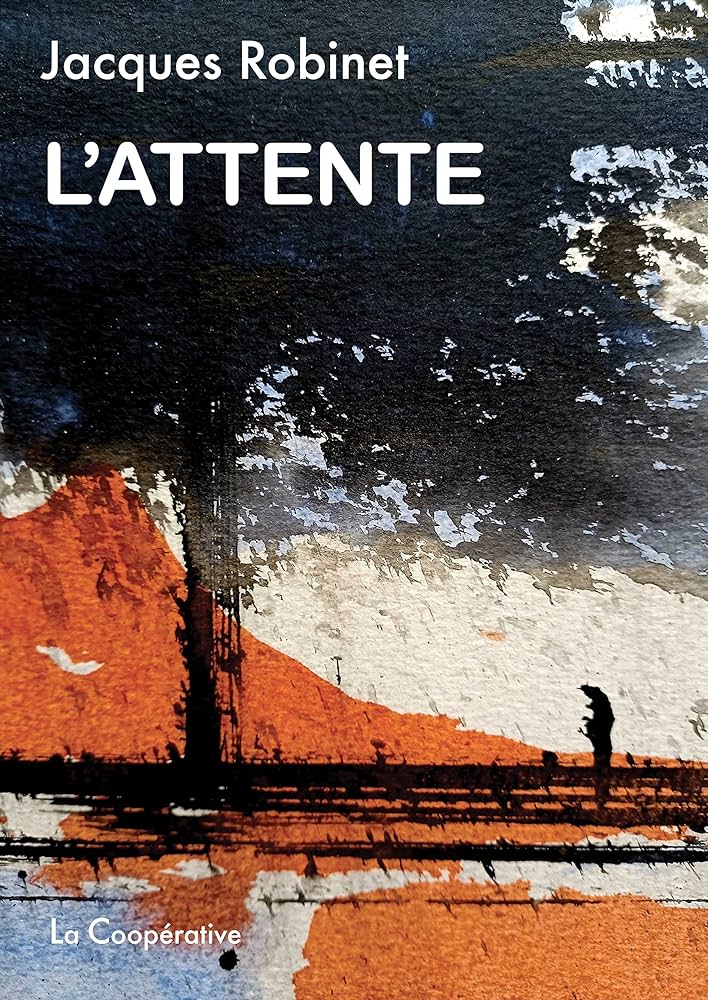Nous vous proposons de découvrir trois poèmes de Tommaso di Dio, extraits de “Tua e di tutti”, précédés de l’avant-propos au recueil, brillamment traduit par Joëlle Gardes, qui en parle ainsi que de son rôle de traductrice.
Ce n’est pas toujours que les poètes sont les bons traducteurs. Il y a là un élément difficile à apprécier qui joue : c’est l’affinité entre le poète traducteur et le poème traduit. Il faut qu’il y ait chez le poète qui traduit, vraiment, le sens de ce type de poème. Sinon, il a triché, comme d’autres. Il ne suffit pas d’être poète pour traduire poétiquement. Il faut encore être le poète de ce type de poème.
Henri Meschonnic
Tommaso Di Dio appartient à la tradition des poètes métaphysiciens, qui considèrent que la poésie est « la perle de la pensée », selon l’expression de Vigny dans « La Maison du berger », et que « toute poétique est une ontologie », comme le rappelait Saint-John Perse à propos de Dante. Ils n’opposent pas la réflexion à l’émotion et réconcilient la raison avec le sentiment. La poésie est pour eux un exercice spirituel, une méditation qui s’élève de l’évocation des petites choses, de l’expérience, dit Tommaso di Dio à une réflexion sur l’Être, même si chez lui le mot ne prend pas de majuscule : « la pensée de l’être / l’être sans nous » (questo essere / l’essere / senza di noi). L’expression est assez claire pour inscrire la méditation sous le signe de la perte, qui est d’abord perte de la langue de l’origine. Le mot « exil » n’est pas employé, mais d’une certaine façon, la conception qui sous-tend ces poèmes est que nous sommes des exilés de l’Être, et le poète plus que tout autre, lui qui a conscience du fossé, de la fêlure, de la cassure qui nous sépare de la matrice, que ce soit celle de la mère, du langage ou du monde. La langue que nous pratiquons est une langue fausse (lingua falsa) qui nous rassure, mais dans les choses vives (le mot cosa est un des mots qui reviennent souvent, pour dire, comme Victor Hugo, l’immensité de la nuit qui nous entoure) palpite la langue de nos ancêtres, celle des Romains, celle de la jeune princesse égyptienne momifiée à la belle bouche lacérée (lacerata bellissima bocca). La poésie doit être anthropologie, archéologie, à la recherche des traces qui pourraient nous permettre de découvrir la source mystérieuse. Qu’il s’agisse de retrouver celles qui mettront sur la piste du mal et du criminel, ou de celles qui permettent de reconstituer l’Histoire, personnelle ou humaine, peu importe, la démarche est la même : « remonter dans les veines les traces » (risalire per le vene le tracce). Comme la pelleteuse qui arrache la terre des murs (la scavatrice che getta la terre dai muri), l’expérience met à nu la « vie dans la vie » (la vita nella vita), la vie qui demeure, la vie réelle, dans sa douloureuse splendeur : « cette / vie réelle enrichie et flétrie par le néant qui ne l’abandonne pas » (questa / vita reale più ricca e sgualcita /dal niente che non l’abbandona). Nul ne détient la clef du mystère, ni nous, ni ceux qui nous ont précédés : dopo o prima, après ou avant, c’est tout un et c’est la même interrogation sans réponse. C’est pourquoi coexistent dans ces poèmes des références à des poètes anciens aussi bien que modernes, ou à des historiens de l’Antiquité tel Tacite, à des épisodes de l’histoire romaine ainsi qu’aux guerres actuelles – l’Afghanistan –, à des faits tragiques – une jeune serveuse assassinée, une fratrie martyre fusillée lors de la seconde guerre mondiale sur une place où aujourd’hui des gamins jouent au ballon –, à des souvenirs de la vie personnelle, l’anniversaire de la mère, la petite dame noire qui tente de se réchauffer, le jeune homme qui distribue les journaux…
Le Je, toujours sous la menace du désordre et de la dissolution trouve une forme d’ancrage dans des paysages ou des lieux intériorisés : la campagne, Milan, avec ses canaux asséchés, ses places, son métro, sa gare, ses rues, et surtout l’appartement face à l’arbre dressé (L’albero che sale), l’arbre qu’il faudrait écrire avec une majuscule, tant il constitue un pilier face à toutes les dérives et les explosions.
Le temps érode les choses, décolore la chaise dans le jardin abandonné. Un des mots qui reviennent tout au long des poèmes est celui d’« effacer », cancellare. Mais sous ce que les saisons, les années, les siècles, ont recouvert de leur patine, la vie elle-même grouille et la lumière qui s’éteint se retrouve (La luce si retrova). C’est pourquoi, en dépit de la nuit, en dépit des bêtes qui pleurent sans larmes, et du monologue auquel nous contraignent les morts, ce n’est pas le pessimisme et le désespoir qui dominent. Le dernier mot du recueil est d’ailleurs celui de « vie » (vita). La présence recherchée à travers la multiplicité de l’expérience existe bel et bien, dans l’écorce de l’arbre, dans le visage de l’autre, dans sa peau qui respire sous les doigts…
Car la poésie de Tommaso di Dio, pour être philosophique, est tout sauf abstraite. Une grande sensualité la parcourt, comme lorsque le contact avec la langue morte est décrit dans des termes qui évoquent une pénétration sexuelle :
laisse moi y enfoncer
pétrissant reins cuisses et poitrine un poing
de joie terrestre
che io vi spinga
battendo reni cosce e petto un pugno
di gioia terrena
Notre époque est « sans remède » (senza rimedio), dit le même poème, mais les hommes qui dorment pour l’éternité dans les prés sont grands, comme Crastinus, comme Germanicus et il nous suffit de fermer les yeux pour éprouver « l’immense grandeur / des choses accomplies » (l’immensa grandezza / delle cose compiute).
Le Je peut se sentir écrasé, effacé par le passé de l’humanité, fracturé, à distance de soi, des autres, du monde – « Cet espace / entre eux et moi entre moi au-dedans de moi » (Quello spazio /fra loro e me fra me dentro di me) –, il lui est malgré tout possible de conquérir une identité dans l’expérience, dans l’humilité des tâches recommencées : « Je marche j’avance. J’agis je parle » (Cammino avanzo. Opero parlo). Ou encore : « Maintenant / je m’arrête. Là où je suis. Je recommence » (Adesso / mi fermo Dove sono. Ricomincio). Nous recommençons et la vie aussi recommence. Nous n’avons d’autre but que la recherche elle-même, à travers des tâches humbles et fondamentales, dont la plus essentielle est précisément de toujours chercher.
Une tension parcourt ainsi le recueil, entre le cri et l’apaisement, entre la révolte et l’acquiescement final. Elle se lit dans l’écriture elle-même, parfois simple, ordinaire, parfois travaillée dans le jeu des ellipses qui effacent les verbes, les articles, et le vers libre qui peut couler tranquillement projette souvent un mot ou un groupe dans des enjambements violents. La ponctuation désoriente, en particulier quand elle supprime tout point d’interrogation, faisant des nombreuses questions des sortes d’appels sans réponse possible.
Autant de défis auxquels la traduction, que j’aurais voulu fidèle au mot près, a dû se confronter. Même si l’italien et le français sont des langues voisines, il m’a fallu me résoudre à quelques transpositions, à quelques modifications, en particulier quand l’ordre des mots était en jeu. J’ai alors parfois sacrifié la mise en relief d’un terme à l’ordre rigide du français qui n’a pas la souplesse de l’italien. J’ai dû aussi souvent me plier au rythme du français, lié à un accent de groupe syntaxique, alors que l’italien a un accent de mot. J’espère toutefois n’avoir pas trahi l’essentiel de ces poèmes, même si je ne saurais avoir la prétention d’avoir été « le poète de ce type de poème ».
Présentation de la traductrice
Tommaso di Dio, extraits de Tua e di tutti, (la Tienne et à tous)
Traduction de Joëlle Gardes
Quella parte di silenzio
che ci copre il viso. Il parco
aperto e nero in fondo alla strada in fondo alla strada
in fondo alla cosa che fai. Sul tuo viso
c’è qualcuno che smette, all’istante
rompe un vetro, cade
un cielo addosso alle pareti e tutto
è tempo ferito, limpido
alone fra i capelli, il vestito. Come taglia
questa luce nell’erba e lascia
soli nel dialogo.
La città che splende. La notte.
Il vuoto le strade. Gli angoli scavalcati
dal fiato corto le poche
donne sui marciapiedi e sembra tutto catrame
questo tempo, senza rimedio
senza soccorso. Ma poi alti
sono gli uomini che dormono sui prati
e le pietre delle fontane, slabbrate
sono piene di muschi foglie ombre ed è notte però
il vuoto, le strade. Lingua morta
che nelle cose vive alberghi e lasci
la tua crepa come uno stigma; fa’ che io possa
mettere la testa tutta dentro
che io vi spinga battendo reni cosce e petto un pugno
di gioia terrena.
La testa che ora
vi si immerge; nell’immagine tu sei
cameriera di ventuno al bancone del bar.
Occhi azzurri occhi bianchi. Una mascella fuori
posto ormai. Ma se poi noi
indietro risaliamo ogni scalino, dopo l’androne
la strada. Ma se cancelliamo la serranda
la macchina il tuo minuto e l’alba
della cronaca. La vita cosa è
che rimani così, immeritata
negli sguardi che hai dato a me
sconosciuto fra tanti. Sono i morti che ci rendono
al monologo; all’impossibile
storia del vero.
Cette part de silence
qui nous couvre le visage. Le parc
ouvert et noir au fond de la rue
au fond de ce que tu fais. Sur ton visage
il y a quelqu’un qui s’arrête, à l’instant
brise une vitre, contre les murs
un ciel tombe et tout
devient temps blessé, limpide
halo entre les cheveux, le vêtement. Comme tranche
dans l’herbe cette lumière qui laisse
seuls dans le dialogue
L’éclat de la ville. La nuit.
Le vide les rues. Les tournants enjambés
le souffle court les rares
femmes sur les trottoirs et elle semble toute de bitume
cette époque, sans remède
sans secours. Mais grands
sont les hommes qui dorment dans les prés
et les pierres des fontaines, ébréchées
sont pleines de mousses de feuilles d’ombres et pourtant c’est la nuit
le vide, les rues. Langue morte
qui résides dans les choses vivantes et abandonnes
ta fêlure comme un stigmate ; laisse moi
y mettre la tête entière
laisse moi y enfoncer en pétrissant reins cuisses et poitrine un poing
de joie terrestre.
La tête qui maintenant
s’y plonge ; sur l’image tu es
une serveuse de vingt et un ans au comptoir du bar.
Yeux bleus yeux blancs. Une mâchoire
déplacée désormais. Mais si nous
remontons chaque marche, après le couloir
la rue. Mais si nous supprimons la serrure
la voiture la minute décisive et l’aube
de la chronique. La vie c’est quoi
pour que tu demeures ainsi, imméritée
dans les regards que tu m’as adressés
moi un inconnu parmi tant d’autres. Ce sont les morts qui nous rendent
au monologue ; à l’impossible
histoire du vrai.
Ces poèmes sont extraits du recueil Tua e di Tutti, La Tienne et à tous,
désormais introuvable, publié en juillet 2015 par Recours au Poème éditeurs.