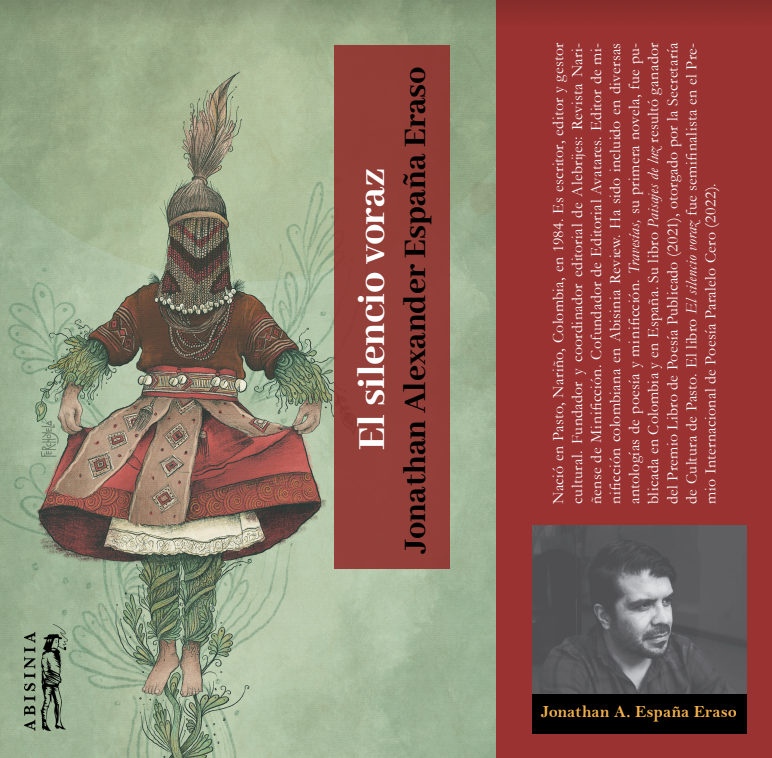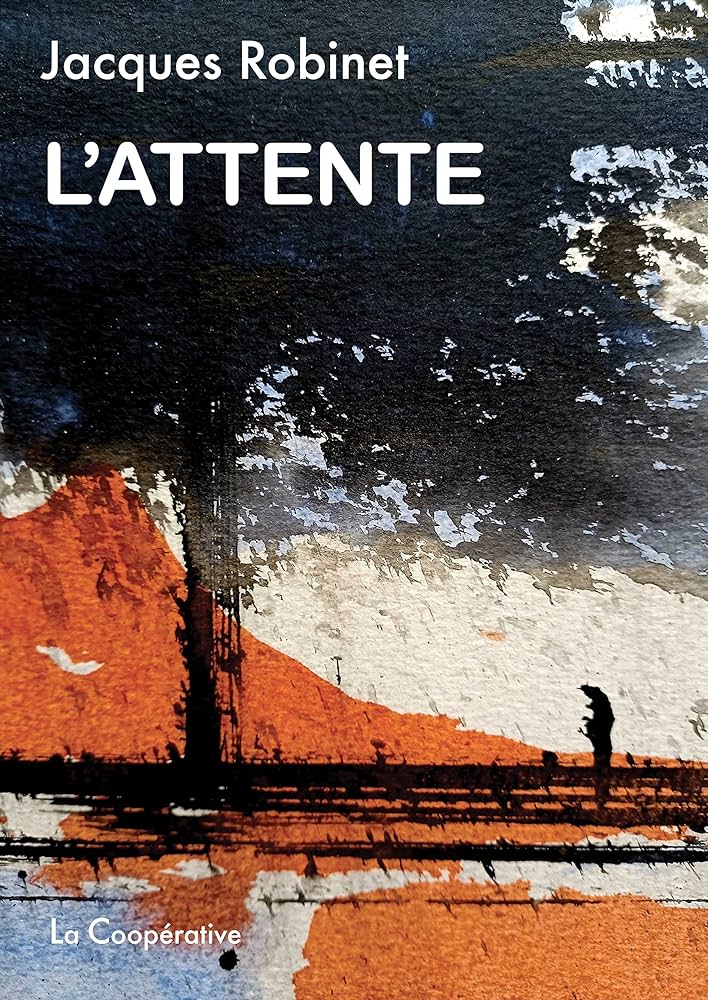A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, Radio France a proposé un concert fiction ressuscitant l’œuvre de Vladimir Maïakovski (1893–1930). André Markowicz, poète et traducteur français, est à l’origine du choix des textes et le traducteur d’un choix de poèmes complétant cet ensemble (Le porte-cigare, Pour le jubilé, Philosophie de surface en lieux profonds, Alexandre Blok est mort, À pleine voix, Derniers vers.)
Il a autorisé Recours au Poème à publier une partie du journal qu’il tient presque quotidiennement sur la page facebook, où il fait partager à ses lecteurs sa réflexion très personnelle sur cet exercice périlleux Il y parle de sa conception de la traduction, et de Maïakovski.
La traduction est gageure est d’autant plus grande lorsqu’il s’agit de poésie. En effet, le langage n’y est plus employé dans son usage pragmatique. Il est soumis à des distorsions, grâce à des dispositifs syntaxiques et lexicaux particuliers. Cette difficulté à rendre compte de l’implicite, porté par le langage poétique, bien souvent allégé de sa dimension référentielle, se double ici de la complexité de la langue traduite. En effet, le russe, langue flexionnelle, propose une multitude de possibilités pour certaines occurrences. Ainsi, cette question du passage d’une langue à l’autre demande des adaptations et une lecture bien plus globale de l’œuvre.
Dans cette démonstration magistrale, André Markowicz nous propose de le suivre dans ce travail, mené pas à pas, à partir de quelques vers de « Ça va ! ». Il nous fait part des subtilités de la langue, et des possibilités envisagées pour rendre compte d’un texte qu’il n’aborde qu’à partir de la globalité de son contexte de production, lequel a, bien entendu, motivé les propos de Vladimir Maïakovski. C’est cette problématique de la traduction qu’aborde également Caroline Regnaut dans l’article que nous proposons également dans ce numéro : elle y rend compte du travail qui a donné lieu à son livre, Ressusciter Maïakovski : quelle doit être la posture du traducteur, et comment restituer une œuvre à partir des faits de langue. Car, au-delà de la personnalité de ce poète, qui, grâce à des dispositifs particuliers, revisite la posture de l’écrivain et ouvre la voie à une modernité poétique, il y a le texte, à considérer dans sa dimension autotélique. (La Rédaction)
* * *
Maïakovski. Révolution. Suicide.
Je répète à la Maison de la Radio, pour un concert lecture, ou comment ça s’appelle? — le 16 septembre. Disons, réellement, une création musicale de Jonathan Bepler à partir de poèmes de Maïakosvki, avec l’Orchestre philarmonique de Radio France et Denis Lavant, dans une réalisation de Christophe Hocké. Il s’agit, à l’occasion du centenaire d’Octobre 1917, d’évoquer la figure de son poète majeur. Le titre vient de son poème qui, en russe, s’appelle, « Horocho », ce qui veut dire « C’est bien », et pas tellement « Ça va », comme l’a traduit Christian David chez Poésie/Gallimard. Mais bon, ce n’est pas grave. Le fait est que ce mot, « C’est bien », est le titre d’une épopée de Maïakovski écrite pour les dix ans de ce qui était censé être l’épopée bolchévique. Et « C’est bien », c’est un mot d’Alexandre Blok dont Maïakovski rapporte qu’il lui avait dit ça, à propos de la Révolution, et qu’il avait ajouté : « Vous savez, ils m’ont brûlé ma bibliothèque à la campagne ». J’ai publié cet article que Maïakovski a écrit à la mort de Blok le 13 avril 2017.
Et Maïakovski, les bibliothèques brûlées, ce n’est pas ça qui l’effrayait.
Oui, il est monstrueux, Maïakovski. Et quand je lis ses poèmes écrits à la fin des années vingt, la plupart du temps, je suis saisi d’effroi : et pas seulement parce que cette « poésie engagée » est d’une pauvreté affligeante, déclarative, linéaire, un hymne à la violence, qu’elle est un hymne, répétitif, à la terreur, en fait. J’en parle dans les deux interventions que je fais pendant le concert, mais, ce que je voudrais aujourd’hui, c’est essayer de vous faire ressentir l’ampleur de la catastrophe, non pas en citant ces vers terribles de l’année 1927, qui sont écrits dans une syntaxe linéaire, et qui ne font que dire « C’est bien », alors que tout le monde le sait, dès le moment où il l’écrit, que ce n’est pas bien du tout ; que c’est la fin de la NEP, c’est-à-dire de la dernière tentative de libéraliser la vie économique, et que, ce qui s’avance, c’est quelque chose de réellement épouvantable : l’annihilation de la campagne, que Maïakovski chantera, là encore. Non, ce qui fait peur, c’est de comparer ce que Maïakovski était en 1917 et ce qu’il était devenu en 1927.
Aujourd’hui, je voudrais essayer de vous faire sentir comment Maïakovski a pu vouloir se lancer dans la Révolution, comment il a pu essayer de la comprendre comme un déluge salvateur, pour tout recommencer, tout reconstruire. Comment, en 1917, il démolit et reconstruit la langue. Et comment tout ce qu’il a fait est génial, à la fois tragique et joyeux.
*
En 1917, il écrit un long poème lyrique, « Tchélovek », « L’homme », ou « Un homme », puisque le russe ne connaît pas l’article. C’est la naissance, la vie, la mort, l’ascension et la redescente d’un homme-dieu, d’un géant qui dit « je », Maïakovski, devenu tous les hommes, Fils de l’Homme. Un homme qui, dans toute la première partie de son œuvre, est poursuivi par une seule obsession : le suicide. Et voici comment il décrit son face à face avec sa bien-aimée. En russe, ça donne ça. Je vous donne juste un quatrain.
« Глазами взвила ввысь стрелу. Улыбку убери твою! А сердце рвется к выстрелу, а горло бредит бритвою. »
La transcription :
« GlaZAmi VZVIla VVYS’ strélou. OuLYBkou oubéRI tvaïou ! a SERDsté RVIOTsia k VYStrélou, a GORla BRÉdit BRITvaïou ! »
Dans cette strophe, tout est impossible : GlaZAmi VZVIla VVYS’ strélou. GlaZAmi — par les yeux, avec les yeux VZVIla — [le mot ne semble pas exister sous cette forme, mais on comprend qu’il signifie quelque chose comme « bander vers le haut », lancer, conjugué à la troisième personne du féminin singulier, — mais le « elle » n’est pas dit. Et essayez de le prononcer, ce vers : « VZVIT’ ». Il existe une autre forme : « VZVESTI », qu’on peut employer, par exemple, pour le chien d’un pistole ancien, qu’on arme — qu’on soulève avant d’appuyer sur la gâchette. Le verbe russe, tel qu’il est employé par Maïakovski, donne l’idée de quelque chose qui est lancé, vibrant, à toute vitesse. — Essayez de prononcer le mot « VZVIla » et, à sa suite, « VVYS », qui signifie vers le faut. Et dans cette accumulation imprononçable en russe de v, de z et de i, vous avez déjà la poétique de Maïakovski. Une concentration des impossibles. « strélou », c’est l’accusatif de « stréla », qui signifie une « flèche ».
Et donc, ce vers signifie « Des yeux [elle] lance vers le haut une flèche. (ou : elle arme ? une flèche.) » — Mais vous comprenez bien que si je traduis ça comme ça, je fais, en respectant le sens des mots, un contresens. Parce que rien n’est laissé à la dénotation, même si, bien sûr, ça part du lieu commun de la flèche de cupidon, ou de l’éclair que pourrait lancer le regard de la bien-aimé irritée. Et, autre chose, pour compliquer encore : vous avez remarqué que je ne mets aucune majuscule au mot « strélou » (la flèche), c’est-à-dire que je ne marque aucun accent tonique ? Evidemment qu’il y a un accent tonique en russe sur ce mot, et c’est « stréLA, stréLOU (accusatif) ».
*
« OuLYBkou oubéRI tvaïou ! OuLYBkou » — sourire (à l’accusatif) oubéRI — enlève (impératif) tvaïou — tien. Enlève ton sourire ! — Mais personne, jamais personne ne peut dire ça en russe. Non seulement « enlève » ton sourire, mais « sourire enlève tien », dans cet ordre là — et pourtant l’ordre des mots, grâce à la déclinaison, est beaucoup plus libre en russe qu’en français. Il est libre, mais pas à ce point. Qu’on me comprenne : il n’y a pas de faute de grammaire, non — c’est juste que c’est hors de tous les codes. Et écoutez les sons : OU — Y (ce son guttural, Ы, dont Maïakovski dit qu’il est à lui tout seul le futurisme, par sa violence et sa laideur) — OULYB — OUBRI, où le « l » et « r » sont en saisis en miroir.
*
« SERDsté RVIOTsia k VYStrélou », a — mais, et/ alors que.. SERDsté — le cœur RVIOTsia — se déchire. Non, ce n’est pas qu’il se déchire : ou, si, il se déchire (c’est le premier sens du mot), mais, ici, c’est « se déchirer en désirant se précipiter vers » (oui, tout ça). Et vers quoi se veut se précipiter le cœur ? k — vers VYStrélou — le coup de feu
Le cœur [rêve de se précipiter] vers le coup de feu. — Déjà l’image est saisissante. Mais ça ne suffit pas. Est-ce que vous avez remarqué la rime ? — « VZVIla VVYS’ strélou » — « RVIOTsia k VYStrélou » ? — Ce n’est pas une rime, c’est un quasiment un calembour, mais tragique : une rime qui repose entière sur la force de l’accent tonique, c’est-à-dire qu’elle porte en elle-même la violence de l’accentuation, et le choc de la flèche qui se fige et qui vibre sur encore deux autres syllabes similaires et non accentuées (strélou)… Ça va ?…
Et le quatrième vers :
« a GORla BRÉdit BRITvaïou ! »
« a GORla » — et/ mais la gorge « BRÉdit » — délire (du verbe délirer) « BRITvaïou » — du rasoir. La gorge délire du/par le rasoir. — Elle veut tellement le rasoir qu’elle en délire. Mais, là encore, évidemment, tout ne tient que sur le son — « BREDT » — « BRITV »… et là, encore, la rime laisse pantois :
« OuLYBkou oubéRI tvaïou ! a GORla BRÉdit BRITvaïou ! »
Comme si, dans l’impératif singulier du verbe « enlève » (oubéRI) suivi du possessif (tvaïaou), il y avait le rasoir. Par la force de l’accent tonique russe. Et encore un détail, qu’il faut vraiment pouvoir sentir : la forme « BRITvaïou » est une forme longue, littéraire de de la déclinaison à l’instrumental du substantif « BRITva » (le rasoir). Dans la langue courante, on ne dirait jamais ça : on dirait « BRITVaï ». C’est, à ma connaissance, ici, dans ce quatrain, le seul cas d’emploi d’une forme littéraire, noble, pour un objet aussi banal qu’un rasoir. Comme si le rasoir devenait un objet, je ne sais pas, métaphysique.
Et comme si tout dans cette strophe, où ça va si vite, où ça ne parle que d’une seconde où la bien-aimée lance un regard vers « l’homme », tout, en même temps, devenait d’une lenteur invraisemblable. Et ça encore, c’est entièrement nouveau. Tout, là, est révolutionnaire. Il s’agit ni plus ni moins d’une nouvelle langue russe, et d’une nouvelle façon de percevoir le monde par la langue. Comme si les mots étaient réduits à des éléments bruts, à la fois fixes et en mouvantes les uns par rapport aux autres — comme, je ne sais pas, Braque ou Picasso qui décomposent le mouvement.
C’est ce renouvellement, cette violence tragique et, à la fois, grotesque et, joyeuse, oui — puisque toujours à la limite du calembour, et tellement joyeuse par l’énergie qu’elle dégage quand vous arrivez à le dire, et par la vitesse de la pensée, — joyeuse, donc, vraiment, même ça ne parle que du désir de suicide— c’est tout cela que Maïakovski a pressenti dans le déluge qui a déferlé en octobre 1917 : un monde retourné, à reprendre entièrement, à reconstruire bloc par bloc, pierre à pierre, syllabe à syllabe, pour le faire sonner à neuf.
Le problème est qu’Octobre 1917, ça n’a pas été ça. — Et Maïakovski, en mars 1930, ayant perdu cette jeunesse de la langue et de plus en plus acculé par le pouvoir de Staline, n’avait réellement que l’issue de la balle pour mettre, comme il disait, un point final à sa vie.
*
Présentation de l’auteur
- Maïakovski. Révolution. Suicide. - 6 juillet 2019