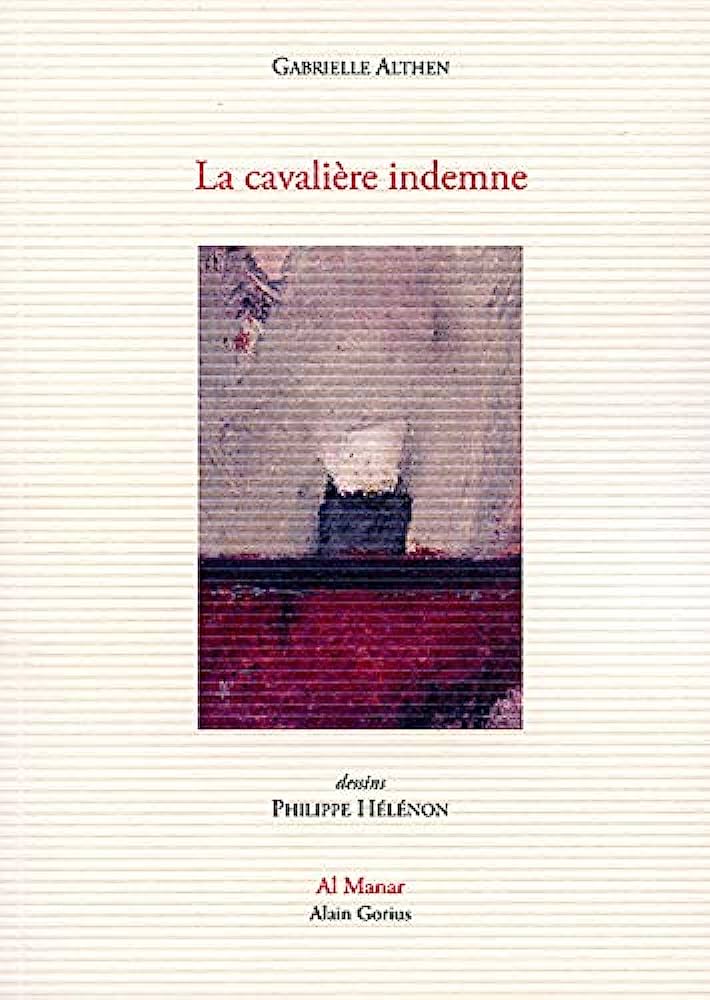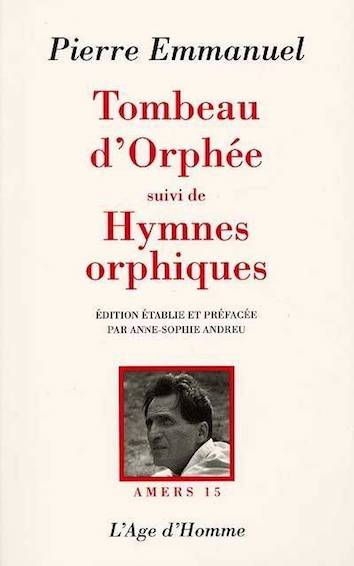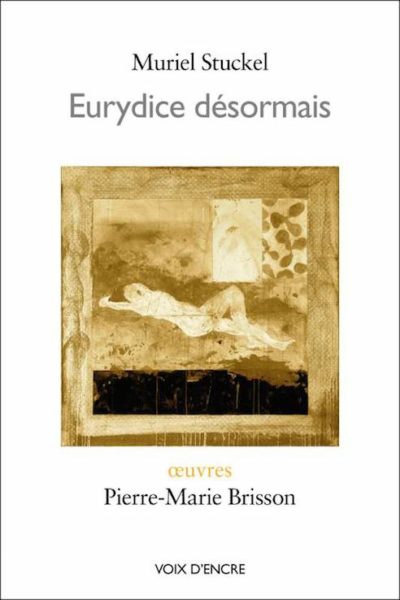Ricordi, de Christophe Grossi, est un livre dans lequel s’encastrent l’Italie et la Shoah. Répétée comme un mantra 480 fois dans le livre (le même nombre que pour Je me souviens, de Georges Perec), la formule « Mi ricordo », « je me souviens » (que l’on peut aussi traduire par « mon souvenir ») relie le texte de Grossi à celui de Perec : la mémoire et ses enjeux se placent comme moteurs de l’écriture ici. Dans la constellation d’entrées de ce labyrinthe, Grossi part sur les traces de l’Anton Voyl en lui, celui qui n’est pas là. On ne peut s’empêcher de penser également à Primo Levi en lisant ces 480 « souvenirs » qui touchent à des thèmes aussi importants que la parole, l’oubli, la guerre, les langues, les relations hommes-femmes, l’écriture, la fiction, la mémoire, les origines, le mensonge, la famille, l’héritage, la résistance, la mort, la survie, la folie, la vérité. « Nous pataugeons dans le meurtre », a dit Hélène Cixous pour parler de l’écriture de l’indicible : écrire ce qu’il ne faut pas dire.
257. Mi ricordo
ne veut pas dire je me souviens mais je voudrais
ne plus oublier ou j’imagine des souvenirs ou tais-
toi : écris plutôt !
On pense aussi aux prescriptions de la Torah (les commandements) : chaque entrée de Ricordi est une phrase, et les phrases sont des mishpatim en hébreu – mishpat est le terme hébraïque pour désigner la « phrase », mais aussi la loi, et mishpatim en est le pluriel. Les Mishpatim sont également une portion de la Torah, la sixième partie du « Livre des noms », Sefer Shemot : l’Exode. Ricordi n’est pas un recueil de préceptes, son auteur cherche moins à enseigner qu’à renseigner, et à éclairer les zones d’ombre de son histoire.
310. Mi ricordo
de ceux qui ont francisé leur nom ou leur
prénom, qui ont fait souche ailleurs qu’en
Italie.
Lui c’est il, peut-être franco-italien, un homme entre rires et pleurs, dont la voix prononce une sorte de manifeste dans lequel se déploient et se déboîtent, dans une cascade de phrases se faisant écho, ses positions par rapport aux devoirs d’écriture et de mémoire. Sa voix est claire et directe malgré, ou sans doute grâce à, ces masques de tragédie qu’il arbore, dessinés par le peintre Daniel Schlier pour Ricordi : des masques frappants, inquiets et inquiétants, bouches ouvertes qui cherchent à dire, traits délimitant l’ossature d’une géographie intime ébranlée par la Shoah. On y voit même une Italie icaresque, renversée, tête en bas. Dans le dernier dessin se détache un profil, menton posé sur un cadre au sein duquel sont écrits, en caractères hébraïques, les mots « shdérote hasside oumote ha’olame », boulevard ou allée des Justes parmi les nations, mots que l’on peut lire sur une stèle au Mémorial Yad Vashem, à Jérusalem, plaque qui a inauguré l’allée où sont plantés des arbres portant le nom de ces personnes courageuses qui ont sauvé des Juifs durant la Seconde guerre mondiale.
416. Mi ricordo
qu’il respirait, mangeait et parlait comme un
rescapé qu’il n’était pourtant pas.
Lui, il implore en fait d’oublier l’Histoire de l’Europe pour mieux se souvenir des histoires minuscules et communes, celles des Justes, mais aussi celles de couples, de femmes et d’hommes fragiles, de leurs familles et de leurs « Langhe maternelles » (ricordo #3) : terre, héritage, « lingue », langues, au-delà de la « grammaire faciste » (ricordo #4), du « bégaiement » et des « fausses prières » (ricordo #8). Perdre sa langue c’est perdre « le fil, le nord » (ricordo #185). Lui, il les a perdus.
246. Mi ricordo
quand son père a avalé sa langue natale et
jeté la clef des Langhe maternelles dans un
lac avant de traverser.
Quand il s’agit de « tomber » ou « fuir » (ricordo #46), souvent on fuit, sans savoir qu’on continuera à tomber dans l’exode, et que chaque chute trouera un peu plus la mémoire. Lui c’est peut-être l’auteur, qui prend figure à travers la fulgurance et la justesse des intuitions vers lesquelles ses recherches le mènent.
19. Mi ricordo
d’un vendredi où il en a eu assez de ne rien
savoir, où il a choisi sa voie, la voix de la
fiction.
469. Mi ricordo
que j’ai commencé à écrire Mi ricordo non
pas pour me souvenir mais parce que j’ai
déjà tout oublié.
Le texte de Ricordi et sa configuration esthétique ont été manifestement pensés, travaillés, pourtant, son cortège de vers rythmés par les mots « Mi ricordo » donne une impression d’impulsion, de spontanéité, de « notes griffonnées à la dérobée » (Primo Levi, Si c’est un homme), portées par le besoin urgent de vaincre la déshumanisation et de retenir quelque chose de l’humanité. Primo Levi, dans sa préface à Si c’est un homme, a écrit, au sujet du caractère fragmentaire de son livre, que « les chapitres en ont été rédigés non pas selon un déroulement logique, mais par ordre d’urgence » ; préface qu’il termine par : « Il me semble inutile d’ajouter qu’aucun des faits n’y est inventé » (Primo Levi, Turin, janvier 1947). Il semblerait que les Ricordi de Christophe Grossi révèlent ce souci de clarté cher à Levi. Nous n’avons pas affaire à un pêle-mêle hétéroclite et « discutable », mais à une suite qui tentent d’organiser et de dominer le chaos laissé par les guerres, en documentant ce qui n’est plus : une façon de se donner les ancres qui manquent.
375. Mi ricordo
ne veut pas dire je me souviens mais je suis un
corps projeté dans une histoire de langue perdue ou
éteins la lumière et raconte.
Mi ricordo ne dit pas qu’il se souvient. Mi ricordo, pour Grossi, signifie « Je se souvient d’autres histoires que la nôtre et de vies arrachées au vide » (postface à Ricordi). Sont donc égrenés ici des ricordi ou « souvenirs » qui ne sont peut-être ni personnels, ni autobiographiques : vrais-faux-souvenirs déboîtés formant le chapelet de la quête des origines perdues, de « toutes les histoires qui avaient traversé son enfance » (ricordo #277), remise en question essentielle de ce qui apparemment a été.
475. Mi ricordo
que tout ce qu’il avait tant cherché et
questionné était devant lui cette fois :
désordonné, fragmentaire et discutable.
Les alternances de code rencontrées dans ces souvenirs révèlent que les vocables retenus de la langue italienne par sa mémoire à lui sont des éléments courants, que tout le monde, en touriste – et les touristes inclus : ceux qui se distinguent par leur pays d’origine –, partage en croyant comprendre. Et l’on ne peut s’empêcher de se rappeler que des camarades de Primo Levi – que l’incompréhension rendait fou à Auschwitz, alors qu’il possédait des rudiments d’allemand grâce à la chimie – sont morts d’avoir mal compris ce qui leur avait été hurlé dans une langue qui leur était étrangère, phagocytée par le nazisme.
20. Mi ricordo
des Ciao ! et des Arrivederci !
Lui c’est « celui qui aurait préféré ne jamais mentir » (ricordo #33), mais comment ne pas fabuler quand on est de « ceux qui ont perdu la mémoire de leurs origines » (ricordo #26), qui ne savent donc de leur passé que ce que tout le monde sait, c’est-à-dire rien du tout ? Qui est lui ? Lui chi è ? L’homme à la « bouche de mythomane » (#ricordo 306), « un faussaire qui s’ignore » (ricordo #322) et qui « a souvent eu l’impression qu’on parlait d’un autre que lui quand on évoquait son passé » (ricordo #261).
303. Mi ricordo
que les souvenirs se déforment, déforment,
se reforment et que les mots s’adaptent,
adaptent, rangent, arrangent, dérangent.
Lui gît. Il est de ces amnésiques qui, leur nom ou celui de leur pays « sur le bout d’une autre langue » (ricordo #8), sont attelés à l’absence. Heureusement pour nous, elle s’est révélée pour certains d’entre eux être un terreau favorable à l’écriture et à la construction d’une œuvre littéraire. Sortir d’une peau qui n’est pas à sa taille, pour la sauver et retrouver sa propre mémoire... d’aède, de créateur. Ricordi semble dire que le voyage pour regagner les rives de sa propre vérité passe ici par l’étoffement littéraire.
215. Mi ricordo
qu’aujourd’hui, parce que j’étais absent, il ne
me reste plus que cette pratique de faussaire :
l’écriture.
Primo Levi – doublement témoin puisqu’il était autant victime que témoin de la Shoah – raconte, dans Si c’est un homme, comment il a récité et traduit, d’absence en absence, à son camarade Jean Samuel alias Pikolo, des fragments de la Divine Comédie de Dante, extraits du « Chant d’Ulysse », dans lequel Ulysse exhorte son équipage réticent à poursuivre leur voyage : « Et c’est comme si moi aussi j’entendais ces paroles pour la première fois : comme une sonnerie de trompettes, comme la voix de Dieu. L’espace d’un instant, j’ai oublié qui je suis et où je suis. Pikolo me prie de répéter. Il est bon, Pikolo, il s’est rendu compte qu’il est en train de me faire du bien ». La littérature rend son sens à la vie. Les derniers mots de Si c’est un homme disent : « Nous avons échangé de longues lettres et j’espère bien le revoir un jour ». L’écriture et la littérature possèdent le pouvoir magique de porter et de nourrir l’espoir de vivre encore.
45. Mi ricordo
de tout ce qu’il a vu et lu, de ce qu’on a pu
lui raconter et taire, de toutes ces vies qui
auraient pu être les leurs.
178. Mi ricordo
de ceux qui ont dû s’inventer une famille
une fois les voyelles finales gommées.
Tous ces i, ces a, ces o, effacés, soldats fauchés toujours trop jeunes par les guerres, déportés qui « trébuche[nt] et roule[nt] dans la boue noire » (Si c’est un homme, Primo Levi). Les disparus hantent la voix de Christophe Grossi, pluriel de par son nom de famille lipogrammique en E.
440. Mi ricordo
qu’on finit toujours par imaginer, maquiller,
inventorier, détourner, feindre, oublier, dire,
dresser des listes, écrire.
Ces verbes aident Christophe Grossi à tirer et à démêler les ficelles et les nœuds de la mémoire ; dans quel but ? Pour se fabriquer une échelle de corde à laquelle s’accrocher, éventuellement y grimper ? Se tracer une ligne à suivre, un chemin où poser ses pas ? Écrire se situerait alors entre le funambulisme et la corderie, ce serait un art de l’équilibre et de la torsion, art de la filature des souvenirs qui ne nous appartiennent pas en propre, pour espérer se retrouver à la fin. Cixous parle de « trafictionner ». La seule façon de se les approprier serait de les recréer en les écrivant, de les faire passer par le corps, pour les créer soi, les faire sortir de soi, comme un enfantement. Écrire serait aussi une forge où les souvenirs sont travaillés, façonnés, par nécessité, et avec lucidité, car la langue manque de fiabilité quand il s’agit de représenter le réel.
376. Mi ricordo
quand dans ses nuits blanches il se heurtait
à des silhouettes (parfois à peine des
ombres) qui filaient sans mot dire.
Ces fantômes de souvenirs, ces formes évasives, silhouettes évadées du passé, « à peine des ombres » mais aussi compactes que de lourds meubles de famille, muets, contre lesquels on bute dans l’obscurité, et « qui filaient sans mot dire » : filaient qui, filaient quoi ? Filaient en silence la trame de vies impossible à raconter parce que passées sous silence justement ? Transmettre les histoires, c’est aussi transmettre la vie, et ça, Christophe Grossi le sait. Ricordi est un livre important car il révèle ce cheminement en apnée et à tâtons que tout écrivain entreprend dans les zones silencieuses de sa mémoire. Il ressemble au pense-bête que certains d’entre nous pourrions écrire durant la construction d’un roman (d’ailleurs, l’intention première de Grossi avait été d’écrire un roman sur ses origines familiales). Les perles improbables ramenées de cette plongée n’existeraient pas sans le mensonge qui fait battre le cœur de l’écriture. Tout le monde sait que le mensonge et ses dérivés – simulations, fables, sortilèges, histoires, fards, illusions, mirages, rêves, pièges, délires, mystifications, erreurs, obscurité, fumée, magie, et vide – hante et fait vibrer les créations littéraires.
62. Mi ricordo
quand il s’est fabriqué une ascendance, une
vie par procuration : par peur du trou, du
tremblé vide, du suspens trouble.
Jorge Semprun, dans sa préface au recueil poétique de Primo Levi, À une heure incertaine (1984), lorsqu’il compare la poésie de ce dernier à celle de Paul Celan, rappelle à plusieurs reprises un vers du poète allemand : « Wahr spricht, wer Schatten spricht », « dit le vrai qui dit l’ombre » (« celui dit vrai, qui parle d’ombre », tiré du poème « Toi aussi parle », trad. : Gil Pressnitzer pour Esprits nomades). Semprun précise aussi que « le mot allemand pour poésie, Dichtung, est le substantif de dichten, qui ne veut pas seulement dire écrire des vers, poétiser, mais aussi épaissir, condenser ».
378. Mi ricordo
avoir commencé à écrire ces ricordi sans
savoir si un jour je serais père.
Christophe Grossi est aujourd’hui à la fois père d’enfants et d’enfantements, de lui-même et de ses textes, un écrivain à part entière. Mentir comme écrire sont posés dans Ricordi comme étant nécessaires à la survie, puisqu’ils sont des actes créateurs. Primo Levi l’avait compris. Le mot poésie ne dit rien d’autre, provenant du grec poiêsis et poiein : création, créer. Dans Lilith (1978), il loue le mensonge auprès de son fils : « De tout ce que tu viens de lire, tu pourras déduire que le mensonge est un péché pour les autres, et pour nous une vertu. Le mensonge ne fait qu’un avec notre métier : il convient que nous mentions par la parole, par les yeux, par le sourire, par l’habit ». Ainsi, le témoignage littéraire ne prêtera pas serment d’allégeance à la littérarité : « Ce livre est plein de littérature », dit Primo Levi dans un entretien (Primo Levi, Conversations et entretiens, 1963-1987). « Je pensais écrire l’histoire authentique de l'expérience du camp de concentration, alors que, en réalité, j’écrivais l'histoire de mon camp, et seulement du mien » (op. cit.). Imre Kertész est allé jusqu’à comparer l’écriture de son roman Être sans destin à une invention d’Auschwitz (Imre Kertész, Dossier K, 2008).
121. Mi ricordo
quand il disait qu’avouer est d’abord
raconter sa vision des choses, sa version :
c’est devenir le narrateur de sa propre
histoire.
Où situer, alors, entre le langage infecté de mensonges (« la grammaire fasciste », ricordo #4) et le mensonge dans la littérature, la démarche des Ricordi de Christophe Grossi ? Entre ceux qui, comme Primo Levi, mettent en doute le témoignage, qu’ils considèrent pourtant comme une façon de prêter sa voix aux disparus, et ceux qui mentent comme on lance un leurre, pour attirer le secret, ainsi que sa vérité à soi, les faire remonter à la surface. Par conséquent, face à la question de la mémoire en tant qu’entité textuelle tragique, et aux questions de témoigner ou non, de déterrer ou non, de raconter ou non, de mentir ou non, la seule réponse de Ricordi est le verbe, écrire.
414. Mi ricordo
que la vérité est toujours si prévisible que
rien ne vaut la fiction.
Sabine Huynh a publié chez Recours au Poème éditeurs :
Avec vous ce jour-là. Lettre au poète Allen Ginsberg