Ainsi parlait…
Un Hugo caravagesque
Pour parler du grand auteur romantique français qu’est Victor Hugo, il faut trouver des mots amples et englobants. Une fois acquise cette idée, il ne faut pas oublier de rappeler l’esprit très moderne de la pensée de Victor Hugo. Ainsi, son travail d’écrivain est-il l’alliance des contraires – fond et forme, force et faiblesse, lumière et obscurité, vie et déclin, présence de l’homme au sein de l’univers, renaissance de l’idéal au sein d’une réalité, imagination au sein du réel – et se résume par cet adjectif : caravagesque.
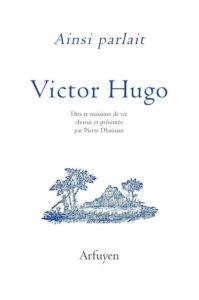
Pierre Dhainaut, Ainsi parlait Victor Hugo, éd.
Arfuyen, 2018, 14€
Cette épithète peut donner forme à une lecture générale de cet ouvrage, fait d’aphorismes, de dits, de choix de poèmes notamment. Cette littérature semble bel et bien être celle du clair-obscur, où l’on reconnaît en l’occurrence les images peintes de Victor Hugo qui décrivent un univers noir et lumineux.
Ce livre propose un choix de citations parmi les livres, poèmes, romans, carnets et recueils de l’auteur. Il met en lumière ce qui pour moi est l’essence de la vie intellectuelle de la poésie : l’oxymore. Et avec lui, cette tentation d’allier les contraires avec toutes les chances de saisir la réalité. Hugo est un maître caravagesque qui décrit une réalité plurielle, profuse, dans laquelle la lucidité est désirée avec intelligence. L’on peut par exemple chercher la définition de l’homme, ou de l’artiste, ou du génie, et c’est toujours un peu plus près de la vérité que nous nous trouvons, vérité qui demande que la réalité soit dite philosophiquement dans sa complexion.
[La] poésie fera un grand pas, un pas décisif, un pas qui, pareil à la secousse d’un tremblement de terre, changera toute la face du monde intellectuel. Elle se mettra à faire comme la nature, à mêler dans ses créations, sans pour autant les confondre, l’ombre à la lumière, le grotesque au sublime, en d’autres termes, le corps à l’âme, la bête à l’esprit. […] Tout se tient.
Donc réfléchir avec Hugo, cela veut dire qu’il faut penser en termes moraux et esthétiques, lesquels sont pour finir la seule vraie mesure de l’activité du lecteur. Cette dernière doit être éprise à la fois de beauté et de morale. Et ici particulièrement, c’est autant Dieu que les hommes qui exigent le côtoiement du beau et de la vérité. Du reste, beau, vérité, œuvre, artiste, tous ces termes sont capables d’aider le poète de la place Royale à accoucher d’une littérature grandissime et auprès de laquelle l’homme acquiert une dimension supérieure, la littérature l’augmentant.
Veille ou dors, viens ou fuis, nie ou crois, prends ou laisse. / Sois immonde ou sois pur ; sois bon ou sois pervers ; / Insulte l’aube, ou ris sous les feuillages verts ; / Montre-toi, cache-toi ; va-t’en, demeure, oscille ; / Ignore ou bien apprends ; pense ou sois imbécile. […] Le monde est une meule à broyer la pensée.
Je disais tout à l’heure que l’écriture de Victor Hugo faisait place à des figures et à leur contraire, et que cela allait de pair avec un esprit moderne. Et il ne faut donc pas oublier combien le poète s’est battu contre la peine de mort, a contribué et contribue encore aujourd’hui à se faire une haute idée de l’Europe politique ou encore plus simplement à appeler l’homme moderne à une foi personnelle.
L’assujettissement aux Bibles, la servitude aux livres, l’idolâtrie des textes, l’obéissance passive aux Védas et aux Korans, tout cela est terrestre, tout cela est artificiel, tout cela est construit pour le besoin de tel ou tel mode de civilisation, tout cela porte des ratures et des surcharges faites de main d’homme ; tout cela n’a, dans l’absolu, aucune raison d’être.
ou
La peine de mort est le signe spécial et éternel de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine […].
Je vote l’abolition pure, simple et définitive de la peine de mort.
Pour conclure, j’avais à l’esprit de citer mieux que je ne le fais les aphorismes les plus pertinents, nonobstant la distance temporelle qui nous sépare de ces écrits. Mais je crois que chaque lecteur ou lectrice peut se faire une idée individuelle et choisir son propre chemin comme le fait Pierre Dhainaut. Je referme ces lignes malgré tout avec ce petit texte en volume un peu pris au hasard de mon cheminement.
Ce qui fait la grandeur de l’homme, c’est d’être incomplet ; c’est de se sentir par une foule de points hors du fini ; c’est de percevoir quelque chose au-delà de soi, quelque chose en-deçà.
Une littérature oppositionnelle
Comme beaucoup de lecteurs français, je ne connais vraiment de l’œuvre d’Herman Melville que Moby Dick, et j’ai pris plaisir à la lecture de cet Ainsi parlait - que publient intelligemment les éditions Arfuyen -, séduit par la richesse intellectuelle de l’écrivain américain. Sans doute, le sommet de son art est-il consigné dans ce roman maritime, et la reconnaissance publique de l’œuvre, maintenant une chose acquise et assurée, en est l’expression. Mais je répète que j’ai été surpris par la profondeur dont témoigne cette prose, et de voir autant de tenue morale dans les poèmes, la correspondance ou les œuvres narratives, lesquelles dessinent une pensée complexe et articulée, anticonformiste et humaniste.
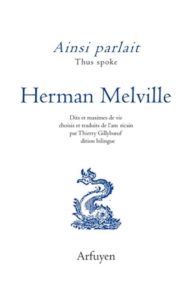
Ainsi parlait Herman Melville, édition bilingue,
trad. Thierry Gillyboeuf, Arfuyen, 2018.
Je dirais même que son œuvre est articulée par une forme maitrisée de schize, de dédoublement du propos, mettant en valeur la pauvreté contre la richesse, le barbare contre le civilisé, le sage contre l’ignorant, le faible contre le fort, tout cela dans une tension presque dramaturgique qui permet de distinguer la vérité, ou du moins, la vérité de l’auteur.
À mon sens, le terme « sauvage » est souvent utilisé à mauvais escient ; de fait, quand je regarde les vices, les cruautés et les monstruosités de toutes sortes qui prospèrent dans l’atmosphère corrompue d’une civilisation fiévreuse, je suis enclin à croire qu’en matière de perversité relative des parties, quatre ou cinq insulaires des Marquises envoyés comme missionnaires aux États-Unis seraient sans doute aussi utiles qu’un nombre équivalent d’Américains dépêchés dans ces îles au même titre.
Une fois admis ce parti oppositionnel, il faut poursuivre en expliquant que l’art de Melville se frotte à Shakespeare, la Bible, Montaigne ou Lucrèce, et évidemment reste nourri de ce qui entoure l’écrivain, c’est-à-dire Emerson ou
Thoreau, ou Whitman qui est son exact contemporain. On trouve aussi des idées originales et singulières, par exemple la conception que l’auteur a de la démocratie, qui, je pense, diffère de la conception de Whitman qui chante, lui, le poème lyrique des États Unis et de leur Constitution, alors que Melville reste circonspect, prône davantage le sceptre et le pouvoir royal, ce qui rétrospectivement, pour notre temps politique d’aujourd’hui et la crise des démocraties occidentales, est presque une vision d’avant-garde.
J’ai parlé d’un discours tendu entre des pôles, des oppositions tranchées et très nettes, mais il faut néanmoins accorder une unité intelligible à la figure de Dieu (dont d’ailleurs Melville interroge la majuscule). Je crois pouvoir m’avancer en voyant en lui un croyant, une âme confrontée au silence de la méditation, dans une méditation plus poétique que mystique. Ainsi, un Dieu pantocrator qui gouvernerait la nature et les eaux. D’ailleurs, on reconnaît très nettement La Tempête.
Comme chacun sait, la méditation et l’eau sont unies à jamais.
Et je pourrais poursuivre en faisant état de mon cheminement de lecteur, en dialoguant au sujet des eaux, avec les Cinq Grandes Odes, et repérer ici ou là, les eaux bachelardiennes qui m’ont toujours été un rêve personnel. N’oublions pas que Melville est célèbre pour son récit maritime qui met en scène une quête d’absolu mortelle et magnifique, angoissante et dense. Donc, Melville est l’auteur sans contestation possible qui règne parmi les plus grands de notre panthéon littéraire. Pour preuve et pour conclure, je citerai :
Chaque fois que je sens l’amertume torde mes lèvres, chaque fois qu’un novembre humide et bruineux règne en mon âme, chaque fois que je me surprends en train de m’arrêter à mon insu devant des magasins de cercueils et de rejoindre le premier cortège funéraire que je croise, et surtout quand le cafard m’étreint si fort que seul un puissant sens moral m’empêche de descendre d’un pas résolu dans la rue pour faire valser méthodiquement les chapeaux des passants – j’estime alors qu’il est urgent de prendre la mer dès que possible.
Le poète de la relation
Aborder Baudelaire aujourd’hui relève d’un processus de lecture à la fois académique et personnel. Pour ma part, je ferais de ce livre Ainsi parlait Charles Baudelaire, une lecture personnelle et en quelque sorte au carré. En effet, on ressent nettement que Yves Leclair, le poète qui a collationné ces citations avait son propre Baudelaire en tête. Et donc pour ce qui me concerne, je ne peux que faire une lecture de la lecture, me refaire mon propre Baudelaire dans le Baudelaire d’Yves Leclair.
Je dirais qu’il s’agit en quelque sorte de chercher « un poisson soluble », c’est-à-dire l’idée qui aimante et fait axe dans ces textes et les rend cohérents, et voir comment cette idée abstraite éclaire le mystère du texte. J’y ai vu une cristallisation autour de grands thèmes, celle de la relation de grands thèmes : relation du texte et de l’amour, relation du texte et de la mort, où s’articulent le discours poétique et les femmes, ou encore la relation du poème avec la beauté. J’affirmerais même que la beauté a été mon poisson soluble, la cheville ouvrière qui m’a ouvert à la compréhension esthétique de ce corpus complexe, ce poisson qui s’est défait dans les eaux profondes du texte baudelairien. Et cela n’a pas annihilé la dimension d’angoisse, de la densité de l’anxiété du poète, qui d’ailleurs fait appel plus à Dionysos qu’à Apollon.
Et par le hasard des contingences, je lisais le De profundis d’Oscar Wilde et l’un de ses Essais, au moment où j’ai reçu ce livre intéressant que publie Arfuyen, et qui m’a permis de lire « au carré » cette belle littérature britannique. Cela pour évoquer la filiation du poète français avec la modernité littéraire et dont l’influence va peut-être très vite vers Wilde, Verlaine, et qui sait ? vers Nietzsche. En tout cas, je retrouve cette activité de dandy créateur à égalité dans le Wilde souffrant en prison et le Baudelaire opiomane.
La mode doit donc être considérée comme un symptôme du goût de l’idéal surnageant dans le cerveau humain au-dessus de tout ce que la vie naturelle y accumule de grossier, de terrestre et d’immonde, comme une déformation sublime de la nature, ou plutôt comme un essai permanent et successif de réformation de la nature.
Ou encore
Sur un fond d’une lumière infernale ou sur un fond d’aurore boréale, rouge, orangé, sulfureux, rose (le rose révélant une idée d’extase à la frivolité), quelquefois violet (couleur affectionnée des chanoinesses, braise qui s’éteint derrière un rideau d’azur), sur ces fonds magiques, imitant diversement les feux de Bengale, s’enlève l’image variée de la beauté interlope. Ici, majestueuse, là légère, tantôt svelte, grêle même, tantôt cyclopéenne ; tantôt petite et pétillante, tantôt lourde et monumentale.
Et là se situe bien mon Charles Baudelaire, calme dans sa vie tumultueuse, fort et âpre, quand par ailleurs j’aime tant voir l‘homme derrière le poème. Du reste, et pour conclure, je dirai que le poète a eu une importance considérable dans ma vie, car lors de mon premier voyage hors du continent européen, j’avais pour seul livre dans mon bagage Les Fleurs du mal. Et ce livre a correspondu exactement à la violence de ce séjour en terre nord-africaine. Je me suis donc épris moi aussi depuis de beauté, et fais du poème une hantise. Et c’est avec le poète des Paradis artificiels que je fermerai cette chronique.
La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable.

Ainsi parlait Charles Baudelaire, conception d’Yves Leclair,
éd. Arfuyen, 2018, 14€