Albertine Benedetto, Vider les lieux
Sur la couverture l’aquarelle d’Hélène Baumel, un chemin d’automne d’une tristesse envoûtante, incite à la lecture de ce recueil ponctué d’autres lavis. Leurs ombres au brun subtil se glissent, s’étalent et se diffusent en taches d’un orange ambré.
Vider les lieux est un titre rude et imprévu. Une injonction qui aurait pu se terminer par un point d’exclamation (!)? Un constat qui aurait pu se terminer par des points de suspension (…)? Une métaphore qui aurait pu…Mystère. Recevoir l’ouvrage le jour même du décès d’une amie d’adolescence1 lui a donné une portée imprévue : il s’est fait l’écho d’une évocation libre et autre de la mort.
Pour Albertine Benedetto, cette mort est si proche qu’elle harcèle jusqu’à nos propres mots : « Le monde est habité par les mots – il suffit d’enlever le R de mort ». Nous devenons des survivants, dont « les mots » désormais prioritaires jonglent, fabriquent et rappellent l’histoire des absents2.
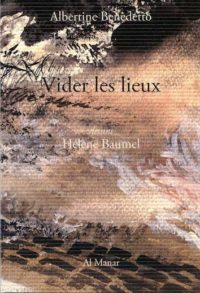
Albertine Benedetto, Vider les
lieux, Ed. Al Manar, 2019, 16€
Il nous faut « conduire le deuil / en procession de mots », à « nos aimés ». Que devient ce chagrin a posteriori, « toutes ces vies / en forme de récits / sur des carnets / illisibles » ? A décrypter donc. Les objets posthumes – cad sans propriétaire - devenus porteurs d’un sens libéré, proposent alors « un labyrinthe de signes / où s’égarer ». L’histoire de ces « meubles déchus » se continuera sans eux en ce « tombeau léger / des mots arrangés d’un poème ». Les animaux domestiques rescapés deviennent aussi la proie de nos expressions et de notre vocabulaire. Même « le mot cheval souffle doucement sur un pré / à la saison incertaine », en quelque sorte évadé du vrai corps de l’animal. Autant de termes qui sont « comme des cailloux / pour retrouver le chemin / de la chambre où dormaient les parents ». Des cailloux - repères et souvenirs - que suit la Petite Poucette poétesse. Pour preuve, son ouvrage à la poésie délicate est rythmé selon le découpage tripartite de sa pensée en deuil : « Lieux, Reliques, Je suis là ». Un découpage rassurant sans doute car il est un itinéraire possible à travers la mort, à travers l’expérience de la disparition, donc à travers le ou la défunt.e. Un voyage dans le langage que l’autrice propose pourtant sans la moindre ponctuation, comme une lente coulée de sentiments et d’observations.
Il faut bien commencer quelque part ce voyage si particulier. Albertine Benedetto s’ancre d’abord en ce « lieu » où vécut et/où mourut le disparu. Qu’en reste-t-il ? L’acte de se perdre ensuite dans une « ville des morts », ces catacombes, lieu collectif de deuils individuels. Là, les vivants cherchent sous la terre « comme un avant-goût des ténèbres / comme un mode d’emploi / ou quoi ?».
Les habitations sont également des lieux dans le lieu où se cherchent des traces infimes : Les « maisons / à l’heure du tri / saturées de choses / des petits riens ». Elles sont d’une banalité exemplaire : « La maison aux yeux clos/ que rien ne distingue d’une autre ». Néanmoins des vestiges demeurent à l’intérieur, « des pacotilles de souvenirs / ces nids à poussière ». Elles capturent les vécus enfantins de ce temps d’avant : « Toujours l’enfance bondit / de pierre en pierre dans le lit du torrent ». Un vécu de nostalgie qui conduit à l’avenir de séparation d’avec sa propre enfance: « les draps enveloppent les restes / de l’enfance qui finira ». La disparition engendrera le départ de la maison après un grand ménage : « Bien enclos dans leurs chambres, les morts s’étonnent en novembre ».
Avec la présence des « reliques », un autre temps poétique survient. Tous les objets prennent un autre sens. Ils ont d’abord été une protection rassurante : « Etre dans ses meubles /comme être dans sa peau ». Ils sont ensuite engloutis dans le tourbillon de la mort. Ainsi les « meubles déchus/en bout de succession/ désossés / plus que morceaux de bois ». Laissés en tas sur le trottoir, ils participent au « tombeau ». Il conviendra ensuite de reconnaître la présence de l’être endeuillé (partie Je suis là), porteur de ces « mots tombés du tricot de la vie ».
Au fil de ces pages, partout, des « ombres » se glissent, composant secrètement un certain monde parallèle, fluctuant et fugace. Parfois réelles, parfois figurées. Nées en tout cas de la lumière qui éclaire l’opacité du défunt et du décès. Des choses d’abord : objet, arbre, nuage… Ainsi « l’ombre d’un rabot / sur la planche équarrie », qui va se « fondre dans une autre ombre / un autre silence ». Ainsi « la lumière échappée de l’ombre d’un tilleul » qui laisse apercevoir les balançoires du jardin. Ainsi « on ne voit que des ombres / passantes sur le pré / des nuages flottent » : elles renvoient aux ombrelles de couleur vive dont les « silhouettes » sont « découpées dans l’ombre des murs ».
Ombre des souvenirs personnels ensuite …Ainsi l’« ombre sur le drap » où git la mémoire de jeux d’enfance avant de se transformer en linceul. Ainsi « avec l’ombre de nos mains /nous nous toucherons encore ». Ombres de soi-même et du vivant, « avant de revenir /errer dans nos ombres pâles/ ignorant de quelle déchirure nous sommes faits ». Mais toutes conduisent à l’ombre des morts et de leurs traces fantomatiques : « leurs ombres s’étirent se remuent / flottent en vapeur douce/au-dessus des marbres luisants ». D’évidence toutes ces ombres ont « un cœur », un seul, celui de la poétesse.
Les mots effleurent les moments du deuil qui, reconnaissons-le, sont ici séparés par commodité, juste pour parvenir à penser la mort impensable. S’ils conduisent tous à ce « Je » qui récapitule le vécu de la séparation, un tel vécu est déjà présent dans le lieu et dans les reliques. Cette poétesse vit en outre sur deux niveaux, lors de voyages bien réels qui rappellent aussi la mort. Une superposition qui fait ressurgir ça et là la mémoire du deuil et de la mort en d’autres lieux (Catacombes San Callisto, Villa Adriana, Via Appia en Italie). Une superposition qui renvoie aussi à un poète contemporain, James Sacré. Autant de strates de soi qui coulent et s’écoulent vers l’affirmation de la vie, vers le Je suis là. Autre façon d’annoncer que nous sommes là aussi !
Notes
(1) Catherine Grupper qui défendit tant de causes justes du MRAP à la libération de Mumia.
(2) Le peintre Michel Julliard m’écrira en écho à cette disparition : « Les ami(e)s ne partent jamais tout à fait, tant que leurs ami(e)s pensent à eux, ils sont juste un peu absents ».