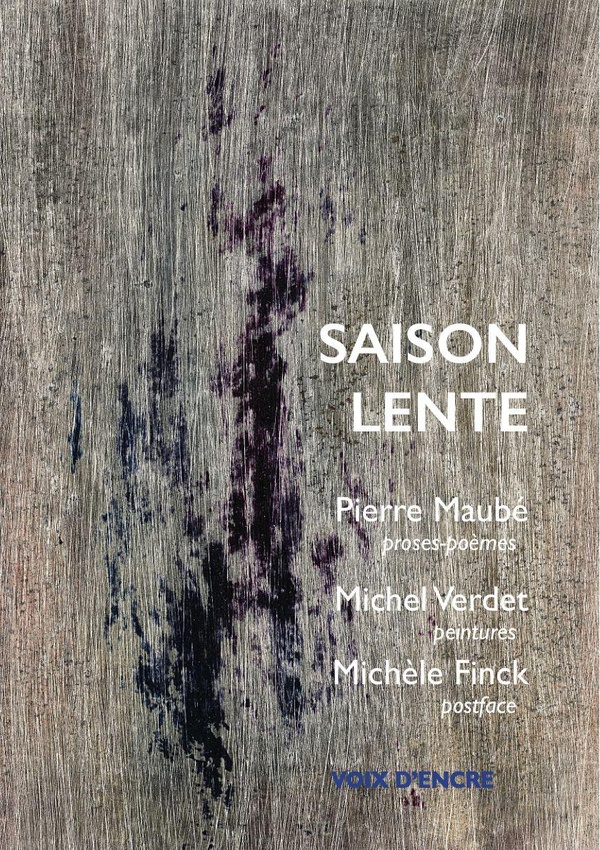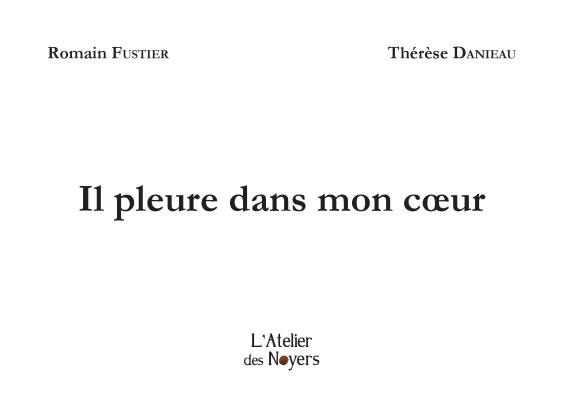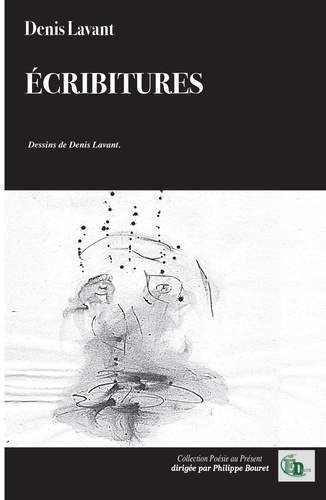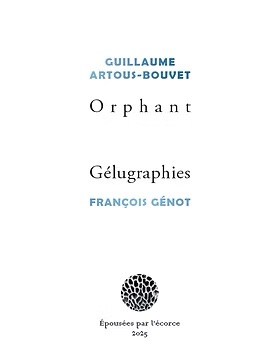Il est difficile d’être plus de New York qu’Alicia. Mais être de New York est un syndrome porteur de pigments insolubles dans l’encre et que l’on retrouve nécessairement ou découvre dans le poème. J’ai connu l’œuvre d’Alicia grâce à Marilyn Hacker qui m’avait fait lire son lumineux Stealing the Language lors de sa parution. Je venais d’entrer en traduction de poésie et j’allais bientôt être chargé de l’œuvre au programme de littérature américaine en classe préparatoire au concours d’entrée à ce qui était alors l’ENS Fontenay/Saint-Cloud. J’ai redit à Alicia toute mon admiration à l’occasion de la sortie de For the Love of God, mais je ne l’ai rencontrée qu’en 2014, à son invitation, chez elle, à Manhattan. Je venais de faire passer quelques traductions en ligne, tirées de The Book of Life (2012), dans Temporel, la revue d’Anne Mounic. Et je traduisais son dernier recueil pour un éditeur qui a, hélas, passé l’arme à gauche (économiquement) avant de passer à l’acte. Trop de je dans le jeu ? C’est la rançon du traduire qu’il serait vain de camoufler.
***
Une définition pour Alicia, de la part du traducteur.
Être humain : Human Being or Being Human ?
Oxymoron ou pléonasme ?
***
Figures imposées :
Quatrième Rue Ouest
extrait de The Book of Seventy, 2012
Les platanes perdent leurs feuilles
Quatrième Rue Ouest et l’âge me rend bizarre
Heureuse pourtant de les voir pâles et chatoyants
Au sortir du métro dans la circulation
Les détritus et bouffées de patchouli – maintenant que je sais lire
Entre les lignes du brouillon de ma vie
Le plaisir me rend souvent visite – il y a moins d’interférences
Quand je regarde quelque chose aujourd’hui
Ce que je vois je le vois clairement
Avec moins de chagrin et de colère qu’auparavant
Et moins de désir : non pas que j’aie vaincu ces passions
Elles se sont estompées
Et si je souris d’admiration devant quatre Brésiliens
Qui jouent à la pelote sur un carré de béton ensoleillé
Et crient en portugais
Mains gantées de chevreau car la pelote cingle
Dos comme enracinés de muscles éclairs d’or autour du cou
Si je les regarde danser la samba avec leur ombre
Comme se contorsionnait mon père il y a cinquante ans
Lorsque les fils de Juifs immigrés
Jouaient des parties acharnées sur les terrains de Manhattan
– Si je me dis que ces hommes sont l’essence de la ville
C’est à cause de leur beauté
Puisque j’ai appris à m’enticher de la beauté.
( une lecture ‑jazz de ce poème en suivant le lien : https://www.youtube.com/watch?v=6z9x43kAyHI&feature=share)
Afghanistan : la gamine violée
Extrait de Waiting for the Light: New Poems, 2015.
Parce que le mollah l’a violée, elle n’a pas le droit de vivre
ses frères vont la tuer, question d’honneur
elle a dix ans et n’est pas encore réglée
mais elle saigne à flots à l’hôpital
La doctoresse trouve la mère qui tient la main de sa fille
elles pleurent toutes les deux, la mère dit
ma fille que la terre et la poussière te protègent maintenant
nous te coucherons dans la terre et la poussière
et nous t’enverrons au cimetière où tu ne craindras plus rien
Les frères ont demandé aux policiers dont dépend
le pavillon des femmes où elle se trouve maintenant
de la leur remettre
ils ont promis de ne pas lui faire de mal
mais tout le monde sait bien
que mensonge n’est pas péché quand l’honneur est en cause
même la mère le sait bien
et sa fille tout autant
seul le Docteur Sarwari, directrice du pavillon est en colère
elle invective les policiers comme une vieille corneille grise
et le journaliste qui fait son boulot
et recueille les détails
pourra aller se pinter ce soir
Et moi qui lis le reportage
je vais convoquer ma mère, où qu’elle se trouve
dans l’au-delà, peut-être dans ce paradis
qui pour elle
n’existait pas, elle qui m’a appris
la rage et la liberté, nos armes d’ici-bas.
Ghazal : même pas là
Extrait de Waiting for the Light: New Poems, 2015.
Jack Burkheimer (sur la gauche) est devenu le poète porte-parole des sdf
de Columbia. Son poème, Fruit de l’imagination, brosse l’éloquente toile d’une
vie que l’on passe dans la rue, à être invisible au milieu des passants,
comme si on n’était même pas là.
Annonce en ligne d’un concert de charité au profit des sdf de Columbia,
Caroline du Sud.
À Meira Warshauer, à Jack, à tous les autres.
Engoncé dans un sac de couchage. Chaussures de sport. T shirts. Affaires dans un
Caddy à côté de lui dans le passage souterrain. Parfois la compagnie d’un chien. Dans
le jardin public. Sur les marches de l’église. Sous un pont. Sur une bouche de chauffage,
appuyé sans rien dire contre un mur, n’importe où mais, tout d’un coup, là
où il pourrait être relativement à l’abri de la peur. Il est vrai que pigeons et
passants ont coutume de ne pas le voir, même s’il a le regard glacé d’un roi,
mais nous non plus d’habitude nous ne voyons pas les autres dans la rue, l’ascenseur,
au restaurant et au spectacle, comme si c’était la règle, comme si hors de nos quatre
murs, tout d’un coup, la
loi nous enjoignait de faire comme si les autres n’existaient pas, parce qu’il faut se
protéger de l’avalanche d’esprits furieux qui vous tombe sur le poil comme des
anges déchus à Gravelotte, et qu’ayant du mal à bouger sous cette carapace je n’arrive
pas à montrer à Jack, à celle qui est allongée à côté de lui, engoncée dans des châles,
que je viens de les voir tout d’un coup, là,
mais je le fais, je le sais, je peux même leur donner la pièce, pour leur montrer que
je les ai vus, anges déchus ou fleurs tombées et que je pourrais être à leur place – un
peu d’argent, une bonne parole peut-être, d’eux aussi peut-être en retour et si je
m’arrête tout d’un coup, là
un quart de seconde, toute ébouriffée de pigeons, dans un accordéon de voitures
et de bus, de feux qui passent par toutes les couleurs comme tout le reste, atomisé
brownien, si je tombe à genoux tout d’un coup, là
dans la rue, Jack, est-ce que tu auras envie de me voir, envie d’être vu ?
Je te vois en roi déchu. Je nous vois tous calfeutrés dans nos sacs à viande et toi
femme sous tes couvertures dépenaillées je te vois en reine, en exil, un instant
là, tout d’un coup.
Figures libres, choix du traducteur :
Extrait de La vieille dame, la tulipe et le chien
(The Old Woman, the Tulip, and the Dog) 2014.
Ridicule
C’est ridicule
fait la vieille littéraire
personne n’a d’égards pour nous
les jeunes enlacés
parlent dans leurs iPhones
les députés mentent comme des arracheurs de dents
et nos maris regardent le match
C’est ridicule
fait la tulipe
toutes ces fleurs génétiquement modifiées
ces orchidées idiotes et increvables
à croire qu’elles sont en plastique
et ces bordures végétales chic
qui envahissent le décor
C’est ridicule
fait le chien
voilà qu’en plus de me sortir
il faut qu’ils me courent aux basques avec leurs
pochettes hygiéniques en plastique
et imposent leurs valeurs bourgeoises
à ma créativité spontanée
*
Extrait du premier chapitre : « Le Cantique des Cantiques.
Sacré entre tout ce qui est sacré », de For the Love of God, 2007.
Contrairement à certaines lectures qui voient le désir toujours retardé dans le Cantique des Cantiques, je soutiens qu’il faut le considérer comme toujours déjà satisfait et, par conséquent, espéré avec confiance plutôt qu’attendu dans l’angoisse. D’un point de vue théologique, ceci reviendrait à nous persuader, à nous faire savoir que nous sommes aimés d’un amour absolu par un être en présence de qui nous sommes et nous trouverons encore. Le bonheur qui imprègne le Cantique nous aide, ou peut nous aider à ressentir, à connaître qu’il en va effectivement ainsi et que ce même amour est donné au monde dont nous sommes partie. J’ajouterai que certaines lectures font de ce vécu érotico-spirituel, auquel le Cantique nous invite à nous joindre, quelque chose qui ressortit à des concepts de souveraineté, de domination, d’autorité, de mise en sujétion d’un être par l’autre (ce qui est effectivement contenu dans la plupart des textes dits religieux du monde occidental). J’en conclus que le rapport de force qui vaut loi dans les schémas de sexualité comme de religion que nous avons faits nôtres, domaines dans lesquels l’un et l’autre système de domination se confortent mutuellement, a tragiquement aveuglé ceux qui s’y tiennent, au point même d’exclure toute alternative. L’extraordinaire, dans le Cantique, c’est précisément l’absence de toute hiérarchie de structure et de système. On ne détecte ni souveraineté, ni autorité, ni surveillance, supériorité ou soumission dans les liens qui unissent les amants et les attachent à la nature : le berger peut jouer au roi, et vice-versa, tout comme des humains jouaient des rôles de dieux lors des mariages sacrés célébrés au cours de rites païens dont ces chants sont peut-être le produit dérivé.
*
Matinée d’août, en haut de Broadway
Extraits de Waiting for the Light: New Poems, 2015.
Tout comme le corps de l’être aimé est ouverture
avec vue sur la noirceur et l’immensité de l’espace
où bat un cœur d’étoiles ; tout comme
au coin de la rue l’étal de fruits et légumes
est vitrail où cerises, mûres, framboises
avocats et carottes arrangés en rosace
évoquent Chartres, oui, ou celle de Notre-Dame
quand le jour de l’au-delà s’y déverse sur Paris et, pur,
plonge au cœur du touriste sa joie pleine et facétieuse
même si le marchand fatigué par la canicule
lit son journal sans le lire, sans enthousiasme
et si les passants ne lui achètent rien
disons que nous avons là une fenêtre ouverte
non sur un paradis mais sur ce que pourrait être
un paradis si nous avions des yeux pour y voir
les femmes jouant de la robe, les fruits de saison
bébés moelleux à souhait dans leur poussette : facettes
de clarté dans la clarté.
Exercice de Style
En exergue du poème que nous traduisons ci-dessous, Alicia détourne une citation (qui a aussi inspiré une pièce de théâtre de Naomi Wallace intitulée Things of Dry Hours, 2004) de Gwendolyn Brooks et imite le genre dit Golden Shovel inauguré par Terrance Hayes en 2014, à partir d’un autre poème de Brooks intitulé « We Real Cool ». L’exercice consiste à terminer chacun des vers d’un nouveau poème par un mot pour rebâtir le texte d’origine. Acrostiche à droite, en quelque sorte.
Citation de Brooks : « Kitchenette Building », 1963, (sur les années de la Dépression) :
We are things of dry hours and the involuntary plan
Grayed in, and gray. “Dream” makes a giddy sound, not strong
Like “rent,” “feeding a wife,” “satisfying a man.”
Traduction de Brooks:
Nous sommes faits de jours sans et de prêt forcé,
Gris à cœur, tout gris. « Rêve » sonne de travers, moins fort
Que « loyer », « épouse à nourrir », « homme à satisfaire ».
Dry Hours : A Golden Shovel Exercise
extrait de «Waiting for the light: New poems », 2015.
Exergue détourné par Alicia :
We are things of dry hours and the involuntary plan,
Grayed in, and gray. “Dream” makes a giddy sound, not strong
Like feeding a husband, satisfying a man.
Reprise du détournement :
Que « nourrir un époux », « satisfaire un homme ».
Il y aura donc 28 vers, en français comme en anglais.
Jours sans : Truelle d’Or, coup d’essai,
Gwen, tu es de Chicago, mais pas ma famille, nous
venons de New York, mais tous nous sommes
au courant de la Dépression. Tu te souviens des faits :
Roosevelt et notre pays pendant les années de
crise en trente ? Le galop d’essai des cent premiers jours
du New Deal. Les conseillers au travail huit heures sans
interruption. Secours, reprise et
réforme : Loi Glass-Steagall pour mater les banques, plans de
plein emploi. Même pour les artistes. Puis il a fallu être prêts
pour la guerre à faire aux Nazis. On nous y a forcé,
Et ça a marché : nous avons gagné. Et le gris
des actualités des années quarante, le noir mis à
nos carreaux en ville qui peut oublier cela ? Même touchée à cœur
tel Whitman après la guerre de Sécession tout
en toi se demandait si le gris
n’allait pas empêcher la réalisation du rêve,
si le capitalisme n’allait pas être derrière le glas que l’on sonne
pour chaque rêve pourri, sans compter les fruits amers et les hordes de
loups ivres de mort. Aucun bruit pour se mettre en travers
des coups infligés aux corps et encore moins
de gémissements dans les chênes forts
et vigoureux où les pendus n’étaient guère que
quartiers à la devanture du boucher. Qu’est-ce qui pouvait se nourrir
de telles horreurs ? Gwen, y a‑t-il eu un
flux de libido qui ait pu exciter un époux ?
Assister à un lynchage pouvait-il satisfaire
une femme en rut autant qu’un
appétit d’homme ?
Dans les poèmes traduits, le traducteur a, autant que possible, suivi l’auteur dans sa ponctuation, au risque de dérouter, le cas échéant.
- William Blake, The Tyger, Dylan Thomas, Do Not Go Gentle… - 7 juillet 2024
- John Donne : Lettres, Être et amour - 1 juillet 2022
- Un Américain à Séville (1) - 4 juillet 2021
- Un américain à Séville - 6 novembre 2019
- Un américain à Séville (5) - 6 septembre 2019
- Un Américain à Séville 4 - 4 mai 2019
- Un Américain à Séville (3) - 3 mars 2019
- Un Américain à Séville (2) - 4 janvier 2019
- Quintan Ana Wikswo et Margo Berdeshevsky - 5 mai 2018
- BAL(L)ADES EN IRLANDE - 6 avril 2018
- John Donne : Lettres, Être et amour - 26 janvier 2018
- Un Américain à Séville, 2 - 3 décembre 2017
- Du Dialogue amoureux - 16 octobre 2017
- Un américain à Séville : Annexe 1 - 5 octobre 2017
- Un américain à Séville : annexe 2 - 4 octobre 2017
- Alicia Ostriker, choix de poèmes traduits et présentés par Jean Migrenne - 30 juin 2017
- James Emanuel : poèmes traduits et présentés par Jean Migrenne - 26 juin 2017