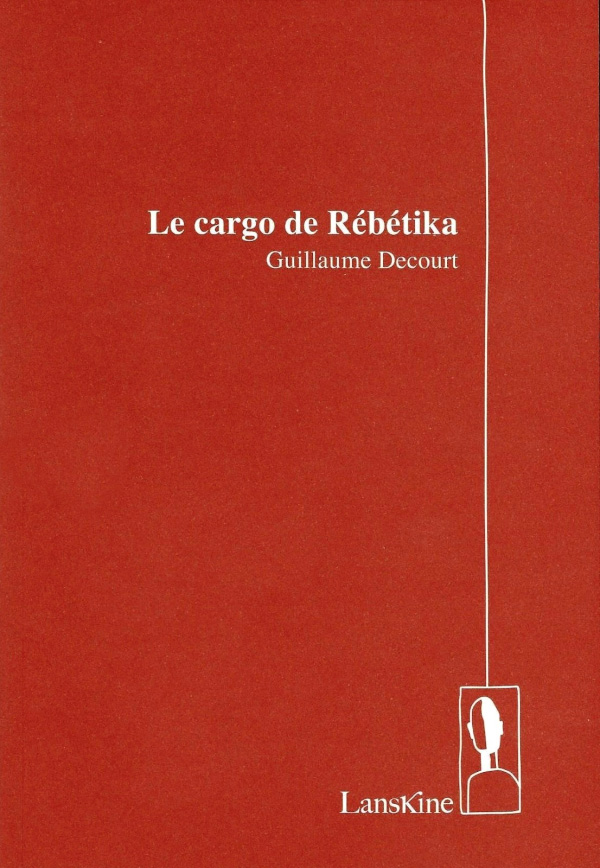Olivier Apert, Si et seulement si
Si et seulement si, le dernier livre de poèmes d’Olivier Apert vient de paraître aux éditions LansKine. On l’attendait depuis Upperground, La Rivière échappée, 2010. Riche rhapsodie dodécaphonique qui mène tout droit à une espèce de sérialisme expressif. L’ouvrage est composé de 9 parties qui se répondent et s’annulent les unes les autres comme autant de rebonds et d’échos contradictoires. 9 mouvements pour un livret d’opéra en forme de soliloque, à psalmodier sans musique, donc (rappelons qu’Olivier Apert est également librettiste, Oreste & Œdipe, musique de Cornel Taranu, Grand prix national de musique en Roumanie, 2008).

Olivier Apert, Si et seulement si,
LansKine, 2018, 112 p., 14 €
Tous les états mentaux y sont consignés, de la joie la plus pure à la détresse la plus transparente, toujours sertie d’ironie et de mise à distance ; détresse qui devient blanche et nécessaire, ainsi que l’ivresse : Ivre la nuit/Quand nul oiseau ne vient/lécher le lait des étoiles ». Le mystère, s’il y a, ne gît plus dans l’obscurité mais bien dans un excès de lumière. Le poète (celui qu’on nomme affreusement le « vrai poète » pour l’amplifier absurdement, selon Olivier Apert) doit laisser des preuves de son passage, non des traces, n’en déplaise au capitaine Alexandre :
Dans la fente de la valleuse – au volant d’une Triumph TR5
(modèle rouge tifosi de 1969/ 2498 cm3 150 HP & overdrive)
décapotant le ciel de Vasterival juste au bord de la falaise
je frôle l’Ange B. – effrayé par l’idée que sa chevelure en écharpe
d’écume vienne soudain s’emmêler aux roues à rayons chromés :
CE N’EST PAS AINSI QUE J’AVAIS PRÉVU D’EN FINIR
Olivier Apert ne larmoie pas en souriant. Il ne se niche pas entre deux seins. Il a appris à vendre, à acheter, à revendre. Il prend son bain. Il a pratiqué comme il se doit la tabula rasa sans pour autant ébranler certains fondements rupestres nécessaires à toute formulation qui tranche net. L’Ange B., figure qui l’accompagne au gré de ces pérégrinations dans la voûte Equatorial stars, c’est bien l’ennemie, l’étrangère, présence dans le miroir, en arrière-fond de la casemate, une voix rappelle sotto voce certaines ordonnances Baudelairiennes : « le dandy doit vivre et dormir devant un miroir ». Baudelaire auquel Olivier Apert a d’ailleurs consacré un essai singulier : Baudelaire. Être un grand homme et un saint pour soi-même, Infolio, 2008.
Dans la partie « Jocaste, Complexe (de) » il s’adonne à de subtiles variations sur le négligé complexe de Jocaste, inverse de celui d’Œdipe, libido de la mère envers son fils :
bis : la bonnéducation((bis : le-dos-contre-le-dossier-pas-de-coudes-sur-la-table)) induit la bonnesituation (profession
libérale obligée) du moment qu’invisiblement elle arbore le
« petit costume »((en tapinois, le costume anthume-posthume)) hurlant in pettosous la triplure :
avanti madonna
alla rescossa
avocati negri
trionféra
& puis surtout : « les-amis-ça-ne-sert-à-rien »
ou quelque chose du sale même genre qui chaque jour invente
la solitude paradoxale : l’art de ne pas vouloir se faire aimer,
afin de mieux s’en plaindre – entre 4 murs projetés palataux
Dans la partie « Hommage de l’Auteur, absent de Paris », on entend comme un « donne prends donne prends », échos mats des poings sur le punching-ball d’une littérature contemporaine asphyxiée par elle-même. Nicolas Bouvier disait que « la poésie, c’est du full contact ». Olivier Apert la met groggy par le biais d’une illustration choisie, photographie représentant une maison de retraite ayant pour enseigne : « La Poésie ». L’ouvrage s’achève insolemment sur des chansons « The best that money can buy » et une citation de Churchill : « Le succès, c’est d’aller d’échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Chansons écrites pour le musicien et chanteur David Tuil, ayant donné lieu à un album, Femmoiselles, Production Littérature & Musique.
Olivier Apert y fait preuve d’une invention et d’une délicatesse de versification peu commune, leçon d’efficacité dont bien des auteurs contemporains devraient s’inspirer :
que dirais-je louise
si j’avais à vous voir louise
je dirais louise
comme j’aimerais vous revoir louise
et même louise