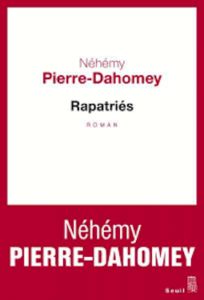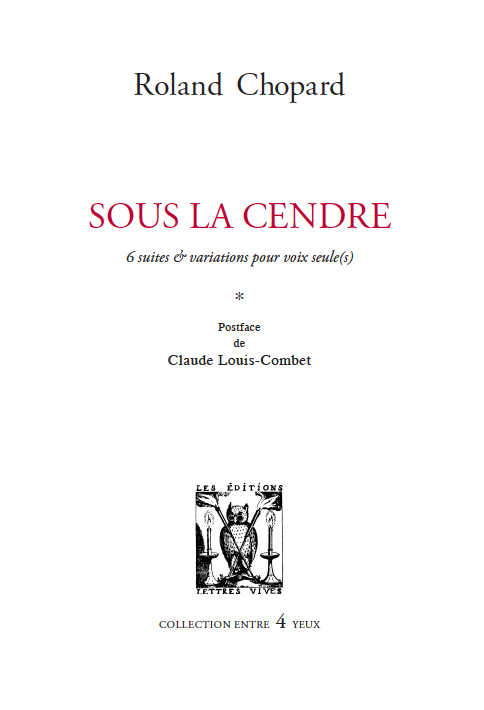Marie-Paule Farina, Sade et ses femmes, correspondance et journal
Tout le monde connaît le Marquis de Sade. Tout le monde ? Non. Tout le monde connaît la réputation et le nom lié à cette réputation. Qui l'a lu, et qui a lu ses livres les plus licencieux en est sûrement resté, (s'il ne s'est intéressé aussi à l'homme avant l'écrivain), à ce qu'on lui a reproché et ce pour quoi il a été condamné, après avoir laissé une grande œuvre - aujourd'hui en Pléiade - son libertinage et la perversité de ses écrits.
Sade est-il celui qu'on croit ? Pour avoir si souvent exposé des femmes soumises et humiliées dans ses romans, il passe pour l'homme le plus misogyne de la littérature française.
Ceux qui, comme Marie-Paule Farina sont allés un peu plus loin que la lecture de la licence, savent que sous l'épaisseur de la fange dans laquelle on a noyé ce personnage car c'était bien un personnage romanesque, on peut découvrir à travers ses notes, journaux et surtout correspondances qu'il était bien autre chose qu'un pervers, un violeur, un assassin, bref un être dangereux et peut-être même tout le contraire de cela.
Marie-Paule Farina, professeur de philosophie et essayiste s'est intéressée à l'homme, avec tendresse, et a mis un point d'honneur à réhabiliter un individu qui fut sans doute bien de son époque – le XVIIIe siècle n'est-il pas un siècle libertin, licencieux – comme beaucoup d'autres mais il était lui, sans fard, pour tout dire, inapte à la dissimulation ; peut-être même était-ce là son principal défaut. Ne rien cacher, tout dire, se montrer au naturel, tel qu'en lui-même, un homme qui aime le sexe et ne s'en cache pas.

Marie-Paule Farina, SADE et s
es femmes, Correspondance et
journal, Editions François
Bourin, 2016.
Mais avant cela, il a été un bel enfant blond aux yeux bleus, doux et charmeur, charmant et tendre, entouré, beaucoup et beaucoup aimé des femmes nombreuses qui s'occupaient de lui, très tôt.
A travers cette correspondance organisée suivant le déroulé d'une vie au tiers passée en prison, nous suivons le parcours d'un homme d'abord victime de lui-même, de sa naïveté, sa candeur bon enfant, ses étourderies (il parlait trop, disait tout) ses bêtises et ses nombreuses frasques sexuelles, ses amours passionnées et passionnelles (Melle de Lauris, La Colet, Chiara...) , le grand amour qu'il porta à ses femmes, la légale et la maîtresse, toutes deux sœurs, l'une, Renée-Pélagie, laide et l'autre, Anne-Prospère, très belle, une passion qui fit écrire à cette dernière bien imprudemment : « Je jure à Mr le Marquis de Sade, mon amant, de n'être jamais qu'à lui », et finira au couvent ; et sa meilleure amie Milli Rousset et encore tant d'autres, puis enfin la dernière, Constance.
Il fut surtout victime d'une abominable belle-mère instigatrice de tous ses procès et d'un acharnement du sort qui a fait que, souvent, les femmes qu'il aimait tant, se sont retournées contre lui.

Portrait supposé de Donatien Alphonse François
de Sade, par Charles van Loo, vers 1770.
L'auteur de cet essai dessine le portrait d'un homme qui fut plus victime que bourreau, plus tendre que sadique et victime décidément innocente ou comme il le disait lui-même, s'il est vraiment coupable de ce dont on l'accuse, dans ce cas, il ne paie pas assez, s'il est innocent, c'est bien trop cher payé.
Insolent et enfantin, pétillant de gaieté, les femmes le recherchent. Son château de Saumane où il a passé son enfance n'a rien à voir avec celui des 120 journées de Sodome, c'est plutôt « le rêve d'un château originel » médiéval et provençal, celui de la Laure de Pétrarque qu'il lit inlassablement depuis sa prison.
« Je suis comme un enfant, je lis tout le jour et la nuit je songe » écrit-il à sa femme.
Certes sa vie intime ne fut pas des plus sages et il ne niait pas aimer le sexe et la luxure. Il tenait un journal de ses masturbations et des pratiques des prostituées qu'il aimait regarder « en disciple des Encyclopédistes de Diderot, amateurs de « curiosités » ». Aujourd'hui on en rirait... quoique les censeurs ne sont-ils pas toujours à nos portes, prompts à nous empêcher d'en rire ?
[...]Oui je suis libertin, je l'avoue ; j'ai conçu tout ce qu'on peut concevoir dans ce genre-là, mais je n'ai sûrement pas fait tout ce que j'ai conçu et ne le ferai sûrement jamais. Je suis un libertin mais je ne suis pas un criminel ni un meurtrier « […] Je suis libertin, mais j'ai sauvé un déserteur de la mort, abandonné par tout son régiment et pas son colonel. Je suis un libertin, mais aux yeux de toute ma famille, à Evry, j'ai au péril de ma vie, sauvé un enfant qui allait être écrasé sous les roues d'une charrette emportée par des chevaux, et cela en m'y précipitant moi-même. Je suis un libertin, mais je n'ai jamais compromis la santé de ma femme. Je n'ai point eu toutes les autres branches du libertinage souvent si fatales à la fortune des enfants : les ai-je ruinés par le jeu ou par d'autres dépenses qui aient pu les priver ou même entamer un jour leur héritage ? Ai-je mal géré mes biens, … ai-je en un mot, annoncé dans ma jeunesse un cœur capable des noirceurs dont on le suppose aujourd'hui ? ...
Il demeure un enfant quand, emprisonné, il demande à ses femmes (la sienne et Milli qui lui écrivent régulièrement) de le faire rire, de lui raconter des fariboles et rajoute-t-il : « que suis-je ici sinon un enfant » » « il faut avoir de dix à quinze ans pour être ici. Moi, tel que vous me voyez, je n'ai que onze ans ; aussi je m'en trouve fort bien »
« Dès Vincennes, [c'est à dire, dès sa première détention, ndlr], et quoi qu'il en coûte, Sade veut être cet enfant résolu qui rit et dit « j'aime » quand on le déshonore ou lui donne les verges... et certains sont encore assez aveugles aujourd'hui pour le prendre au mot et ne pas voir ses larmes. », précise Marie-Paule Farina.
Avec les lettres de Milli, Sade s'amuse en effet comme un enfant quand elle lui conte des fariboles ou lui donne des cours de provençal. « Vous avez fait de moi un rossignol. Il faut que je chante ou que je meure ». Quelle phrase magnifique !
Au fil des correspondances, tendres, touchantes, malheureuses, colériques, drôles avec ou sans retenue, toujours sous le joug de la censure et marquées par la présence en filigrane des censeurs auxquels parfois les uns et les autres s'adressent, le style de Sade va se lâcher, s'agacer. Sa femme lui en fait reproche car ses facéties lui font retarder selon elle, un peu plus sa sortie, étant donné que c'est principalement à cause de son supposé comportement dépravé qu'on l'a emprisonné.
Ces mêmes censeurs dont la bêtise va jusqu'à lui refuser Les Confessions de Rousseau et laisser passer Lucrèce et les dialogues de Voltaire. « Partez de là, messieurs, et ayez le bon sens de comprendre, en m'envoyant le livre que je vous demande, que Rousseau peut-être un auteur dangereux pour de lourds bigots de votre espèce, et qu'il devient un excellent livre pour moi. »
Au fil des mois, des années, l'emprisonnement sensé le soigner de sa perversion n'aura fait qu'aggraver son cas, libérant de plus en plus son malheur et sa révolte contre ces hypocrisies, cette injustice dont il est victime quand des hommes bien pire que lui se cachent pour des turpitudes plus graves.
Par bigoterie, par jalousie, par méchanceté ou même cruauté, Madame la Présidente l'a fait emprisonné dès le début sur de faux prétextes liés à ses activités sexuelles (prostituées).
S'adressant aux censeurs il dit :
Vous avez imaginé faire merveille, je le parierais, en me réduisant à une abstinence atroce sur le « péché de la chair ». Eh bien, vous vous êtes trompés : vous avez échauffé ma tête, vous m'avez fait former des fantômes qu'il faudra que je réalise, ça commençait à se passer, et cela sera à recommencer de plus belle. Quand on fait trop bouillir le pot, vous savez bien qu'il faut qu'il verse. Si j'avais eu Monsieur le 6 (n° de sa cellule), je m'y serais pris bien différemment, car au lieu de l'enfermer avec des anthropophages, je l'aurais clôturé avec des filles ; je lui en aurais fourni un si bon nombre que le diable m'emporte si, depuis sept ans qu'il est là, l'huile de la lampe n'était pas consumée !
À chacune de ses premières sorties de prison sa belle-mère trouvera un prétexte pour le faire de nouveau emprisonné, voulant le séparer de sa famille à laquelle il aurait pu nuire. À chaque fois il perdra beaucoup de ses livres, de ses manuscrits, de ses biens et de ses amis.
L'accumulation de malchance se poursuivra et il écrit ainsi à son avocat : « la journée du dix m'a tout enlevé parents, amis, famille, protections, secours, trois heures ont tout ravi autour de moi, je suis seul ».
Plus tard, avec la Révolution, le château sera pillé, il se retrouvera ensuite dans un grand dénuement et ce sera dans cette période que, pourtant, il publiera ses plus grands textes.
Même si on entend peu la Présidente, sa belle-mère dans ces pages de Correspondance, elle est omniprésente, car c'est elle l'instigatrice de tout son malheur et elle vampirise chacune des pages de cet ensemble, elle plane sur la vie de cet homme qui jamais n'a eu de véritables mauvaises pensées à son encontre et était tout à sa merci.
Très jeune, il avait appris à faire confiance aux femmes qui l'ont cajolé, entouré, aimé plus que de raison. Il en est devenu le jouet bien plus que le contraire. Ses écrits ne sont que libération d'une souffrance et quelle meilleure vengeance pour les femmes que cette vie dévouée à l'écriture dénonçant l'ignominie de certains hommes.
« Femmes, lisez de toute urgence, un homme tendre qui fait, le sourire aux lèvres, l'apologie du vice, ça libère dans un éclat de rire des hommes noirs qui, le couteau à la main font l'apologie de la vertu. » nous dit Marie-Paule Farina en conclusion.
*****
Ces jolies personnes, me dit Zamé, en me montrant les trois amies de la famille, vont vous faire croire que j'aime le sexe ; vous ne vous tromperez pas, je l'aime beaucoup, non comme vous l'entendez peut-être. Les lois de mon pays permettent le divorce et, cependant, continua-t-il en prenant la main de Zoraï, je n'ai jamais eu que cette bonne amie et n'en aurait sûrement point d'autre. Mais je suis vieux, les jeunes femmes me font plaisir à voir, ce sexe a tant de qualités !
Sade, Aline et Valcour, La Pléïade, t.1, p. 616 (cité par MP Farina dans son ouvrage)