Florence Trocmé, P’tit bonhomme de chemin
Une réussite que ce livre de Florence Trocmé que la communauté poétique connaît dans un autre rôle que poète à proprement dit. Livre dense, généreux, subtil, singulier, bref intéressant. L’auteure « reprend ici à son compte un récit méconnu de Jules Verne, P’tit Bonhomme, qui relate le périple d’un orphelin au temps de la domination anglaise et des famines en Irlande, au XIXè siècle. »
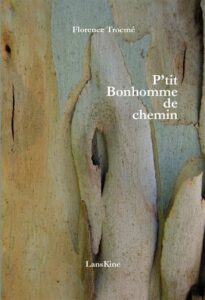
Florence Trocmé, P’tit bonhomme de chemin, éditions Lanskine, 2121, 14 €.
Des notes essaiment d’un bout à l’autre du recueil, renvoyant à des citations d’auteurs contemporains (de Proust à J.C Bailly en passant par Walter Benjamin), à des articles de journaux, des émissions radio, des expositions récentes, des sources Wikipédia, et même à la correspondance privée de l’auteure. « Comme pour tout vrai conte, on / n’en épuise pas le sens (…) ». Comme il est rappelé, toutes les citations en italiques non référencées sont tirées du P’tit bonhomme de Jules Verne, en filigrane tout le long du texte. Les associations d’idées chez Florence Trocmé résident dans une confrontation de son ressenti à celui du grand auteur, en trempant sa propre sensibilité dans la sienne comme on le ferait d’un acier pour ajouter à sa dureté. Ses références culturelles et artistiques afin de dresser un portrait de ce « p’tit bonhomme » selon son image, font briller des valeurs à l’abri des grands principes dissouts dans ce qu’on pense d’époque en époque comme l’élévation du niveau de conscience.
Le poème prend forme par des vers justifiés plutôt courts en des paragraphes comme des aplats espacés sur la page par des respirations. Malgré tout un fil rouge est visible dès le début pour mener le lecteur à la suite d’une pensée qui s’autorise d’elle-même avec ses apartés, ses aspérités rencontrées sans qu’on se perde puisque par nature la pensée s’éparpille pour revenir à soi-même, créant ainsi au fur et à mesure son « p’tit bonhomme de chemin ». C’est donc en toute quiétude qu’on chemine dans le paysage intérieur de Florence Trocmé (ou ce qu’elle nous en laisse voir). La révélation derrière le rythme, le ton et le phrasé s’annonce dès le début : « Né de personne, fils de rien et de rienne, / P’tit bonhomme qui donc t’a craché tout seul / À la face du monde tout nu sans rien. (…) Sauve-toi vite fait, sauve-toi, allez P’tit / Bonhomme, poudre d’escampette par le / Chas, file, hue&dia, file, plus jamais cette / Vieille Hard, ne regarde pas en arrière, / Fonce au creux du noir (…) » Le vers coule mais cingle.
C’est l’histoire d’un livre qui ne pouvait pas s’écrire sans un sentiment de révolte tel qu’il suscita chez Jules Verne l’écriture de son P’tit Bonhomme. Florence Trocmé fait du héros livresque l’instrument de l’innocence en tant que seule révolte possible. Le poème rachète cette inertie négative, montrant qu’innocence et fragilité sont des forces allant à l’encontre de ce qu’on nomme ici ou là l’échec de la littérature devant la violence, l’injustice et le désespoir. « P’tit bonhomme, n’est-ce pas ce que j’essaie de faire ici, te donner forme et vie nouvelles ? » Dans la mesure où un héros sur le papier est l’incarnation de l’esprit de son temps, c’est tout naturellement que Florence Trocmé lui redonne souffle et vie, en rappelant combien la poésie qui refuse cet échec est une alternative dans cet espace médiatique aux images de plus en plus calibrées. A coup sûr ce « p’tit bonhomme de chemin » garde l’empreinte d’une grande liberté.






