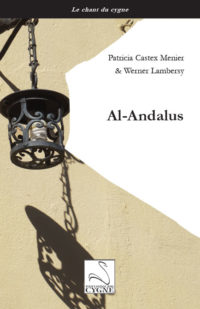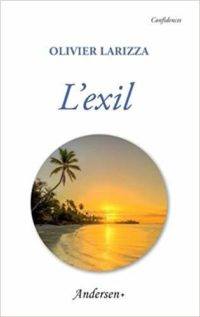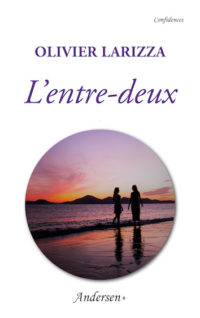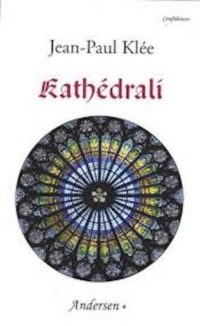Vincent Motard-Avargues, Je de l’Ego « Narration entaillée »
« Narration entaillée », Je de l’Ego, l’image d’un « radar » en guise de première de couverture illustre heureusement le chant du cygne (nom de la maison qui publie le livre)/le champ poétique ici livre par Vincent Motard-Avargues.
Morceaux d’une existence disloquée comme des rémanences rétiniennes sur/sous les paupières mi-closes d’une vie, d’une conscience pour l’heure adossée/en arrêt/en sursis…
La fête sauvage électronique bat son plein. Les basses fréquences
font trembler le sable de cette forêt proche de l’océan.
Sous l’emprise d’un acide, Noé Vida ne peut plus bouger d’un cil.
Adossé à un pin, sa vie lui revient brutalement, par flashs syncopés,
Hachés. Ses multiples identités, ses Je sans moi.

Vincent Motard-Avargues, Je de l’Ego « Narration entaillée », éd. du Cygne, 91 p., 12€.
État hallucinatoire ; vie hachée menue (provisoirement) visionnaire. Comme des images du monde visionnaire, michaldiennes (ici le Je remue comme La nuit remue de Henri Michaux).
Et Noé Vida porte bien son nom.
Comme on porte le vide d’une existence en sursis, -en rémission ? Comme ce vide peut porter une non-vie, un plein-creux dans la richesse abandonnée/dépouillée d’une Arche-de-Noé dans la traversée vers quel "Siddharta (ou presque)" après le déluge, vers quel "polder d’homme", quelle "prison", quels "demain", quels "Danses et Chants", quelle « Paix » ?
Vers quel Je de l’Ego d’où jaillit l’existence se rebâtira la solidarité de solitudes « sans racines », brisées dans leur singularité, îles dépossédées de leur archipel ?
La voix de Vincent Motard-Avargues entaille la narration dans l’espace de la page où le temps se fracture et reconstruit la fatigue des mots en même temps que les mots édifient le sens de ce qui passe/fuit/se délite.
tu avais du sans
pleines mainsyeux d’ambre
ête d’océan
acouphènes d’absencesd’autres couraient
au long
des aubes
sèchestoi tu vacillais
via tempes arides
du lieuoù demain ne
s’épelle plus
Je de l’Ego signe un road-movie initiatique. Des bouts de route/des bribes de chemins poursuivis ou interrompus, voire brisés, déroulent des séquences d’un Moi démultiplié en Ego décentré par l’(Im)permanence (titre d’un recueil de Vincent Motard-Avargues, paru en 2015 aux éditions Encres Vives). (Im)permanence du Si peu, Tout (éd. Eclats d’Encre, 2012) où l’existence s’appose, dans le
tout trop mouvements
en évidences pleinestu assommé ici
poids aux manqueseux accrochés là
meutes rythmiquestoi qui traces tu
en contours internes
où le vide, le plein creux, les multiples identités d’un Je sans moi
tout
défile défoule
tombe tourne
ressasse rappelle
revit s’échappetoi
enfant hommes
hommes passés
passé présents
présent futurs
où la vie en radar tourne autour de ses inutiles urgences, ses brèves de sécurité vaine par flashs syncopés, hachés puisque nous voyageons ici dans le road-movie d’une descente initiatique où le Je d’un anti-héros tente, broyé, en déliquescence, en état second, de ramasser d’un Ego Ce qui reste (revue en ligne créée par Vincent Motard-Avargues), ce qui va, émietté par la nuit, émietté par les mouettes de l’Envie, récolté par les oiseaux de la Vie.
L’évidence du cosmos et de soi est remise en question dans l’univers du poète. Rien ne va de soi. La logique des choses qui d’ordinaire se suivent et s’enchaînent est rompue, ainsi À ce qui est de ce qui n’a, comme L’Alpha est l’Oméga… Rien ne va de soi comme un Recul du trait de côte, Leurs mains gantées de ciel, Un écho de nuit où se ricoche la lumière dans la profondeur du silence et des ténèbres mystérieuses. De même que le réel fonctionne sur le principe des "Matriochka", le concept de structure gigogne, d’objets emboîtés, de même les poèmes de Je de l’Ego sont sécables dans les « plages de néant » formées par la page blanche, sans autres rives que celles du vide mais avec les mains pleines du sans (« tu avais du sans/pleines mains »), sur un « tempo disharmonique » pour tenter de saisir encore un bord où tenter de réunir
toutes ces heures
à courir après
minutes creusestous ces heurts
à attraper
coups de lune folle
L’objectif de la course du Je s’est perdu dans le vide des objets vainement (re-)cherchés, et cette vacuité le pulvérise en ses identités.
Je de l’Ego résonne dans le champ/le chant d’une déconstruction où
je
et
tu
pourraient s’imbriquer de façons aléatoires et modulables sur un tempo traversé de solitudes désolidarisées. Le hiatus de l’absence au cœur des êtres en présence coordonnent encore le manque, les ombres, les spectacles sans spectateurs (les corps de théâtre/machine à vivre/robot d’être) ainsi le lien encore établi par la conjonction de coordination « et » reliant les vers parfois monosyllabiques, formant une jointure entre les vibrations, une prothèse en place d’une cassure/fêlure, d’où surgit malgré tout
quelque chose
ô
quelqu’un
La foule fait masse –« un plein creux »- sous l’emprise du bruit de la fête sauvage électronique, sous l’emprise de l’acide, tandis que le Je du narrateur assommé s’accroche dans le creux de sa perdition aux lambeaux de silence assourdissant, aux morceaux de sa vie -ou non-vie- encore battante ; aux restes d’une mémoire traversée de « flashbacks » syncopés ; à ses voix écharpées « solo de mille chœurs ».
S’échappe pourtant encore un « bruissement d’êtres/au loin où l’/existence existe », résiste, pour que le Je de l’Ego se surprenne à rêver encore au bout de la nuit
oh oui
j’ai rêvéà une chambre moins
froideoù conserver sa terre
ocreet dormir apaisé
un peu