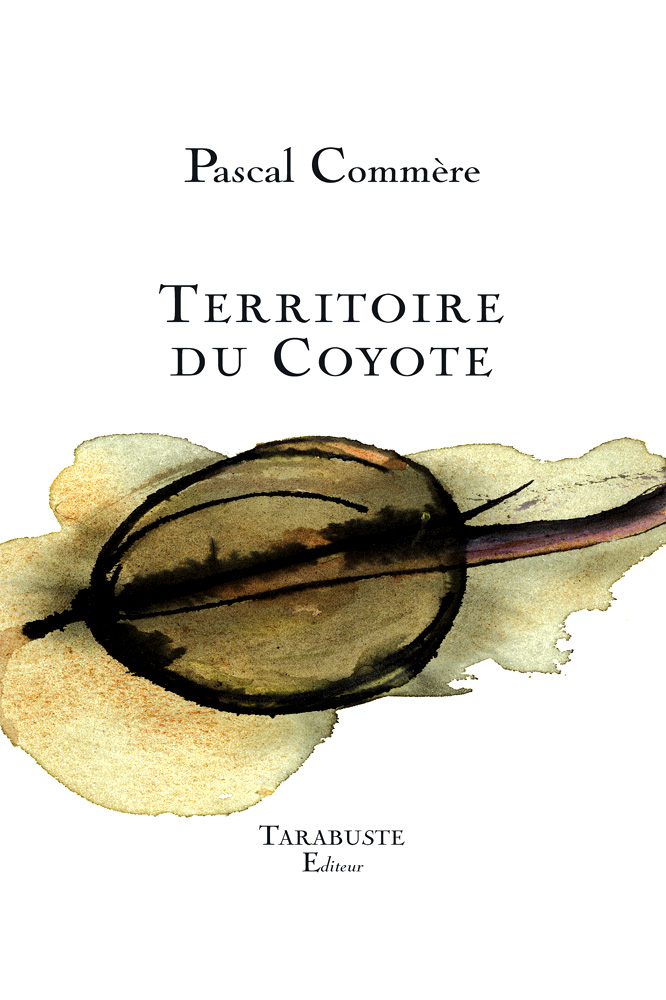Posture "injustifiable", tenue par Le rire triomphant des perdants((Le Rire triomphant des perdants, Cyril Huot, Éditions Tinbad ; 2016.)), vrillée à une inflexibilité existentielle, à l’exigence intraitable du courage, de la marginalité, de la solitude – au nom d’une vocation irréductible de la littérature à fonder et éclairer les voies du Langage, à écrire l’Histoire, à en consolider et augmenter l’édification / les édifices par ses ramifications de sève et de sang, radicales. Originelles. « (…) la littérature telle qu’on l’entend est née avec la Bible », rappelle Richard Millet.
Posture injustifiable dont l’Écrivain viscéralement ne se départ, guetteur invétéré d’une aurore possible, habité par cette injonction de "mort-survivant" :
Ne perds jamais de vue ce que dessinent les ombres dans le soir : ce sont les lueurs de la nouvelle aurore.
Car la mort est entrée sur la scène sociale, depuis que la littérature n'y est plus à sa juste hauteur, avec toute son envergure, représentée. Cette "petite mort", l'Écrivain la porte foncièrement, dans la difficulté d'être inhérente à la mise à mort de la littérature, cette façon d'être à elle seule, le Souffle entièrement. À bout, mise au rebut, elle atteint totalement, fondamentalement, celui qui la porte pour vivre, vit / se sent vivre de la porter.
Nous vivons dans une lumière d'étoile morte : tout est fini, la France, son histoire, sa langue, le monde qu'elle nommait. La littérature aussi. Nous ne faisons pas semblant d'écrire, voire d'être des écrivains, enregistrant jusqu'au bout le chant de l'étoile morte, sans être, nous, tout à fait morts.
L’auteur, entre autres, de L’Écrivain Sirieix, Le Dernier Écrivain, Désenchantement de la littérature, Arguments d'un désespoir contemporain, Le Sentiment de la Langue, Fatigue du Sens, part du postulat suivant lequel la littérature est entrée dans une agonie civilisationnelle et suggère que le déclin du langage et de la littérature auquel de nos jours nous assistons est sans doute lié à la fin du christianisme. Crise du langage positionnée dans une Ère littéraire exerçant son Verbe ailleurs, à un autre niveau, que celui de ce monde-ci « envers lequel nous devons être sans égards, puisqu’il a fait de la crise son mode d’existence parodique : crise financière, sociétale, morale, politique, culturelle, ethnique, sur fond d’attentats, d’ignorance, d’impolitesse, de mensonge, de fautes de goût, de guerre civile. La crise, me dira-t-on, est le mode d’existence de la littérature : sans doute, mais autrement, et à un autre niveau : l’ouverture, la béance, le possible, dans le refus de s’en laisser conter par les rhéteurs de l’aménagement langagier. » Après la « mort de Dieu », « le crépuscule des idoles », la « post-littérature » signe le moment d’un crépuscule. La déchristianisation de l’Occident, interroge Richard Millet, n’a-t-elle pas fini d’éteindre, après la genèse biblique, les pans de cette histoire du roman déjà abimés par les investigations de la psychanalyse, par les génocides et la toute-puissance de l’image ?
Dans Désenchantement de la littérature, en 2006, Richard Millet s’interrogeait sur la difficulté d’être d’un écrivain exigeant dans un monde (ce « monde-ci ») qui occulte, voire refuse, de plus en plus la littérature. En 2010, sa réflexion se focalisait sur L’enfer du roman vécu dans la post-littérature, à savoir une prédominance du genre romanesque, dévoyé, sans style et fabricant ses intrigues autour de sujets stéréotypés. Un formatage institutionnel, et institué, de la littérature telle que l’on ne l’entend pas. Dans Déchristianisation de la littérature, l’Ecrivain, par ailleurs rédacteur en chef de La Revue littéraire depuis 2015, constate que la post-littérature est un des signes de la fin de quelque chose et tente d’imaginer l’après : y a-t-il quelque chose après la littérature ? Cet essai nous interroge sur la posture à adopter face à cet abandon de la littérature : faut-il désespérer, alors qu’il reste « des gens capables de lire et d’écrire » ? En outre, des auteurs tutélaires tels que Homère, Pascal, Dostoïevski, Bataille (lequel se voulait sans égards vis-à-vis de ce « monde-ci »), Duras ne sont-ils pas ces vrais contemporains plus vivants que la plupart des écrivains actuels, « déjà dépassés avant d’avoir vécu » ?
Qu’est-ce que l’Après ? Après quoi ? Après moi le déluge ? Qualis artifex pereo ? Il y a eu une première littérature de l’Après : la poésie après Auschwitz -de l’ordure, selon Adorno ; et le roman, impossible et néanmoins bien là, Bataille, camus, Beckett, le Nouveau Roman, et aussi la belle génération poétique née dans les années 30… On ne mettra pas sur le même plan l’événement absolu qu’est Auschwitz et la coupure civilisationnelle que représente la mise à mort de la langue par « Mai 68 », via l’enseignement. Pourtant, dans le renoncement au paradigme littéraire, à l’histoire de la langue et à son sentiment esthétique et religieux, il y a plus qu’un fossé générationnel : une sorte de damnation volontaire, qui fait de l’Après une actualisation de la Chute, à tout le moins du vertige devant le gouffre au-dessus duquel beaucoup voudraient planer, tandis que les vrais écrivains s’efforcent de bondir par-dessus le temps.
Chute de la littérature orchestrée par un nivellement culturel qui revoit la littérature "à la baisse", la perte d’une "plus-value" littéraire due à la possibilité contemporaine de publier à tout-va ce qui ne ressort pas justement à la littérature (le packaging consensuel international marqué du sceau de l’insipide), une popularisation de la scène littéraire où les imposteurs paraissent sans doute et pérorent plus nombreux dans le goût d’un public en attente de séductions artificielles (ndla)… Dans cet essai, la position de Richard Millet ne s’assoit ni dans le confortable, ni dans le consensus, ni dans le compromis, ce qui explique en partie les réactions parfois hostiles à sa réflexion, l’accueil de ses livres par le silence unanime de la pensée instituée, officielle, menée par les zélotes du pouvoir culturel.
Comment ne pas être emporté par la Chute qui nous entraîne vers le crépuscule, comme elle entraîne l’extinction de la littérature ? Des résistances ne pourront-elles pas allumer de nouveau le ciel, via de vraies voix d’outre-tombe, et redonner profondeur à l’horizon ? En d’autres termes, la littérature refera-t-elle sens, libérée de ses imposteurs ?
Mais, peut-être plus crucialement, « Quelle peut être la destinée de l'art dans une civilisation qui repose sur le mensonge ? ». Cette question, Walter Benjamin la posait déjà au début du 20e siècle - « son suicide », note Richard Millet, « donne en partie la réponse ». Comment continuer d'avancer à contre-courant ? Tout en ne se laissant pas déporter par la folie ou emporter par le suicide ? Comment vivre dans l'agonie -ou ce qui est peut-être déjà la mort- littéraire lorsqu'écrire s'exécute comme respiration ?
En écrivant cette « espèce de journal » sans doute Richard Millet résiste-t-il déjà, se positionne dans la marge des pages, contre. Écrire, de plus, écrire dans l'éclat du fragmentaire, met à distance un présent tyrannique escorté de son arsenal de leurres et tartufferies. Écrire, exutoire, issue de secours permettant de sortir du marché de dupes. Aller dans la fraîcheur de la répétition, par le ressassement, au plus obscur de ce qu'il reste à connaître, à l'encontre des marques de l'époque légiférante, loin du bruit assourdissant de ce qui, corps et esprit creux, s'agite sans agir, dissone sans résonances. En termes hölderliens nous pourrions dire que l'Écrivain n'habite plus un monde dont la demeure du langage est devenue vide (Richard Millet évoque une « maison abandonnée »), s'est vidée au profit du divertissement interactif, « images, jeux vidéo, formes narratives brèves comme les hakaï narcissiques de Tweeter, et tout ce qui relève de la fruition échangiste du présent. » Nous sommes entourés par une société du Spectacle((La Société du Spectacle, Guy Debord (1967).)), « sommés d’adorer le veau d’or le divertissement général. » Guy Debord décrivait en 1967 l’emprise du capitalisme sur le monde à travers la marchandise ; Richard Millet montre comment via sa déchristianisation la littérature a perdu sa valeur, sa raison d’être, au profit du Spectacle nous distribuant (et nous conditionnant dans) ses accumulations d’images vidées de transcendance, détournées de l’Inventivité. Ce qui ne signifie guère que l'Écrivain s'en remet à la nostalgie, son regard et le ressassement de la notation n'exerçant pas de retour, de détour rétrograde ; la nostalgie constituant comme les simulacres sociétaux une illusion d'optique. Comment dès lors relie-t-il sa vie extérieure avec la quête de l'absolu poursuivie par l'écriture ? Quête, soit, par essence vouée à l'échec ainsi que l'a souligné Blanchot, mais l'expression du néant, ou du non-sens absolu, la montée aux enfers expérimentée par l'écrivain, exalte une ambiguïté inscrite dans la parole littéraire. Expérimentant une activité « injustifiable », l'écrivain ne cesse d’ « augmenter le crédit de l'humanité […] il donne à l'art des espérances et des richesses nouvelles […] il transforme en forces de consolation les ordres désespérés qu'il reçoit ; il sauve avec le néant. » ((Faux pas, Maurice Blanchot (1943).))
Richard Millet par cet essai sur la Déchristianisation de la littérature ne la sauve-t-il pas en la sortant des oubliettes et en la restituant dans ses splendeurs, ses aléas, ses droits ? Dans ses fondements judéo-gréco-latin, éclairant la concomitance de la fin de la littérature et de la déchristianisation de l’Occident. Ces considérations actuelles intempestives motivent une « Espérance », indubitablement, "révélée" ici par l’écriture fragmentaire.
D’outre-tombe, et ad aeternam, -au-delà d’une civilisation morte de sa littérature morte- de vrais auteurs comme l’Écrivain continueront d’écrire, sans se taire. Ayant recueilli seuls, dans leur paume, « l’écho de l’origine des langues », passant par leurs lecteurs éternels la frontière du temps.