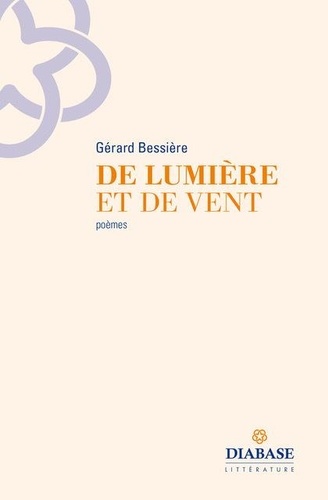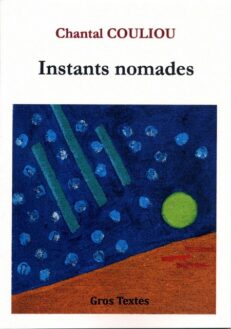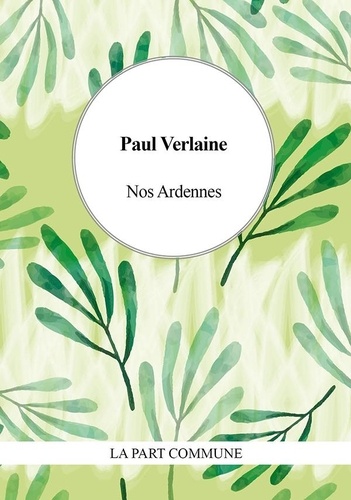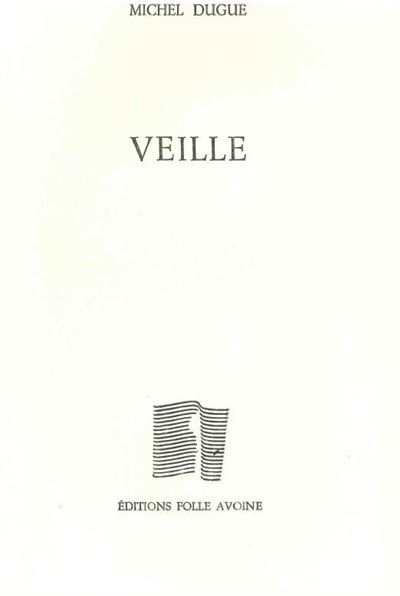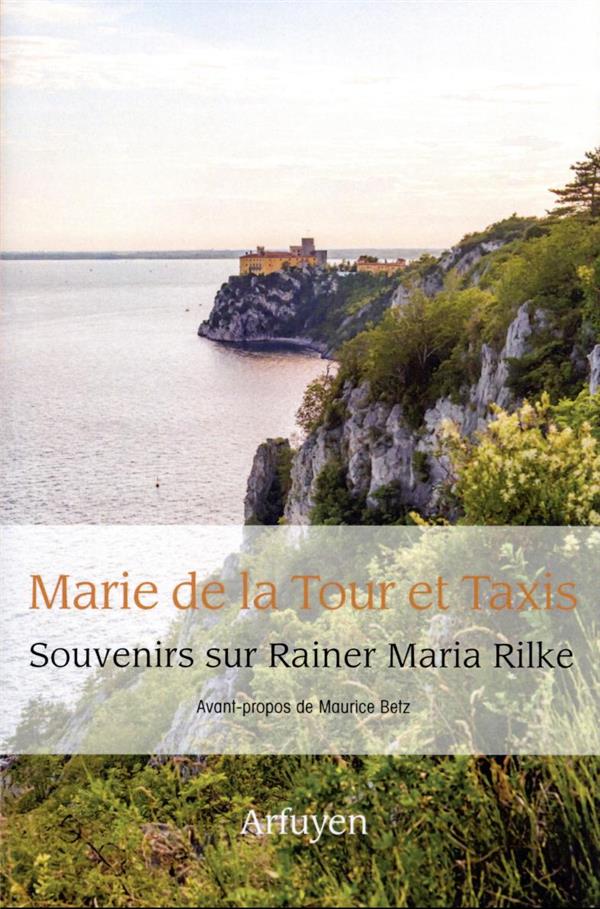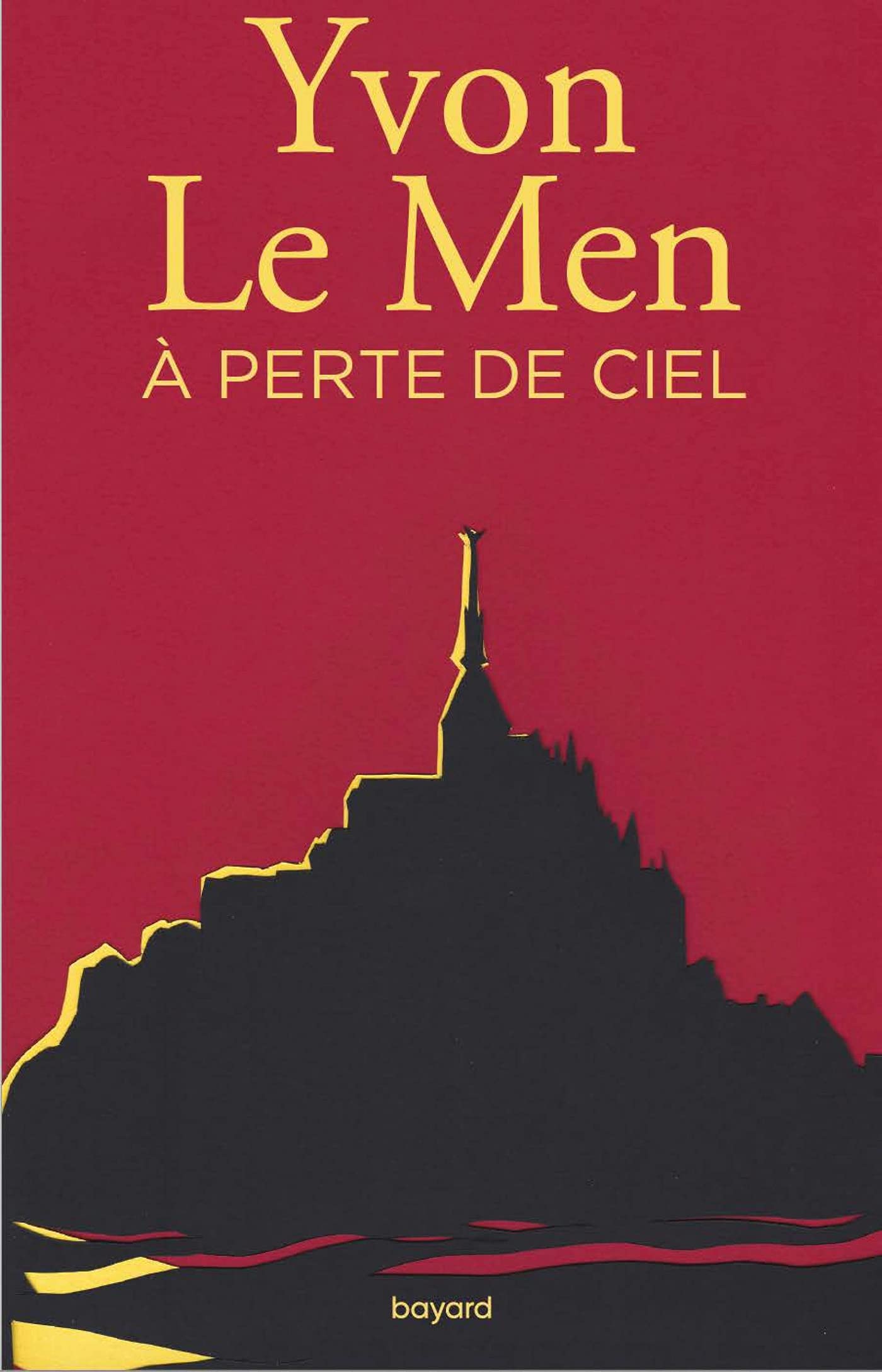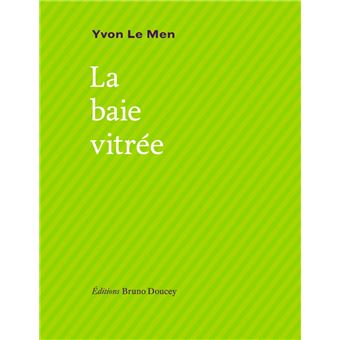Claude Serreau, Réviser pour après
En publiant ce nouveau recueil, il dit « mettre un point final » à ses « prétentions d’écrire ». Le Nantais Claude Serreau (91 ans) est un poète fécond. « Face au grand âge devenu », il annonce vouloir tourner la page. Mais peut-on se passer vraiment du « démon » de l’écriture ? Le concernant, plutôt que de « démon », il faudrait parler de « bonheur » de l’écriture. Son nouveau et dernier livre le démontre une fois de plus.
« J’engrange de l’amour/tout ce qui se partage/un soleil habité/de ces rires majeurs/où le matin s’invente ». Claude Serreau est du côté du « oui » à la vie. Il l’exprime notamment dans une série de « Dix poèmes à C… ». Mais ce chant d’amour, que l’on suppose adressé à l’être aimé, embrasse tout ce qui palpite « dans l’instance des jours ». Les accents fraternels du poète rejoignent, une nouvelle fois, les intonations de René Guy Cadou à qui il fait allusion dans l’un de ses textes (« Son corps avait gardé/d’enfance sous la guerre/une haine du froid/de l’ombre et de la nuit… ») Claude Serreau, lui aussi, opte pour la lumière « égarée quelque part/vers l’ouest ». Il entend, comme il l’a toujours fait, poursuivre « un chemin de ferveur/sans failles ni hasards ».

Claude Serreau, Réviser pour après, Des sources et des livres, 90 pages, 15 euros.
Des souvenirs d’enfance reviennent aussi par bouffées (« Mon enfance est à tout le monde », écrivait René Guy Cadou). « Dans la Vendée de ce temps-là/patrimoniale bocagère, note pour sa part Claude Serreau, Le clocher toujours s’égrenant/sur les âmes et les clairières/on vivait de petite épargne ». Ailleurs surgissent des sensations olfactives : « L’odeur des autocars/m’est restée d’une enfance/au bord de la grand-route ». Mais le poète ne s’attarde pas. S’il regarde dans le rétroviseur, c’est plutôt pour effectuer une forme d’introspection en forme de bilan. « Lire écrire afin d’espérer/qu’il en reste quelque chose/un cahier un livre épargné/retrouvé au hasard des ans/sous la poussière d’un grenier ».
Claude Serreau ne cultive pas la nostalgie, ne ressasse pas des regrets. Il cultive plutôt l’art du détachement. « Mon âge a ses musées/solitaires et vains ». Il nous parle de sa « vie maraudée » et livre « au soir du saut dans l’inconnu » une forme de testament littéraire pour « échapper au pouvoir des ombres ». Plus encore, il nous indique un chemin que ne renieraient pas les plus grands sages. « Chaque instant sera bien à prendre/au foyer du cœur loin du bruit ». Et si ce sont vraiment les derniers mots du poète, accueillons-les avec joie et gravité, manuscrites à la dernière page de son livre : « Ecoute les violons du monde descendre/au grave de leurs harmonies/quand c’est l’heure et que tout est dit ».