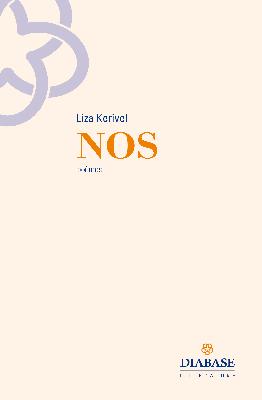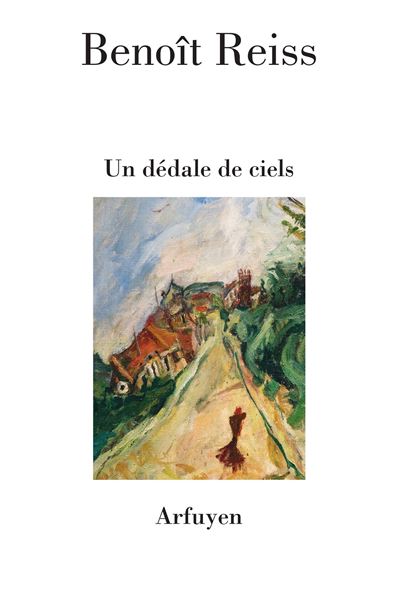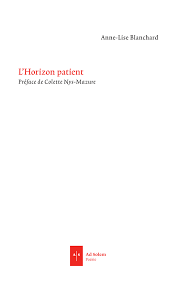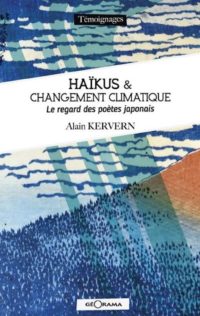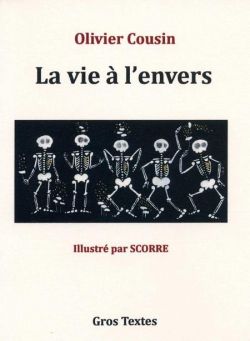Gustave Roud, Œuvres complètes
Un coffret de 4 volumes, 5120 pages, 88 photos couleurs et de très nombreuses illustrations en noir et blanc (car Gustave Roud était aussi photographe). Les œuvres complètes du grand poète suisse, décédé en 1976, sont publiées sous la direction de Claire Jacquier et Daniel Magetti par les éditions Zoé.
Une heureuse initiative permettant de regrouper ses œuvres poétiques (dix recueils de poésie entre 1927 et 1972), ses traductions (notamment de Novalis, Holderlin, Rilke, Trakl…), son journal (1916-1976) ainsi que les articles ou études critiques que Roud a consacrés, tout au long de sa vie, à des poètes, écrivains ou peintres et qui ont été publiés par des journaux ou revues suisses.
« Gustave Roud regarde la nature à l’œil nu et la nature ne le distrait pas », disait de lui Jean Paulhan en 1957. Ce marcheur impénitent, parcourant sans relâche les champs et les collines du Haut-Jorat (au nord-est de Lausanne, dans le canton de Vaud), est l’auteur d’une prose lyrique envoûtante qui témoignera, de bout en bout, de sa relation intime avec le vivant et l’élémentaire : les fleurs, les arbres, les oiseaux, les étangs, les rivières… au cœur d’un monde rural que la modernité n’a pas épargné : « Des vergers aux forêts, tout un cloisonnement de haies, jadis, donnait refuge aux oiseaux. Où trouvent-ils retraite, maintenant qu’un immense espace nu rayé de jeune blé, taché d’orge laineuse, unit les villages épars ? », écrivait-il le 18 décembre 1941 dans la revue L’illustré.
Le poète allie deux perceptions de la vie et du monde. D’une part un sentiment aigu de la précarité de nos existences, de la mort, de la disparition (à l’image de cette civilisation paysanne qui brille de ses derniers feux). D’autre part, le sentiment de la beauté du monde et de la présence, autour de nous, de miettes de paradis. Gustave Roud avait, en effet, repris à son compte la fameuse injonction de Novalis : « Le paradis est dispersé sur toute la terre et nous ne le reconnaissons plus, il faut en réunir les traits épars ».

Gustave Roud, Œuvres complètes, éditions Zoe, 5120 pages, 85 euros, 90 CHF.
Au cœur de son entreprise poétique, il y a, fondamentalement, cette quête de signes et de messages qui lui donnent la certitude d’un accès au paradis. « A la fois chant du monde et méditation sur la fin de la ruralité traditionnelle, la poésie de Roud apparaît aujourd’hui comme précurseur des écritures contemporaines qui tentent de renouer le lien défait entre l’humain, son habitat terrestre et les vies qui le peuplent », n’hésitent pas affirmer les instigateurs de la publication de ses œuvres complètes.
Ce regard « familier » sur les disparus, mais aussi cet appétit pour le « dehors », pour la nature dans ses expressions les plus diverses, on le trouve en permanence chez Roud. « Merveille de pureté cette matinée où j’avance à travers les prairies multicolores, les ombres fraîches, les feuillages (…) les fleurs se tendent vers moi comme des corps affamés de tendresse », note-t-il dans Essai pour un paradis (1932). Dans son livre Requiem (1967) où il évoque la mort de sa mère et le deuil, le poète écrit : « Je pose un pas toujours plus lent dans le sentier des signes qu’un seul frémissement de feuilles effarouche. J’apprivoise les plus furtives présences ».
S’il a vécu solitaire, Gustave Roud a su multiplier les rencontres en allant à la découverte des œuvres des autres. Qu’il s’agisse d’auteurs dont il cultivait l’amitié (Jaccottet, Chessex…) ou d’artistes dont il a parlé avec bonheur. « En cherchant à cerner le rapport particulier que les artistes abordés entretiennent avec le monde, l’auteur questionne sa propre position et, à travers ces cas spécifiques, il médite sur le processus créatif en général. Rendre compte d’expériences esthétiques nourrit la démarche du poète et l’exercice de la poésie infléchit en retour son regard sur les œuvres d’autrui », note Bruno Pellegrino dans la présentation des hommages, articles et études critiques que Roud a consacrés à des poètes, à des écrivains et des peintres.
Plus de 45 ans après la mort du poète, ce coffret des œuvres complètes (dans une édition critique) est là pour nous rappeler la place majeure tenue par Gustave Roud dans la vie culturelle de son époque. Elle justice à un œuvre lyrique majeure dans la poésie francophone du XXe siècle.