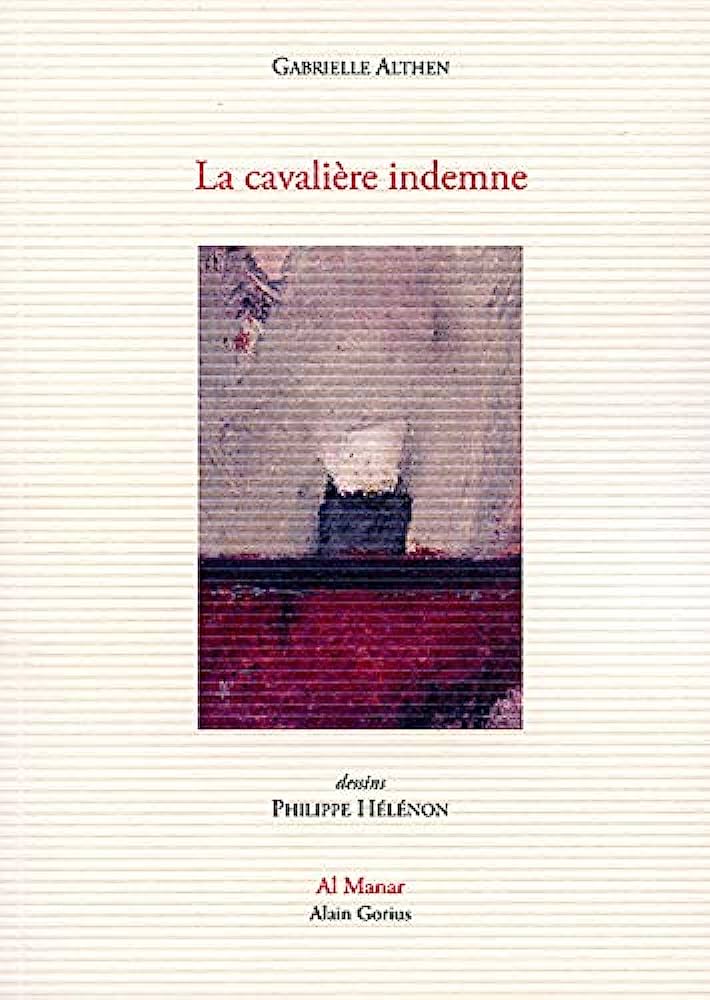A comme Babel
A comme Babel est un ouvrage tout à fait réjouissant, par la profondeur de sa réflexion à la liberté rhizomique, qui nous mène comme son titre l’indique d’une lettre de l’alphabet, en l’occurrence celle du commencement et de la direction, à la grandeur démesurée que représente Babel, ou plutôt les Babels que sont tous les textes écrits et attendant d’être traduits.
Son auteur, Guillaume Métayer, à la manière des taupes (très bonne ouïe, odorat développé), creuse douze galeries sous des idées conçues superficiellement, retourne entièrement le jardin et nous entraîne à examiner le contenu de chaque vers et motte de mots de très près pour en détecter les moindres mouvements. Sans oublier que son humour à tout casser fait trembler les étagères pleines d’obstinations, de principes et de parti-pris des traducteurs. Il est universitaire, et déplore et moque la détestation nourrie par certains poètes à l’égard de chercheurs comme lui, dont le travail de réflexion excavateur « prolonge le plaisir, l’approfondit, l’intensifie, le rend polygonal, abyssal » (p. 62). Toutefois, il avoue que la pratique, en pratique, quand on a les mains dans la pâte donc, dépasse la théorie car elle vient avant elle, du moins d’après ce que j’ai compris.
Personnellement, je travaille comme traductrice technique depuis mon année de Licence d’anglais (qui remonte à il y a un quart de siècle ou plus) et comme traductrice littéraire depuis quinze ans, ce qui est peu, en termes de livres publiés, c’est pourquoi je me permets de leur rajouter la vingtaine d’années durant laquelle je m’efforçais de traduire mes propres textes littéraires d’une langue à l’autre, pour les proposer à des revues littéraires des divers pays où j’ai vécu (même si j’ai toujours été très mauvaise à cet exercice, aimant sans doute trop mes vers pour bien les traduire, l’amour rendant aveugle, comme on le sait), et la décennie durant laquelle je traduisais des textes pour les étudiants de mes cours de langue et de littérature (et la grande joie que c’était que de commenter ensemble mes renditions imparfaites).
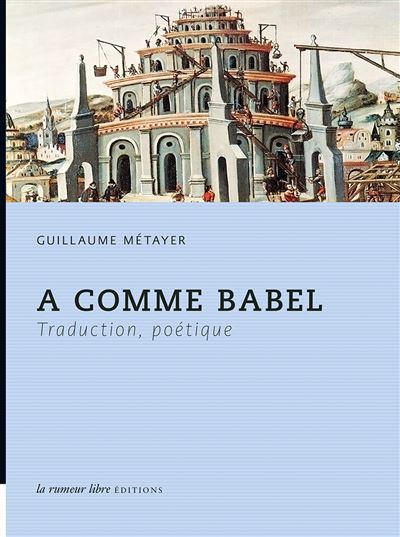
Guillaume Métayer présente A comme Babel, Traduction, poétique, préface de Marc de Launay, La rumeur libre Editions, coll. Raisons poétiques 2020 ISBN 978-2-35577-194-1 96 pages 16 €.
Malgré cela, je n’ai jamais rien entendu à tout ce qui concerne les « théories, approches et orientations » de la traduction littéraire, car à part les cours de thèse et version suivis pendant mes études universitaires, qui, j’ai honte de l’avouer aujourd’hui, n’étaient pas mes cours préférés, je n’ai pas fait d’études de traductologie, ayant tout appris sur le tas, chemin faisant, les mains plongées dans le cambouis des mots et pas dans les livres de théorie. Pour cette raison, j’ai toujours décliné les invitations de m’exprimer sur un travail de traduction en cours, me sachant incapable de théoriser ma pratique : je pense savoir traduire, j’ignore comment enseigner l’art de la traduction, ou comment en parler, je ne sais pas quels termes donner aux choses que je fais.
Guillaume Métayer présente A comme Babel, Traduction, poétique, préface de Marc de Launay, La rumeur libre Editions, coll. Raisons poétiques 2020 ISBN 978-2-35577-194-1 96 pages 16 €
Par exemple, A comme Babel m’a appris qu’il existe ce qu’on appelle la traduction « juxtalinéaire », et que moi j’appelle tout simplement premier jet ou première mouture, et qu’elle n’est jamais juxtalinéaire en fait, mais « toujours déjà une esquisse d’interprétation » (p. 36), la preuve étant que nous y revenons souvent, à cette première impression, « presque autant qu’au texte originel », nous dit Guillaume Métayer. Ainsi, je traduis depuis un certain temps mais je ne sais toujours pas parler de ce que je fais, heureusement, il y a des traducteurs comme Guillaume Métayer pour m’aider à mettre des mots sur ce merveilleux travail.
Podcast : A comme Babel. Episode 1, proposé par Guillaume Métayer Avec aujourd'hui : Jean-Baptiste Para.
En lisant A comme Babel, je me suis rendu compte que les descriptions pas à pas de Métayer, agrémentées de commentaires colorés et pleins de spontanéité, correspondaient à ce qui se passait dans ma tête pendant que je traduisais ; bien sûr, comment aurait-il pu en être autrement, nous faisons le même travail et nous confrontons peu ou prou aux mêmes questions (sans compter les anecdotes qui parsèment nos journées). En effet, je me suis demandée, comme Métayer avant moi : dans quelle mesure la première mouture de ma traduction est-elle bonne ? Faut-il se méfier des adverbes en -ment ? Dois-je vraiment traduire la rime ou ai-je raison de la bouder ? Dois-je trouver le moyen d’expliquer, d’interpréter ce vers obscur en le traduisant ? Pourquoi suis-je en train de traduire un si mauvais poème et dois-je le restituer avec ses faiblesses ou succomber à la tentation de le fertiliser un peu ? « Bien plus souvent qu’on ne le dit, le traducteur fait mieux que l’original, ne serait-ce parce qu’il doit, par sa traduction même, légitimer son choix : impossible qu’il ait traduit quelque chose d’aussi plat » (Métayer, p. 87). Que faire de strophes contenant des vers bien trop longs ou bien trop courts par rapport à ceux qui les entourent ? Est-ce que j’ai le droit de traduire comme une cleptomane en me servant dans des phrases connues de la littérature française ? Dois-je traduire l’intégralité des poèmes de ce livre ou seulement ceux que je pense être les meilleurs ?
Podcast : A comme Babel, Episode 2, proposé par Guillaume Métayer, avec Mireille Gansel.
Je suis traductrice parce que je doute, profondément. Traduire égale choisir.
« L’ignorance, le risque d’erreur, la crainte de ne pas comprendre, de ne pas savoir « rendre », c’est le quotidien. […] Plus je traduis, moins je sais ».
Corinna Gepner, Traduire ou perdre pied, La Contre Allée, 2019 (p. 21 et 27).
Heureusement, Guillaume Métayer, avec A comme Babel, calme de façon momentanée mes hésitations, du moins en ce qui concerne l’ultime question, en disant qu’« intégral rime avec inégal » (p. 49), et quand il s’agit non plus de recueil mais des poèmes complets d’un auteur,
traduire l’intégrale […] permet d’observer au plus près l’incroyable évolution de l’écriture poétique […], ses hauts et ses bas, ses silences brutaux, ses prolixités soudaines, ses mille essais, tâtonnements, passages d’un genre, d’un ton à l’autre, d’être confronté à l’énergie inouïe d’un verbe poétique toujours en quête de lui-même. Et pour le traducteur, quelle aubaine ; c’est une occasion unique de sortir sa palette, ses pinceaux, ses fusains, de s’exercer sur tous ces styles contrastés. […] Quelles académies ! Quelle école ! »
Guillaume Métayer, A comme Babel, La rumeur libre, p. 50.
Je rejoins tout à fait Métayer dans cette dernière phrase, la traduction a toujours été pour moi une école, je n’ai de cesse de le répéter : elle est non seulement une école de traduction mais aussi d’écriture, et de vie. J’y ai appris à écrire avec ou sans contrainte, des vers libres et des vers rimés ; à décrire de façon précise et originale les êtres humains, les animaux, le ciel, la mer, les variations climatiques ; à vivre au sein de milieux, de cultures, de lieux et d’époques divers ; à braver les tempêtes, les tentacules de la détresse, de la dépression, du suicide et de la mort ; à jouer au flipper, à grimper dans les arbres, à nager avec des baleines, à piloter un avion, à conduire un camion, à bêcher un jardin, à construire une maison, à décortiquer un homard, à butiner une fleur, à chasser et même à tuer ; à danser et à chanter juste ou faux ; à aimer passionnément hommes, femmes et enfants pour ce qu’ils sont ; à écouter tout ce qui « fait son et sens à la fois » (Métayer a dit cela au sujet de la rime p. 55) ; à être folle et à être philosophe ; à parler d’autres langues ; à mieux lire Shakespeare – que je cite en exemple pour la simple raison que je tombe souvent sur lui quand je traduis des poèmes écrits en anglais – et à mieux lire tout court.
Podcast : A comme Babel, Episode 3, proposé par Guillaume Métayer, avec Marc De Launay.
Bref, traduire m’a appris à lire tous les signes du texte, qui sont aussi des signes de vie, de ce qui le rend vivant, et qui renvoient à la vie elle-même, et au monde en entier, car traduire ou écrire en oubliant de vivre c’est comme essayer de vivre sans respirer : on ne va pas très loin. Traduire m’a rendue curieuse de choses de la vie et du monde qui n’auraient, sans la traduction, jamais croisé mon chemin, et m’a souvent entraînée à aller chercher comment ça marche au-delà des dictionnaires et des encyclopédies, soit comment vivre un peu autrement, un peu en dehors de ce que je suis ou crois être. Traduire c’est lire les signes, du plus petit au plus grand, et « c’est un suprême bonheur ! » (p. 86), comme Guillaume Métayer le sait.
Il parle de « geste » (p. 67) pour désigner les opérations que l’on effectue en traduisant, rappelant ainsi que la traduction est physique autant qu’elle est intellectuelle, une danse ou un corps-à-corps avec le texte, en somme. Et Métayer, en plus d’affirmer poétiquement qu’« un vrai traducteur doit ouvrir le poème comme un fruit, mangue ou grenade, et offrir au lecteur une substantifique interprétation » (p. 68), s’est aussi représenté les résultats de ses choix traductifs dans un espace spatial, « comme un mobile de Calder » fixé au plafond, par exemple (p. 67), ce qui m’a laissée bouche bée d’admiration. Je n’avais jamais vu la traduction sous cet angle-là, même si j’aurais dû, sachant combien elle est indissociable de tout ce qui lui est externe, du monde des vivants et des morts, de la créativité, et du corps : « Traduire est un sport. Traduire, c’est l’écriture à deux », conclut Métayer dans le douzième et dernier chapitre de son livre (p. 86).
Pour terminer ce petit éloge très (trop ?) subjectif de A comme Babel, un ouvrage à la fois érudit et drôle, convaincant parce qu’autobiographique, je dirai tout simplement que sa lecture m’a permis de comprendre que la théorie ne peut fonctionner sans l’apport d’exemples précis, qui lui sont vitaux, et qu’elle concerne davantage la description et l’illustration des problèmes rencontrés en traduisant que l’imposition et la prescription de certains systèmes ou règles à suivre, et que, tout comme l’universitaire et le théoricien n’ont pas à être pédants ou dogmatiques, la théorie ne l’est pas forcément non plus, selon comment elle est livrée et combien elle est ancrée dans la vie.
Guillaume Métayer, avec A comme Babel, nous a laissé entrer dans sa tête et quand il se la gratte, on fait pareil, quand il rit, on rit, quand il croit au miracle et au dieu de la traduction, on y croit également. La traduction, l’écriture et la lecture à deux, in fine.
Je vous laisse avec ses phrases si belles sur la rime, son amoureuse, sa « plus belle des maîtresses » :
Un vrai travail de métaphore. Et de cigale à la fois. Par ce simple accord elle nous donne à voir les abîmes de sens qui séparent les choses les plus proches à l’oreille, y jette des passerelles inattendues. Elle est un subtil anti-Cratyle (médicament non remboursé). Certes, il lui arrive aussi, tout au contraire, de mettre en lumière l’existence d’étonnantes convergences du son et du sens, et donc de renforcer l’illusion d’un lien naturel entre les noms et leur signification. Elle pointe ainsi ces moments où les mots d’une vieille langue finissent par se ressembler comme les vieux amants. Elle seule, à la manière géniale de tel cerveau d’autiste, sait aussi bien classer et faire ressortir ces connivences profondes.