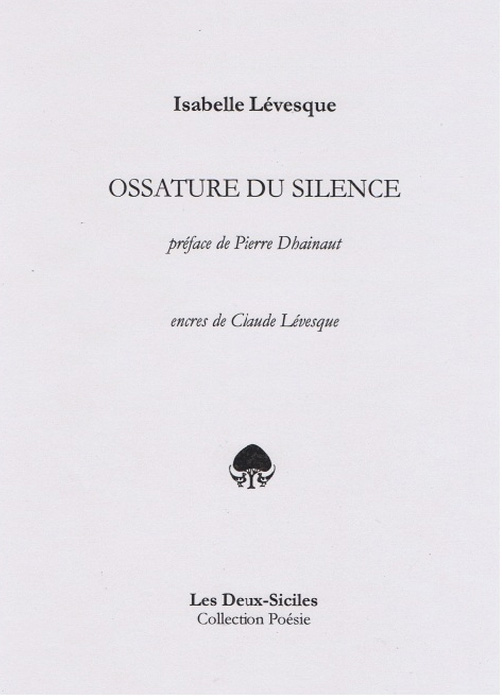En corps, l’écriture
« La lumière est celle du vent »
Jean Malrieu, Le plus pauvre héritier
Pour aborder la relation entre la peinture d’Eugène Leroy et certaines démarches poétiques, on pourrait penser qu’il faut s’attacher d’abord à traiter de tel ou tel poète explicitement cité par le peintre. Et en particulier Rimbaud, dont le nom revient souvent lorsqu’il est question du lettré Leroy, du professeur de grec amoureux des Belles Lettres.
Nous ne le ferons pas ici car notre propos essaie d’éclairer autant que possible la vocation de certains poèmes d’aujourd’hui à la lumière de la peinture sans concession, nue et totale, d’Eugène Leroy. Pour nous, Rimbaud constituera donc un point de départ. Est-il évitable, d’ailleurs ? Chaque fois ou presque, lorsque l’on ose un regard critique sur ces morceaux de vie que l’on nomme poèmes, inquiet de leur utilité ou de leur force, on cite son « Adieu », au terme d’Une Saison en enfer[i]. À l’été 1873, il sonne un échec : « J’ai essayé d’inventer de nouvelles fleurs, de nouveaux astres, de nouvelles chairs, de nouvelles langues. J’ai cru acquérir des pouvoirs surnaturels. Eh bien ! je dois enterrer mon imagination et mes souvenirs ! ». Pour Rimbaud, un constat : l’entreprise poétique, à la regarder lucidement, n’est pas parvenue, malgré tous ses approfondissements, à inventer les nouveaux corps dont elle a rêvé. Les mots restent ce qu’ils sont : des symboles abstraits, à la lettre : détachés du monde. La magie prêtée à leur manipulation n’est qu’un leurre. Si Rimbaud s’est tu, s’il s’est détourné de la poésie, c’est qu’il a fini par être convaincu que le langage, réducteur de tête civilisé, émondait la fleur en tant que chair au point de n’en faire rien qu’une « hallucination ». Et s’il a dit « Adieu » à tous ses poèmes, c’est pour saluer un monde libéré des illusions du langage, « posséder la vérité dans une âme et un corps ». Ce corps qu’il ajoute au bout de son souffle dit la terre qui manque au monde-dit, linguistiquement senti, il contient toute la quête de l’artiste pour qui ensevelir, c’est redonner vie : il explique la conversion d’un homme qui n’a, en réalité, jamais cessé de creuser son expérience du monde.
La poésie, bien sûr – mais pouvons-nous en parler comme si elle était un genre ? – malgré cette aventure poignante et décisive, ne s’est pas arrêtée avec Rimbaud. Elle résiste aux destins individuels comme aux catastrophes collectives. Toutefois, il ne faudrait pas se croire tirés à si bon compte de la part de vérité qui revient au poète de Charleville-Mézières. Nombre de poèmes puisent leur force et leur vie paradoxales de son avertissement. La vertu que nous voudrions leur prêter, avant de parcourir l’œuvre intransigeante de Leroy, a une portée politique : ils nous enseignent à nous méfier absolument de ce qui s’érige en discours, éloquence, argumentation pesant sur le monde, à nous méfier de toute forme d’élucubrations conceptuelles, à nous méfier des labels. Cette méfiance, qui n’est pas un rejet systématique mais plutôt une sorte de doute méthodique, doit aussi nous préparer à la rencontre avec Eugène Leroy, dont le travail acharné et entêté ne s’est encombré d’aucun compromis. Il y a, dans ce doute radical de la poésie à l’égard même des constructions linguistiques, de quoi nous rendre disponibles à la démarche du peintre de Wasquehal qui, comme le dit Ludovic Degroote, refuse les « accessoires de théâtre »[ii].
Il ne peut s’agir là, toutefois, que d’un préliminaire. Car Leroy fait toute confiance à sa matière, à cette huile qu’il applique, qu’il mélange, empâte par tas, traînées, couches plus ou moins longues, épaisses, étalées, sur la toile. Sa peinture, Pierre Dhainaut l’appelle le « creuset de la lumière »[iii]. Or, pour Leroy, « la lumière construit tout ». Et « tout », c’est un espace-temps vivant, un bloc corporel qui ne se détache pas du monde, contrairement au mot symbolique, mais qui participe de sa chair, infiniment relié aux autres corps du monde. Quels poèmes peuvent prétendre, rompant suffisamment avec l’abstraction du langage, être plongés dans le corps même du monde, simplement n’être qu’un mouvement de la matière ?
Puisque la peinture de Leroy ne représente pas mais rend présente, le poème qui lui répond doit avoir renoncé à décrire. Renoncer à faire des mots des signes de la réalité. Ce que nous pouvons garder du silence de Rimbaud, peut-être, c’est le refus de l’empire dictatorial de ce qui se rassemble sous le nom de « sciences de la communication » ou « sciences de la littérature ». Ainsi nous affranchirions-nous des icônes et des idoles qui ne cessent de nous abêtir et de nous tuer. Qui, en tout cas, ne cessent de nous aveugler et de nous assourdir au point d’exclure de plus en plus gravement l’art et l’humain de nos sociétés hyperinformées. C’est dire l’importance pédagogique majeure d’une véritable rencontre avec Leroy et les poèmes qui font écho à sa peinture. Mais comment un texte, fait de mots, peut-il rendre présent un paysage sans le décrire, sans, d’un autre côté, sombrer dans l’insensé ou le solipsisme ? Comment situer un sens ailleurs que dans les règles formelles de la signification, en fait dans la matière même des corps du monde ?
Entre élan
vers le libre
Et retour
vers l'abîme
Toute branche est brise
Et tout rameau rosée
Célébrant l'équilibre de l'instant
au nom désormais fidèle
Arbre
Prononcer « Arbre », pour François Cheng[iv], c’est bien autre chose qu’appeler une idée, certains linguistes diraient : un signifié. Cette association intellectuelle existe, bien entendu, et les tentatives pour disloquer le signe et se battre contre lui peuvent avoir une espèce de beauté désespérée. Mais prononcer cette syllabe, avec vigilance et bienveillance, c’est laisser passer l’élan d’une ouverture, d’une voyelle vibrante d’énergie, puis la détacher de soi comme une bulle qui se refermerait en ses consonnes avant de poursuivre sa route aérienne, ô combien fragile, dans cette résonance du « e » bientôt retournée au silence de « l’abîme ». Dans cette unique syllabe, « arbre », la brise qui agite les branches de l’arbre présent ne cesse d’être présente, modulée. Il en va de même de la présence mobile et tremblante de Valentine, Annemie ou Marina dans le corps même de la peinture de Leroy. Ses couleurs sont le creuset d’une vraie lumière, d’une lumière qui nous inonde et qui passe en nous, la lumière de toute présence. Ce creuset ne réinvente pas une autre lumière que celle de notre monde, il ne la représente ni ne l’abstrait. La peinture n’est pas ce lieu d’une création ex nihilo, elle est plus humble que cela. Leroy, à l’instar de François Cheng « célébrant l’équilibre de l’instant », s’est affranchi de cette outrecuidance selon laquelle l’art devrait vaincre la mort et prétendre à l’éternité. La lumière et le son ne sont que mouvement, voyage et passage. Ils sont le corps subtil de ce qui, indissociablement, vit et meurt, meurt et vit. Les silhouettes infiniment nouées aux mouvements lumineux des couleurs ne s’imposent pas à notre vue ; elles ne demeurent pas visibles pour tous les points de vue. Elles sont infiniment reliées à l’espace où se trouve notre corps, aux passages des heures, des saisons, au vrai temps astronomique des corps célestes. Oscillations d’épiphanies (épiphasis) et de résorptions (aphanisis), pourrions-nous dire avec Georges Didi-Huberman[v].
Ces palpitations irrégulières du temps dont Leroy a toujours été le passeur, comme si ses superpositions d’huiles étaient le positif d’une main s’efforçant d’être un négatif de plus en plus sensible, amène également la main du poète à libérer son vers :
Entre élan
vers le libre
Merveilleux regard, merveilleuse écoute, merveilleux tact, lorsqu’est perçue la conjonction totale de la branche et de la brise. Le vers libre laisse passer cette respiration de l’air à travers et autour de la branche, ce mouvement de la branche à travers et autour de l’air. Comme la main du peintre qui s’évertue à ne pas faire écran au passage des couleurs, celle du poète, loin de vouloir capter un paysage avec des mots, s’efforce au contraire de laisser frémir les bruissements de l’air par quoi le paysage apparaît.
Toute branche est brise
Merveilleux regard, merveilleuse écoute, merveilleux tact, lorsqu’est perçue la conjonction totale de la branche et de la brise. Le vers libre laisse passer cette respiration de l’air à travers et autour de la branche, ce mouvement de la branche à travers et autour de l’air. Comme la main du peintre qui s’évertue à ne pas faire écran au passage des couleurs, celle du poète, loin de vouloir capter un paysage avec des mots, s’efforce au contraire de laisser frémir les bruissements de l’air par quoi le paysage apparaît.
Et tout rameau rosée
Dans les cas les plus heureux, et ce Chant de François Cheng en est un exemple, le corps du monde suit une chaîne ininterrompue de métamorphoses. C’est non seulement le rameau qui est rosée mais aussi, la grammaire ne nous contredit pas, tout qui est rameau qui est rosée… Et intituler un tel chant « L’Arbre en nous a parlé », ce n’est pas vouloir dire, par plate métaphore, que nous entretenons une ressemblance symbolique avec l’arbre. « L’Arbre en nous a parlé » : ce n’est pas une figure de style, comme l’on dit dans les classes, ce n’est pas de la technique littéraire. La strophe nous émeut, charnellement, parce que le poème perpétue le souffle bien sensible de l’arbre-vent en une parole qui n’est que sa métamorphose. Serait-il excessif de parler de réincarnation – de l’arbre-vent en arbre-parole ?
Ainsi, de même que la peinture de Leroy parvient à ne plus être image pour n’être que corps, le poème réussit à s’extraire de l’emprise du langage. Par le jeu de la seule sémiotique, l’œuvre ne rayonne pas dans le monde, n’entre pas en résonance avec lui. Par le jeu des signes, l’œuvre accole un autre monde, métaphysique ou métapsychologique, tour à tour angélique ou diabolique, mais toujours hallucinatoire. C’est un calembour. Pour rayonner et résonner, l’œuvre n’a pas à prétendre tirer de l’Être à partir de Rien, ni à substituer ses images digitales à la terre. À l’aube des œuvres les plus libératrices, celles qui nous changent le plus, rien de plus que l’expérience de l’union de chacun avec chaque autre (« Et tout rameau rosée »), la sensation d’une fidélité du langage incarné avec les corps du monde. L’amour des corps retrouvé. Celui tant recherché par Rimbaud et qui lui fait dire, dans « Aube » : « J’ai embrassé l’aube d’été ».
La peinture de Leroy paraît épaisse et opaque, même difficile écrit parfois Jacques Bornibus, son ardent défenseur depuis le début[vi]. En effet, ni de volonté ni de représentation, les corps, ce qui fait que Rimbaud en appelle finalement à la terre, sont noirs, sourds, silencieux. Leur devenir sensible à travers les chemins métamorphiques de l’œuvre d’art ne nous touchera que si nous nous insurgeons contre notre culture, si nous nous retournons. Pierre Dhainaut ne cache pas que c’est une longue démarche qui permet d’ôter ce qui obstrue le regard, bouchant le passage d’un rayonnement pourtant recueilli au cœur même des corps.
Ce que nous appelons « silence », de nuit,
une voix s’y ressource avant de poindre.
Il convient de se laisser envahir par la nuit, au plus profond de l’obscurité, d’une chambre dit souvent Pierre Dhainaut[vii], pour se rendre attentif au moindre tressaillement des corps. Cette expérience tactile à la faveur du noir total est tout aussi fondamentale chez Leroy. Il n’y a que dans le noir que la voix se libèrera des discours et des abstractions toutes faites qui la privent de son souffle :
À peine s’offre-t-elle aux premières syllabes,
un souffle en émane, en aimante d’autres :
le corps pesait, le corps s’incarne en devenant parole.
Au prix de cette ascèse, de cette plongée dans la physicalité inerte des corps qui, pour nous, s’apparente à la mort, l’aventure se fait : les mots s’incarnent et rejoignent la vie, la chair du monde. Dans un entretien, Leroy raconte les moments passés devant le feu, s’exerçant à plonger son regard dans les flammes. Sacrifice purificateur pour brûler ce qui encombre notre œil, tous nos sens. Alors la nuit la plus noire confine à la révélation la plus éclatante.
Nous ne demandons pas à qui elle appartient,
mais nous reconnaissons ces cris qui se changent
en murmures, déjà cette rumeur de houle
parcourant les rivages, élargissant les arbres :
Le peintre tente de rester fidèle au visible ; le poète tente de rester fidèle à l’audible, « cris », « murmures », « rumeur de houle », « arbres ». Or, par quel miracle les lois d’une grammaire, régissant la phrase comme le discours, seraient-elles a priori solidaires de l’audible ? Selon toute probabilité, aucun. Et il y a plus : la voix, réorientée par l’expérience de la nuit, parvient enfin à s’extraire de l’étroite gangue du « je » pour s’extérioser en un « nous ». Même pas un « tu ». Avec le « nous », la voix n’appartient plus à un sujet, la dichotomie sujet/objet tombe. Corps réellement en présence, une peinture ou un poème ouvrent les corps les uns aux autres : l’ego n’a plus lieu d’être, il est enfin relégué au rang des breloques qui nous rendaient si artificiels, si illusoires. Tout peut s’élargir :
Ce qu’elle cherche, comment le suivrons-nous,
pourquoi devrions-nous choisir entre le cœur
et l’horizon ? Jamais assez profond l’espace
à travers elle, ni assez généreux.
Si l’œuvre d’art ne doit ni s’imposer au monde, ni se surimposer à lui (sous peine de créer des « arrière-mondes »), elle lui ajoute de l’ampleur, un terme utilisé plus loin dans le poème. Elle remet en circulation ces souffles et ces lumières que l’existence, trop souvent, nous apprend à arrêter ou à ne plus voir : la vie nous fige, les habitudes, les certitudes, les mensonges aussi nous réconfortent, se durcissent en un piètre silex avec lequel nous croyons avancer. Cette nouvelle étape, au contraire, où toutes les dimensions (« les rivages » et « les arbres ») se mettent à pointer vers l’infini dans la finitude même de leurs corps, syllabes ou touches de peinture, elle n’est soutenue que par un élan : c’est l’amour.
La voix, qui renaît d’un poème, qui le révèle,
nous l’accueillons comme un enfant se lève
vers un visage aimé : elle ajoute au monde
le monde plus ample, le silence a pris forme,
il s’éclaire, il résonne, il a tout le temps de promettre
que rien ne tombe, ne retourne à la nuit
parmi les mots que nous disons avec le même élan,
celui de « mort » aussi, pour consentir et nous ouvrir.
Le « visage aimé », incarnation d’une voix venue du plus profond de la nuit, l’enfant, immédiatement, se tourne vers lui à son appel. Il suscite aussitôt un élan, et lui offre tout par la seule vertu de la relation d’amour. L’amour, la promesse : à cet appel répond la conscience que le seul mobile valable d’une œuvre, c’est d’offrir la possibilité de se transcender, d’ajouter « plus ample » au monde. Pour rendre hommage à un défunt, le poème de Pierre Dhainaut n’en regarde pas moins vers l’enfant : toujours il se voue à l’humain à venir plutôt qu’à la tradition ou aux pairs. Nous n’héritons pas du passé, semble-t-il nous dire, mais de cet inconnu qui nous tend ses joues, ses bras, si nous savons l’aimer[viii]. Dans la mesure où l’œuvre, en son ouverture aimante, consent à perpétuer les métamorphoses des corps, son exigence dépasse tous les modèles, qu’ils soient moraux ou esthétiques. Peut-être faudra-t-il y voir plutôt un souci éthique, unir les morts et les vivants dans une même présence, par l’œuvre d’art. À cet égard, le dialogue avec Leroy, instauré ici par une lecture de poèmes, doit nous donner l’espoir, un jour prochain, de saluer « dans une âme et un corps », les amplitudes du monde.
Thomas Demoulin
Ce texte est né à l’invitation de Jean-Yves Penin, formateur à l’Institut de Formation Pédagogique de Lille. Qu’il soit ici amicalement remercié pour la place qu’il a bien voulu accorder à ce dialogue entre peinture et poésie.
[i] Voir, par exemple, la préface de Daniel Martinez au n°61 de la revue Diérèse (« Affinités », été-automne 2013)
[ii] Ludovic Degroote, Eugène Leroy, Autoportrait noir (Invenit, col. Ekphrasis, 2010), p. 21 et 22
[iii] Pierre Dhainaut, Au creuset des couleurs, paru dans le n°11 de la revue Thauma (« Couleurs, Lumière », oct. 2013). La citation suivante et l’importance du toucher dans le rapport entre Leroy et la peinture viennent de cet article.
[iv] François Cheng, extrait de Double chant (Encre marine, 1998, repris dans À l’orient de tout, Poésie/Gallimard 2005)
[v] Georges Didi-Huberman, La Peinture incarnée (Minuit, 1985). Dans sa lecture du Chef d’oeuvre inconnu de Balzac, l’auteur montre (volontairement ?) le haut niveau d’abstraction qui sous-tend la tentative occidentale moderne de figuration. Mais il semble toujours envisager comme un échec cette autre perspective, qui fait de la peinture un « chaos » et des « superpositions de couleurs », alors même qu’il semble essentiel d’y voir une réussite positive.
[vi] Jacques Bornibus, « De la lumière vraie dans de la couleur peinte » (1956), in Eugène Leroy Jacques Bornibus, une complicité (catalogue d’exposition, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing, 9 juin-12 septembre 2004)
[vii] Pierre Dhainaut, Poème du jour, n°80, Atelier de l’agneau (2012). Cet hommage à Laurent Terzieff ouvre son autobiographie critique : La Parole qui vient en nos paroles (Éditions L’Herbe qui tremble, 2013).
[viii] Ici, Pierre Dhainaut rejoint Yves Bonnefoy, « l’un des très rares poètes » à se préoccuper d’une « nouvelle paideia ». Les conséquences sur l’enseignement de la poésie sont développées dans « Oui, par l’enfant » et pour l’enfant : Yves Bonnefoy et l’enseignement de la poésie. Op. cit. Décapant et salutaire.