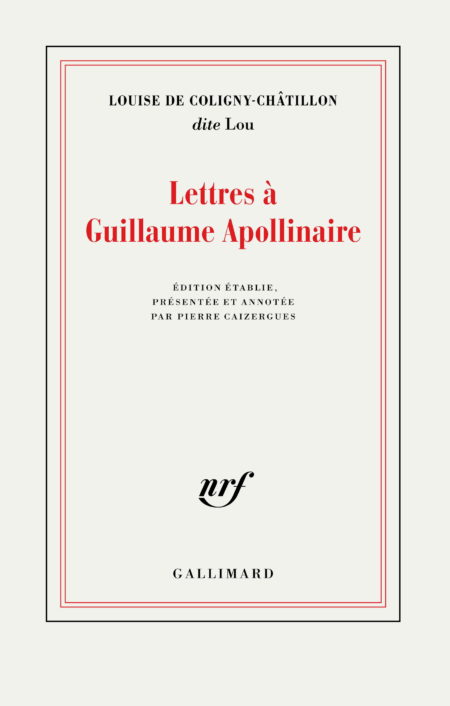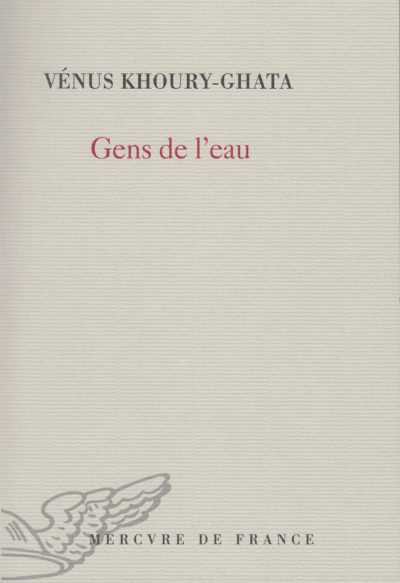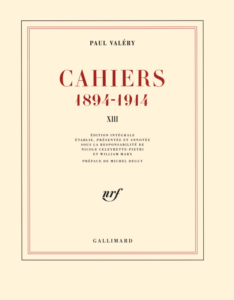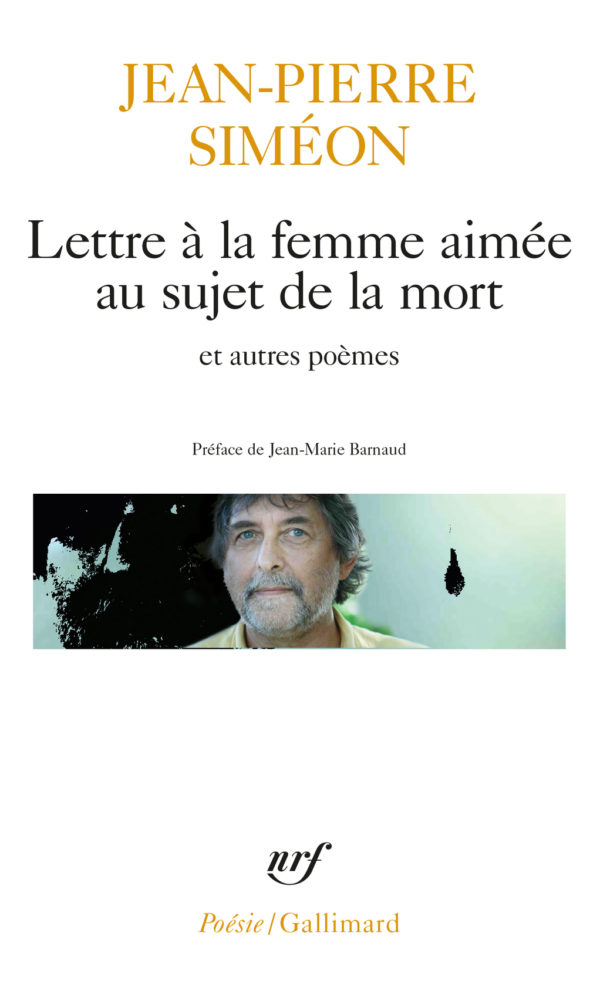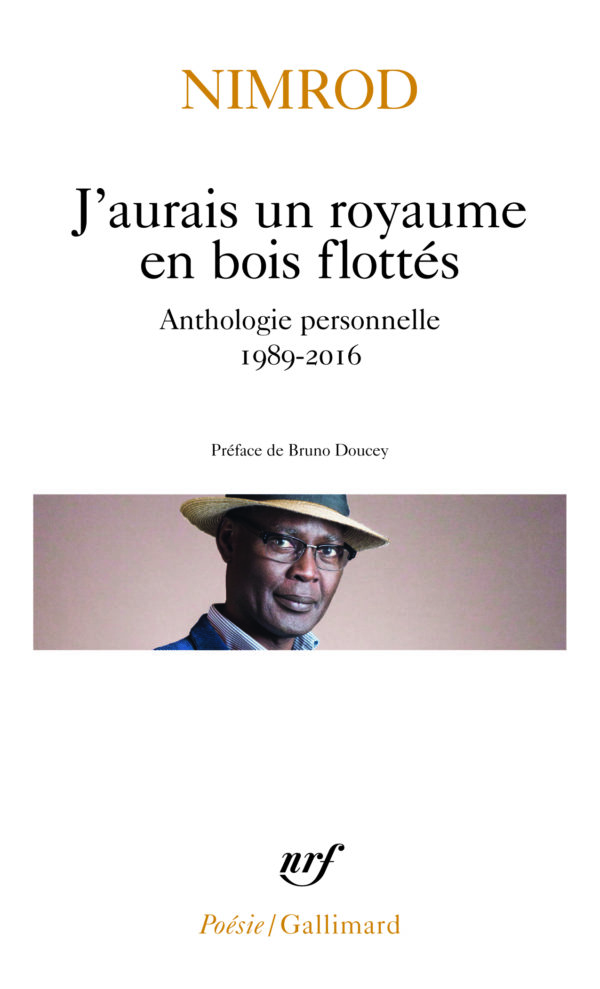Adonis : Lexique amoureux
Voici le quatrième et le plus massif des volumes d’Adonis publiés par Gallimard dans la petite collection Poésie. C’est dire à la fois l’abondance créatrice du poète Adonis, et l’intérêt que lui porte le public, doublé sans doute d’une curiosité pour la poésie de langue arabe. D’emblée, je dirai qu’il est impossible ici, et de faire tant soit peu le tour de la question, que ce soit de la personnalité du poète, ou de ce que véhicule sa poésie, en particulier par rapport à la littérature poétique dans les langues qui utilisent l’arabe pour écriture, et dont pour toutes, plus ou moins, les thèmes et la vision d’un monde se sont « littérarisées » par l’apport culturel de l’Islam et de la langue du Coran.
Ainsi, Adonis écrit en arabe, connaît une vaste popularité dans les pays qui ont accès à cette langue, ou la pratiquent couramment, mais par bien des côtés, sa poésie fait écho à de grands précurseurs tels que Hafiz ou, pour la pensée, à des Ibn Arabi ou des Sohravardi, par exemple. En lisant ce Lexique amoureux, on ne peut s’empêcher de songer aux divers aspects de la notion du « coeur » telle qu’on peut la lire chez les Soufis et dans le Coran. Cependant, Adonis se dit occuper une situations paradoxale en laquelle une forme d’athéïsme n’est pas incompatible avec les concepts de la mystique musulmane.
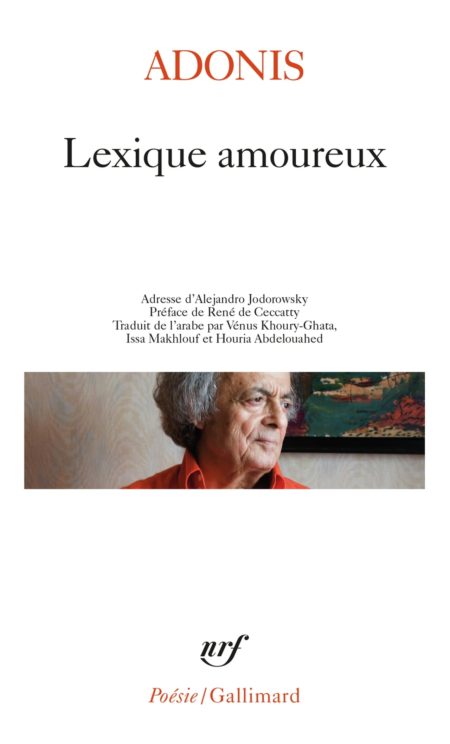
Adonis, Lexique amoureux, traduit de l’arabe par Vénus Khoury-Gata, Issa Makhlouf et Houria Abdelouahed. Collection NRF - Poésie/GALLIMARD- 510 pp.
Il s’ensuit une œuvre d’une richesse extraordinaire par son dialogue poétique entre la modernité du penseur, qui n’ignore rien de la pensée « cartésienne », et l’abondance culturelle des symboles issu de la tradition. Ainsi tout dans Adonis est extrêmement pluri-signifiant, ce qui évidemment est difficile à faire percevoir dans une traduction en français dont le vocabulaire n’évoque aucunement les « atomes lexicaux de signifiés » que le mot arabe correspondant produit dans une conscience de culture arabe. On n’a donc essentiellement, il faut l’avouer, qu’un « aperçu », dont la face disons de « culture européanisée » est forcément en français la plus sensible : cependant que des traductions moins adaptatives (ou davantage « mot à mot ») seraient terriblement réductrices, car on peut dire facilement en arabe, sur les sentiments les plus divers et les plus subtils, des choses qui en français paraîtraient ridiculement sentimentales, et disons « mal-compréhensibles ». Il est de fait, en ce sens, que la compréhension métaphysique du cosmos, que ce soit pour un athée ou un croyant, dans la langue du Coran – qui constitue le fondement de l’expression et de la pensée en arabe classique – reste bien plus spontanée que dans le monde purement occidental. De là découle que par la superposition inconsciente des signifiés dénotatifs, connotatifs et symboliques « empilés », le principe de non-contradiction (le fameux « tiers-exclu ») aristotélicien est déjoué. L’espace dans lequel se meuvent les idées du monde moyen-oriental est essentiellement platonicien. C’est ce que l’on constate simplement par exemple avec la façon d’écrire : l’occidental écrit de gauche à droite parce que ce qui l’intéresse au premier chef est de voir la matérialisation de ce qu’il a écrit, sa réalisation. Lorsqu’on a écrit on a le tracé d’encre sous les yeux, on peut donc « vérifier » à mesure ce qui est tracé et qui suit l’acte de la main. En revanche en arabe, on écrit de droite à gauche, la main cache ce que l’on vient immédiatement de tracer, parce que c’est moins ce qu’on a écrit qui importe que ce que l’imagination projette incessamment d’écrire encore. Ce n’est donc pas tant la réalisation que l’élaboration des idées qui compte. De même, dans la monde moyen-oriental, la démarche dans les discussions est très différente de celle de l’Occident : pour informer, on va s’étendre longuement sur les circonstances, puis on expliquera le résultat d’un événement ou d’un acte, puis on expliquera ce qui s’est passé, et enfin on désignera ce qui en a été la « cause ». Et on débattra longtemps, avec une sorte de mentalité « juridique », de l’exact degré de responsabilité de cette cause à partir de l’ensemble des informations préalables sur ses conséquences et l’influence des circonstances. De même, en conversant sur un projet, on finit par décider de ce qui sera « bon ». Puis les choses en restent souvent là, puisque l’essentiel est dit, et que la matérialisation est secondaire. En lisant la poésie d’Adonis, j’entends, de façon globale et synthétique, il me semble que les choses s’y passent quelque peu de la même façon : chaque recueil accumule et présente au lecteur d’abord une masse de faits, puis peu à peu au cours du livre, ils forment une sorte de « paysage mental » d’ensemble. Et finalement l’essentiel est donné, compact, et évident. Par exemple (page 379) le prologue d’ « Histoire qui se déchire sur le corps d’une femme » propose quelques données qui interrogent sur un événement et ses circonstances. Ensuite, le choeur, la femme, le narrateur, racontent les mille fragments d’une histoire. À la fin, à la page 500, un court poème ramasse en quelques vers tout le message, ici le problème de la position et de l’action du poète qui est au coeur de tout le livre… D’autant que l’Islam n’aime pas trop les poètes, craignant qu’on en fasse des prophètes !
On m’excusera de ne rien citer en particulier, et d’inviter le lecteur intéressé à acquérir le livre, car pour développer ma thèse… il y faudrait, non pas quelques poèmes cités, mais un livre entier au moins, qui n’est pas de mise ici, d’autant que nous ne parlons que de la version en français qui, si soigneusement traduite qu’elle soit par trois traducteurs dévoués et incontestablement valeureux, n’autorise pas beaucoup de justes commentaires. En français, s’imprégner à la longue du poème d’Adonis en fréquentant sa poésie bien traduite est le mieux qu’on puisse faire pour approcher son œuvre, de résonance universelle.
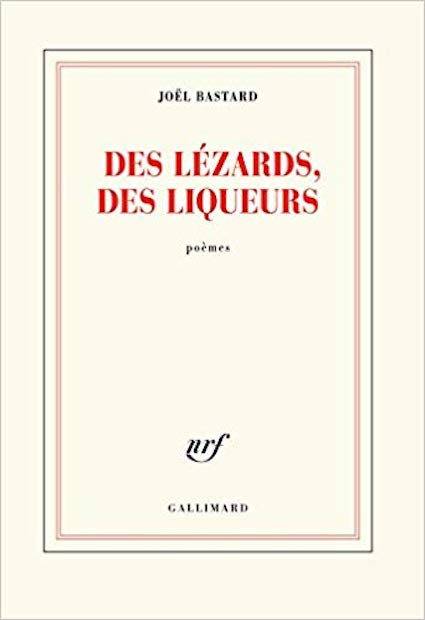

![[APOLLINAIRE-(GUILLAUME)].-MARCOUSSIS-(LOUIS)-EAUX-FORTES-POUR-ALCOOLS-DE-GUILLAUME&HELLIP-](https://www.recoursaupoeme.fr/wp-content/uploads/2018/10/apollinaire-guillaume-marcoussis-louis-eaux-fortes-pour-alcools-de-guillaumehellip.jpg)