Chronique du veilleur (36) : François de Cornière
Chronique du veilleur (36) : François de Cornière
Je lis les livres de François de Cornière depuis plus de trente ans, je me suis demandé pourquoi. Pourquoi, alors que je fuis cette poésie dite « du quotidien », qui fut à la mode dans les années 80-90, de manière assez furieuse ? On a tellement écrit de poésie « jetable » sur les ustensiles de cuisine et les tracas ménagers, dans un style oral, se décousant, se décomposant à mesure !
Je sais pourquoi je lis François de Cornière avec une émotion qui n’a rien de factice. Ça tient à quoi ?, son nouveau livre, m’ouvre les yeux. Ce poète aime l’humanité, sincèrement, vraiment. « Des petits blocs d’instants / suspendus dans le vide » n’ont de valeur poétique que parce qu’ils recèlent un secret profond que seul le cœur humain peut atteindre.
toutes ces traces d’émotions
s’enfuient de mon poème
et je colmate ma faiblesse comme je peux :
se serrer un instant
se lâcher
et tout laisser filer
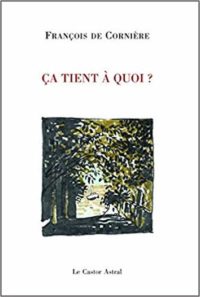
François de Cornière, Ça tient à quoi ?
Le Castor Astral, 2019, 197 pages, 13 euros.
Le poète confie en effet sa « faiblesse » à son écriture, comme pour la conjurer et en ressaisir les fibres trop sensibles, pour la charmer aussi d’une sourde musique de nostalgie. La fin des poèmes me frappe particulièrement, elle ne retombe jamais dans la platitude de l’existence, elle tend vers un horizon, un ciel, un monde plus léger ou plus lointain, une lueur d’ailleurs , aperçue « dans la fente du présent. » C’est là le plus touchant et le plus fort de la poésie de François de Cornière : sans en avoir l’air, partant d’un bout de phrase entendue au hasard des promenades, d’une irruption de souvenirs qu’il croyait enfouis, d’une soirée de lectures de poèmes, le poète n’a pour seul recours que d’écrire, sans jamais être bien sûr de l’efficience du poème écrit. Ces « moments pris sur le vif » dépassent la circonstance banale où ils sont apparus, ils nous parlent dans une langue simple et sensible, sur un ton de confidence presque amicale. Ils deviennent alors, par la magie du poème, de portée universelle et intemporelle.
François de Cornière est déjà un « classique », pour toutes ces raisons. Il est surtout une voix singulière qui se fait toujours chaleureusement proche.
j’ai le cœur transpercé
par ces simples choses
qui vibrent entre mes doigts :
des poèmes
des instants qui durent
fragiles
et l’ombre qui gagne du terrain
doucement sur le jardin.



