Dossier Philippe Jaffeux : autour de Glissements, Entre, Deux
Glissements
Sur un rythme stakhanoviste (trois livres en trois mois : Entre dans la même collection en mars, ce livre aujourd’hui, et Deux à paraître le 10 juin chez Tinbad), le poète Philippe Jaffeux aligne les défis au monde poétique d’aujourd’hui : comment, à chaque livre, rejouer tout l’espace de la page ? Comment, à l’intérieur de chacun de ses livres, rejouer son livre à chaque page ? Et comment, sur chaque page, rejouer son livre à chaque phrase ? Tel est l’incroyable pari épistémique que Jaffeux gagne : trois coups de dés ; autant de « victoires » poétiques.
Je ne vois guère que dans le cinéma structurel américain des équivalents formels à ce travail de la langue : Paul Sharits, Michael Snow, Hollis Frampton, Tony Conrad, Ernie Gehr, etc. On sait qu’au lieu de travailler avec des plans (comme le fait le cinéma narratif), ou avec des photogrammes (comme Peter Kubelka), ces cinéastes ont travaillé à partir de kinèmes (terme forgé par le cinéaste allemand Werner Nekes à la fin des années 60, signifiant un court ensemble de photogrammes : 3 ou 4) ; de l’addition ou de la friction de ces kinèmes, ils ont inventé un cinéma qui ne devait rien à la narration, mais tout à la structure, réinventée pour chaque film. Jaffeux, qui déforme les phonèmes d’une nouvelle façon à chaque page de ce Glissements, invente donc, à lui tout seul, la poésie structurelle (terme non trouvé sur Internet par votre serviteur). À côté de cet impressionnant travail sur la structure du poème, les jeux de mots oulipiens simplistes d’un récent pléiadisé, « enlever le e » (in La Disparition), ne se servir que d’une seule voyelle, justement le « e » (in Les Revenentes), sonnent comme des jeux d’enfants, puisque la formule narrative principale y restait intouchée. On est mallarméen ou on ne l’est pas…
Mais quid de ce titre, Glissements ? À chaque page, Jaffeux invente de nouvelles frictions entre les phonèmes : un coup (de dés) des lettres (traitées alors comme des photogrammes) tombent (glissent), comme ici :
L’im ge d’une force neuve résiste ux impulsions d’une ttente
a a a
Ailleurs, des lettres se penchent en avant, tout en devenant capitales :
huppE s’adresse à l’action d’une vitesse afin
de délimiter la nature irresponsable d’une force plastique
xéniquE
Plus loin, le texte se disloque sous l’effet de nouvelles frictions, plus fortes :
L’alp habet se p enche au-d essus d’un e mul
ittud e de trous qui libèr ent l e ver t ige
Ou bien, l’écriture retourne à son origine première, quand tous les phonèmes étaient collés alors (c’est en lisant à voix haute qu’aux tout premiers siècles de notre ère on pénétrait le sens de textes dépourvus eux aussi de ponctuation et même d’intervalles entre les mots[1]), comme ici :
Lerêvedunfouhanteunelignequichassedesintervallesirréels
Celui qui ne se lira pas ce passage à voix haute n’y retrouvera pas ses petits… Elle est retrouvée ! quoi ? L’écriture des origines… Il faut être « fou » comme un Jaffeux pour avoir osé s’imaginer qu’un tel retour serait se situer de facto à l’extrême avant-garde de notre bel aujourd’hui.
Par Guillaume Basquin
Pénètre l'intervalle
Entre : préposition, indique que quelque chose se situe dans l'espace qui sépare des choses ou des êtres.
Entre : 2ème personne du singulier du verbe entrer à l'impératif présent.
Voici pour ma brève introduction à propos du titre du dernier livre de Philippe Jaffeux, Entre, aux éditions Lanskine.
On connnaît l'auteur pour son travail formel. Denis Heudré avait produit une lecture critique pertinente à propos de son Alphabet (de A à M), parlant d'Objet Littéraire Non Identifié. Il notait également que Jaffeux écrit hasart et non hasard, orthographe reprise dans cet opus où le mot revient souvent. Beaucoup d'étymologies ont été proposées dont celle de Guillaume de Tyr, rapportée par Littré, « à savoir que le hasard est une sorte de jeu de dés, et que ce jeu fut trouvé pendant le siège d'un château de Syrie nommé Hasart, et prit le nom de cette localité. ».
On ne peut que songer au poème de Mallarmé, Un coup de dés jamais n'abolira le hasard, poème typographique qui a suscité nombre d'exégèses aussi bien quant aux espaces blancs qu'à une signification ésotérique. Toujours est-il que le livre de Jaffeux nous donne, lui, au moins son secret de fabrication en fin d'ouvrage, après le texte : « Entre est ponctué à l'aide d'une paire de dés. Les intervalles entre chaque phrase s'étendent donc entre deux et douze coups de curseur. Entre est un texte aléatoire qui est accompagné par l'empreinte de trois formes transcendantes : le cercle, le carré et le triangle. » On remarque d'emblée, ces intervalles variables, ainsi que les « trous » en quelque sorte dans le texte, sur quatre à cinq lignes, donnant à voir les figures géométriques ci-dessus évoquées. Ces contraintes formelles énoncées – part au moins aussi importante que le texte lui-même – qu'est-ce qui est dit dans la soixantaine de pages de ce dispositif ? Eh bien, je crois, ce que montre la forme elle-même : l'aléatoire et une volonté de renouveler l'écriture et le rapport à l'écriture. « Réjouissez-vous de pouvoir être détruits par un texte illisible » écrit Jaffeux (page 13). Jamais de point à la fin des phrases, l'espace variable (selon le coup de dés) et la majuscule signeront le début de la phrase suivante. Ou encore : « Il redécouvre le langage d'une liberté parce qu'il appartient à des lettres perdues » (page26). C'est bien de cette liberté, paradoxalement mise sous contraintes, fût-ce celles du hasard, qui est l'enjeu et qu'on trouvera plus dans les blancs, les lettres perdues que dans le contenu purement sémantique des phrases. « Le hasart choisit des mots qui apparaissent entre des interstices injustifiables » (page 51) : qu'on ne peut justifier (en typographie : aligner ; dans le langage courant en établir le bien fondé). Sur la même page : « Célébrons des intervalles qui rongent un idéal de l'écriture ».
Le seul message, s'il en est un, répété rageusement, serait la célébration de la vacuité. Exemple :
« interagit avec un vide littéral Des courants
d'interlignes rafraîchissent un éventail de vibrations
lisibles Nos ombres sont au service d’un écart qui
appartient à ta lumière Un ordinateur corrompu
se conne cte avec la tension d'une image Il relie
la circu lation de mes silences à la fluidité de
vos c ontradictions Elles passent devant
des pauses qui négligent un travail de
no s mots L'univers d'un
espace contemple le destin de nos illuminations »
D'autres tentatives d'abolition eurent lieu, du fond, de la forme, et de ce qu'on voudra. Jaffeux se situe dans ces extrêmes qui, s'ils n'emportent pas l'adhésion facile du grand nombre, poursuit avec cohérence – peut-être bien que ce mot-là ne lui conviendrait pas – un travail de sape, toujours nécessaire quand bien même il ne nous plairait pas.
« Une écriture impossible absorbe le geste d'une distance inconnue La grâce d'un
support vole au secours d'une phrase décidée à épuiser une paire de dés On touche la
limite d'une ponctuation qui joue avec une disparition du hasart »
Fin du livre sur ce mot fondateur, semble-t-il. Le vortex blanc des intervalles et des figures géométriques, aussi transcendantes soient-elles, l'absorbe déjà.
Par Jean-Christophe Belleveaux
*
Deux
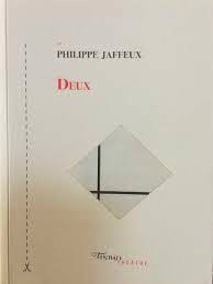
Il y a un aller- retour entre affirmation et négation, les contraires s’y côtoient comme des évidences ou des nécessités : L’intensité de nos extases et sa virtualité tragique, de même que le concret et l’abstrait cohabitent comme la joie et la douleur : L’équilibre d’un jour théâtralisé ressent l’aveuglement de sa clarté putrescible. Il y est question d’un personnage qui s’appelle IL apparaissant uniquement par sa conscience et ses pensées. Ce n’est pas un livre que l’on interprète bien que chaque phrase détachée soit sujette à réflexion, il est plutôt ressenti comme un rythme aux accords très réguliers qui lui donnent un air de tendresse, de déjà entendu mais où.
La grande utilisation du possessif à la deuxième et à la troisième personne assure une présence humaine invisible mais partout présente. Il s’agit toujours de quelque chose en cours qui préexiste avant le dire qui le rapporte. Il n’y a ni commencement ni fin. Sous ce flux de paroles, il y a beaucoup de vérités et de constatations : Nos paroles sont des images qui recouvrent une ambiance incomplète de ses perceptions. Ces possessifs créent un échange un dialogue sous-jacent qui assurent une pérennité qui laisse l’illusion d’un temps jamais défait, espèce de continuum qui est, peut-être, le véritable moteur de ce recueil : aller, aller toujours dans un présent qui nous rapproche de l’événement et du IL symbolisant les autres en une seule unité. Ce temps présent partout utilisé est une affirmation qui nie toute fuite possible. L’auteur tient le lecteur sous sa coupe mentale qui quelquefois agace notre lecture. Le livre fermé, nous l’ouvrons à nouveau.
Nos planches charpentent le paysage de notre flottaison sur les ressources d’un théâtre avorté. N’oublions pas, nous sommes au théâtre, théâtre humain où l’action n’y est pas située mais prend racine à l’extérieur dans la vraie vie. C’est un dialogue particulier où les répliques peuvent être interverties parce qu’elles ne sont pas la suite les unes des autres. Serait-ce l’impossibilité de communiquer entre les mots et l’expression de l’égoïsme ambiant et du chacun pour soi. Cependant, il existe des tentatives de présences, des ébauches à rechercher dans les profondeurs des répliques. Il existe un rapport étroit entre la parole, le mot, l’alphabet, la page, le mutisme et le silence sur lequel il faudrait se pencher dans une étude approfondie.
Tout égale tout, serait-ce l’ultime rapport, l’ultime constatation, la voix/voie royale vers l’acceptation de la vie, vers la sortie du théâtre pour aboutir au grand air de la réalité, la dépossession de toute chose, l’expression d’une égalité qui assurerait un bien- être à la manière des Epicuriens ? IL rattache le souffle de fer à celui de la mer pour renouveler l’air d’une permutation exacte. Y verrait-on l’ultime désir ?
Deux, chiffre de l’amour, du croisement, du dialogue, de l’existence de l’autre comme le laisse supposer Mondrian dans cette peinture de couverture épurée où l’essentiel y est dit d’un simple regard. Le livre fermé, j’éprouve la même sensation par- delà les 230 pages comprenant 1222 dialogues par des personnages nommés N°1 et N°2. Il me semble que ce recueil ne contient qu’une seule phrase à variantes inlassablement répétées s’approfondissant vers une certaine tranquillité qui exclut le doute par la pudeur d’une expression qui garde la mesure juste des propos et qui nous interpelle plus par la pensée que par l’émotion.
Par Jean-Marie Corbusier
*