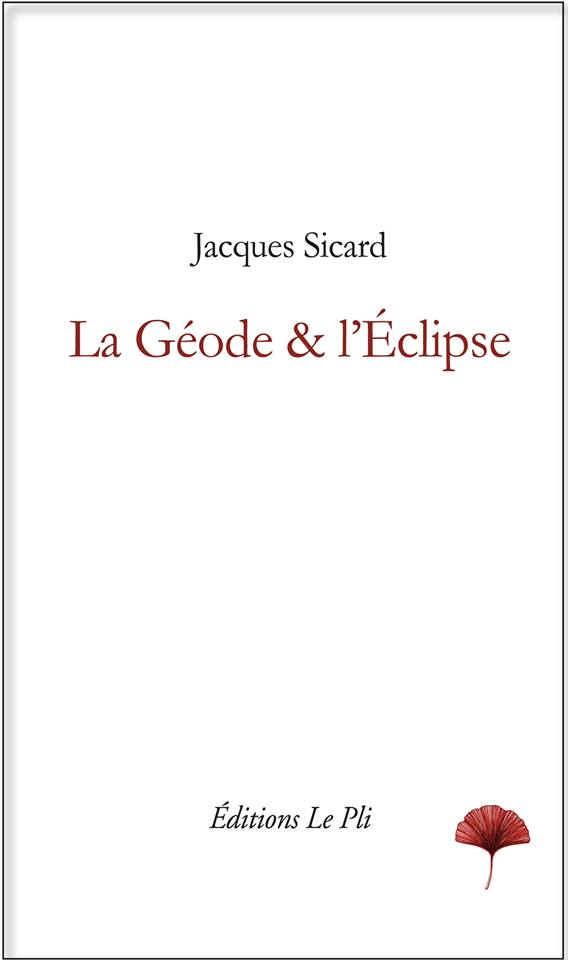Atlal de Djamel Kerkar : dyptique
1
Il y a les ruines de ce qui fut et les ruines de ce qui est resté inachevé. Les ruines ne racontent pas le monde d’où elles viennent, mais se présentent dans une durée dissociée de l’écoulement du temps.

Elles ne dépendent plus des conditions qui les produisirent, elles existent sur un plan d’exposition où la terre gaste tient lieu de cimaises. Leur sensibilité au passé ou à l’avenir est nulle. Les ruines, victimes d’une l’histoire qui les réduisit à cette mauvaise étoile où elles se sont installées à demeure, ont à jamais chassé de leurs gravats les simagrées des hommes. Ils balaient le long de cet inhabitable familier qui, n’ayant pas de dehors, ne possède non plus de dedans. Le bois de vieilles chaises, imaginées partie de son mobilier, alimente un feu de camp et aussi des palabres inquiets qui peu à peu s’estompent. Autour des monolithes ruineux patrouillent les tueurs militaires qui croisent les fantômes des tueurs religieux. La femme à jamais absente, son invocation répétée en fait foi : Orange était votre robe en ce temps-là de soie bleue.
2
Planéité du plan d’existence des ruines. Chaque détail qui s’y inscrit paraît être de la main d’un peintre égyptien du Haut-Empire, qualifié de scribe des contours et des formes. Ainsi une fenêtre ou une porte ou un mur délabré, son cadre, donne l’impression d’être vue de face ; tandis que son espace intérieur se tourne vers le côté, se profile ; l’ensemble est tel un œil qui regarde droit mais sans voir. Ouled Allal, 1997, l’aviation de l’armée gouvernementale algérienne déloge les GIA installés dans ce hameau stratégique ; plus tard, les rares bâtisses encore debout parce que piégées par les groupes sont dynamitées. Par contraste, le volume des hommes qui vivent au milieu des ruines, gros de vieillesse ou de jeunesse, gras de faits dont ils sont occupés comme un pays vaincu. Chacun y va de son histoire : la terre aimée et travaillée sans l’aide de l’État, après en avoir chassé les colons ; le récit halluciné d’un épisode de la guerre civile ; le crachat distrait du plus jeune sur l’engeance du demi-mort Bouteflika. Toute autre parole est mythologique, la radio y pourvoie, la voix haut perchée du chanteur, d’une tristesse aigrelette, suppliques adressées à dieu ou à la femme, qui se tiennent cois : Ô vous de lilas de l’Ouled Allal.