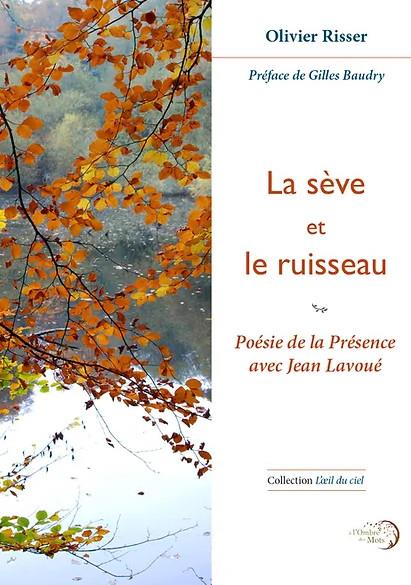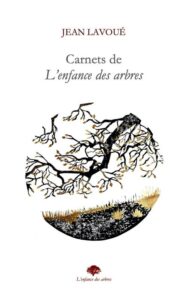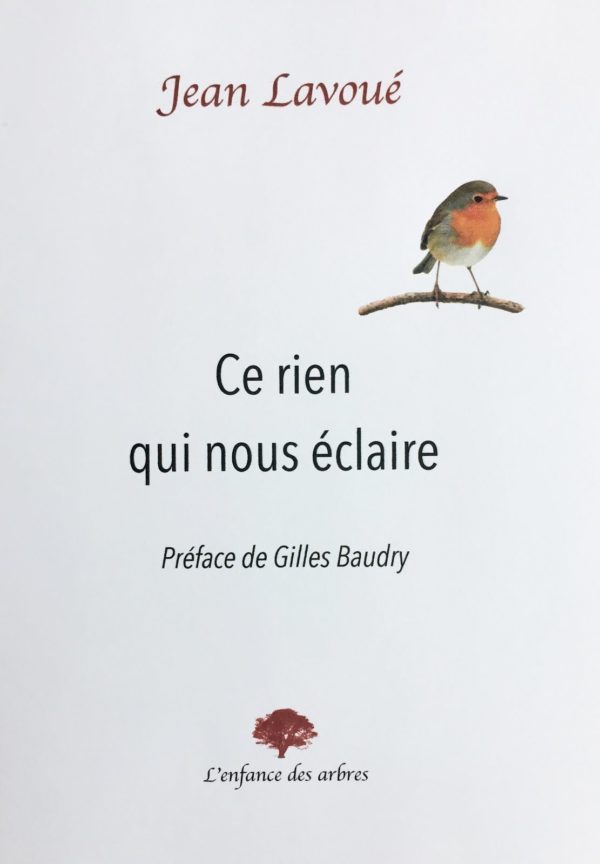Traverser les fragilités et entrer dans la lumière : hommage à Jean Lavoué
Lorsque l’on m’a demandé de parler de la poésie de Jean Lavoué, 3 mots me sont spontanément venus à l’esprit :
Fragilité Fraternité
Simplicité
Jean fut pendant plus de 40 ans en proximité avec la poésie de René Guy Cadou, Cadou qui, comme il l’a dit dans un entretien avec Karina Berger, a été la figure poétique et spirituelle qui l’a inspiré le plus. Leur proximité ne fut pas que littéraire, elle fut aussi en humanité car comme Cadou, Jean a su rejoindre ceux qui souffrent au cœur même de sa propre expérience de fragilité ; lui aussi a su traverser de façon lumineuse l’expérience de l’absence, l’absence de sa sœur décédée à 18 ans dans un accident, et l’expérience de sa maladie.
La fragilité, une blessure qui n’est pas un enfermement mortifère, mais une voie de liberté intérieure comme nous le dit Bernard Ugeux dans son livre Traverser nos fragilités : « On ne peut vraiment joindre les mains que lorsqu’elles sont vides… »
Héberger l'Inouï - Poésie Jean Lavoué, musique Pier d'Andréa.
Atteindre la liberté intérieure, c’est consentir à la réalité même douloureuse : « Quand la maladie parfois terrasse, se sentir à jamais/ de la vulnérabilité » avec ces mots de Jean, nous comprenons qu’il a su vivre la sainte blessure et vivre aussi en poésie cette parole de Matthieu (5-3) : « Quelle chance pour ceux qui sont en manque jusqu’au fond d’eux-mêmes ». Jean nous dit dans son ouvrage Voix de Bretagne – Chant des pauvres : « La pauvreté fondamentale celle qui nous fait manquants, marqués à jamais d’une cicatrice inguérissable ( …) d’où la poésie a jailli comme un miracle inespéré. »
Alors, Jean a su regarder les oiseaux du ciel et les lys des champs. Il a mis en pratique ces paroles de Jean Sullivan dans Paroles du passant : « Le bonheur est aussi dans le regard, une certaine attention aux étoiles, à l’herbe des champs. » C’est ce bonheur que l’on aperçoit en entendant ces vers de Jean : « Et si le silence se faisait en soi aussi fin d’un brin d’herbe. »Une poésie qui traduit ce que nous dit aussi Gabriel Ringlet poète dont Jean se sentait proche : « Vous verrez que l’amaryllis pousse parfois près des barbelés et qu’une lumière peut encore surgir au milieu des épines. » (Eloge de la fragilité)
Ces auteurs comme Jean, nous rappellent ce que Saint Paul nous a dit : « C’est quand je suis faible que je suis fort ».
Jean le savait, il ne faut pas refuser les épreuves, les blessures car elles peuvent mener à « une fête transfigurée »
Si tu te sens vulnérable
Incertain de tes jours
Tu recevras en toi
La vie comme un cadeau.
Les poèmes de Jean témoignent que la sensibilité, la vulnérabilité sont pour le créatif, pour le poète un atout et que la fragilité se change en force, car l’accepter c’est s’accepter, c’est élargir notre humanité et se reconnaitre vivant, c’est aussi consentir à se laisser aimer, s’offrir à l’amour qui nous attend :
Fragile mortel
Porté par cet amour immense offert
Injustifiable
Dont tu ressors lavé
Dans la nudité des premiers jours. (Ecrits de l’arbre dans le soleil)Et te voici maintenant
Presque aussi pauvre que lui
……..
Découvrir dans les secrets de sa propre mort
Sa plus belle promesse d’amour,
Cet inconnu fiché au cœur de sa vie ( Chant ensemencé )
La fragilité est une voie d’accès à l’intériorité car on est alors sensible à la dimension tragique du réel, avancer même blessé c’est devenir plus lucide : « Fou celui qui se croit à l’abri » dira Christian Bobin.

© Le Télégramme
Pour Jean comme pour René Guy Cadou, la poésie s’est faite « rumeur brisée du monde. »
Comme Charles Péguy Jean a su, « sur fond de peine, tisser la joie » car il savait comme François Cheng que les absents ces « âmes muettes » ne cessent d’être là.
Jean a su nous dire que si la graine fragile accepte l’obscurité de la terre, elle pourra s’épanouir et devenir arbre ?
Je conclurai ce thème de la fragilité avec ce poème extrait de son recueil Ecrits de l’arbre dans le soleil qu’il dédie à Christian Bobin :
Nous héritons tous de passants vulnérables
Qui ouvrirent pour nous des voies,
Sans connaitre le but,
Ils nous firent pourtant le cadeau
De leur absence lumineuse.
Si ces vers évoquent la déchirure de l’absence féconde, ils évoquent aussi la fraternité qui fut au cœur de sa vie et de sa poésie.
Je cherche comment
partager encore avec toi
le pain du poème.
Fraternité, c’est le titre de l’un de ses recueils Fraternités des lisières, c’est aussi le sous-titre de son essai René Guy Cadou la fraternité au cœur , Jean avait lui aussi la fraternité au cœur, très loin de l’esprit individualiste, il n’a cessé de s’ouvrir aux autres , la transmission est un don qu’il faisait aux autres , c’est dans cet esprit qu’il vivait les échanges sur son blog ou sur sa page facebook et qu’il entreprit de se faire éditeur.
Il se sentait en fraternité avec Simone Weil, Christine Singer, René Guy Cadou, Xavier Grall , Gilles Baudry, Christian Bobin, Philippe Mac Leod, François Cheng François Cassinghena Trevedy ou Philippe Forcioli pour ne citer que ceux-là. Et l’on a pu lire sur sa page facebook : « J’ai gardé l’habitude de partager de temps à autre certains de ses textes ( il évoque alors Christiane Singer) comme ceux de Christian Bobin ou d’Etty Hillesum. Voici trois auteurs qui m’accompagnent au fil de ce réseau et m’aident à garder une ligne de poésie fidèle à l’accueil inconditionnel, à la passion de l’homme, à la fidélité aux ressources inépuisables de la vie quels que soient les obstacles et les circonstances. »
Il a su entretenir un esprit de communauté poétique. Une fraternité de la tendresse et une tendresse pour l’humanité, il a regardé l’autre comme un compagnon, dont nous avons besoin, trop fragiles que nous sommes pour rester seuls, la poésie et les rencontres pour une présence au Monde.
Jean Lavoué a su nourrir son écriture de la fréquentation des autres poètes, rencontres et lectures pour nourrir son expérience d’intériorité. La poésie est une nourriture qui se partage et il nous invite au banquet :
La poésie nous redonne son oxygène
… comme le pain
Elle rompt l’ordinaire des jours
( Passio Vegetalis )Dans la demeure où l’âme
du mondea fait son nid
La table est toujours ouverte
Et le banquet n’aura pas de fin.
Jean Lavoué n’est pas seulement en fraternité avec les hommes, il l’est avec la nature, l’arbre en est le symbole :
Arbre de haute lignée
Oh mon frère
Toi que l’on ne regarde pas
………………………………………….
Le sang qui me raconte
Ta sève le prolonge.
Jean a su être le spectateur d’une œuvre, celle de la nature, il a su la regarder, elle est une expérience esthétique au sens de aisthésis ( faculté de percevoir par les sens) . La nature, il la contemple et il médite :
Je regarde le ciel
Comme un présent sans fin.
Jean-Louis Clouët à propos de René Guy Cadou parlait de la «géographie tremblante du chemin » J’ose le plagier et parler pour Jean de la « poésie tremblante du chemin ».
Des clairières en attente, Jean Lavoué, Médiaspaul 2021.
Ses marches dans la nature habitée de silence, l’initient et le guérissent. Au rythme de sa marche, sa poésie s’écrit :
Avez-vous déjà pratiqué la marche
Spacieuse
L’espace s’élargit à l’infini autour de vous
Et vous devenez le témoin silencieux
De tout ce qui respire en vous.
Jean Lavoué un homme et un poète qui marche. S’ouvrir en marchant au silence et accueillir car comme l’a dit Xavier Grall : « toute marche est une marche spirituelle », en écho aux mots de Xavier Grall, ces vers de Jean :
Marcher accueillir
Cueillir dans le silence de la nature
Les bribes d’un poème ou d’un chant
Constitue pour moi un exercice
spirituel à part entière.
La marche pour un chemin d’authenticité et accéder en simplicité à l’essentiel.
Comment ne pas penser à ces mots du Petit Prince de Saint Exupery refusant l’offre du marchand : « Si j’avais cinquante-trois minutes à dépenser, je marcherais tout doucement vers une fontaine. »
Jean a su en simplicité cultiver le temps de la lenteur nécessaire à la contemplation, alors adviennent la grâce et la poésie, la poésie qui est quête de simplicité, cette simplicité s’incarne dans son écriture, un univers fait de choses simples et familières, une simplicité nécessaire à la liberté spirituelle. Le minuscule, l’ordinaire, le rien amènent comme en témoigne le philosophe André Comte Sponville à l’oubli de soi. Les poèmes de Jean sont comme il le disait pour la poésie de René Guy Cadou, « lavés de tous les artifices ». Il a su chasser l’inutile, le superflu pour s’approcher de l’essentiel, il s’est ainsi ouvert au merveilleux, à l’inattendu, alors s’est invitée la joie :
Quand ton poème sera aussi pauvre
Qu’un peuplier se balançant dans la lumière
Alors tu n’auras plus rien à faire
Qu’à être là
Poreux aux murmures du silence.
Jamais Jean ne s’égare, ne se perd car il sait être dans cette simplicité qui est « sans certitude, sans but, sans prise, sans intention. » ( Nous sommes d’une source p. 51 )
Ecrire avec peu de mots, de pauvres mots ; pour faire advenir la poésie du silence, du vide, pour faire advenir la lumière Jean accède bien à ce vide lumineux qui, dit-il, a pour nom la joie, quand on est allégé de soi-même.
Pour Jean, comme l’a dit René Guy Cadou, « La vie fut simple et nue au bord du paysage. »
Trouvez votre cœur et changez –le en encrier » disait Max Jacob à son ami René Guy Cadou, Jean a trempé sa plume dans cet encrier, il a su parler à l’encre de l’âme, écrire de la poésie pour que la vie puisse reprendre. Il nous invite à « Suivre les sentiers de l’inutilité et de la poésie. » Il fut un sourcier en fraternité. Il s’est fait ce serviteur inutile mais serviteur de l’essentiel. Il est « cet épistolier du vent qui se confie aux arbres » selon le souhait d’un autre poète Jacques Robinet ; je ne sais pas si Jean Lavoué le connaissait, mais je sais pour les avoir connus l’un et l’autre qu’ils sont d’une même communauté poétique et fraternelle.
Jean l’homme et le poète a été là, simplement, il a regardé, il a contemplé, il a rendu grâce, il a su devenir plus pauvre pour accéder à l’essentiel et ouvrir des voies imprévues. Il a été ce poète qui se préparait « A la grande paix qui nous espère.
Jean était épris de beauté, de joie, de lumière.
La lumière Hélène Cadou à propos de René Guy Cadou a dit dans le Bonheur du jour : « Toi qui donnais lumière aux arbres. » En écho ces mots de Jean Lavoué dans Passio Vegetalis s’adressant à l’arbre : « Comme ta lumière m’appelait. » , par-delà le temps et l’espace, j’aime imaginer Jean et René Guy en cette même lumière fraternelle et éternelle.
Jean a eu une parole libre. Quand la poésie est accueillie, elle est terre de naissance et le poème accueilli fait naitre le poète. Ecrire, c’est aller à la rencontre de « cet inconnu qui nous habite », à la rencontre de la Présence car la poésie et particulièrement celle de Jean Lavoué est un lieu de révélation, de dévoilement en ce sens elle est évangélique.
Hommage rendu à Jean Lavoué dans le cadre du festival littéraire l’Esprit du Large à l’abbaye de Saint Jacut-de-la-Mer le samedi 29 mars 2025