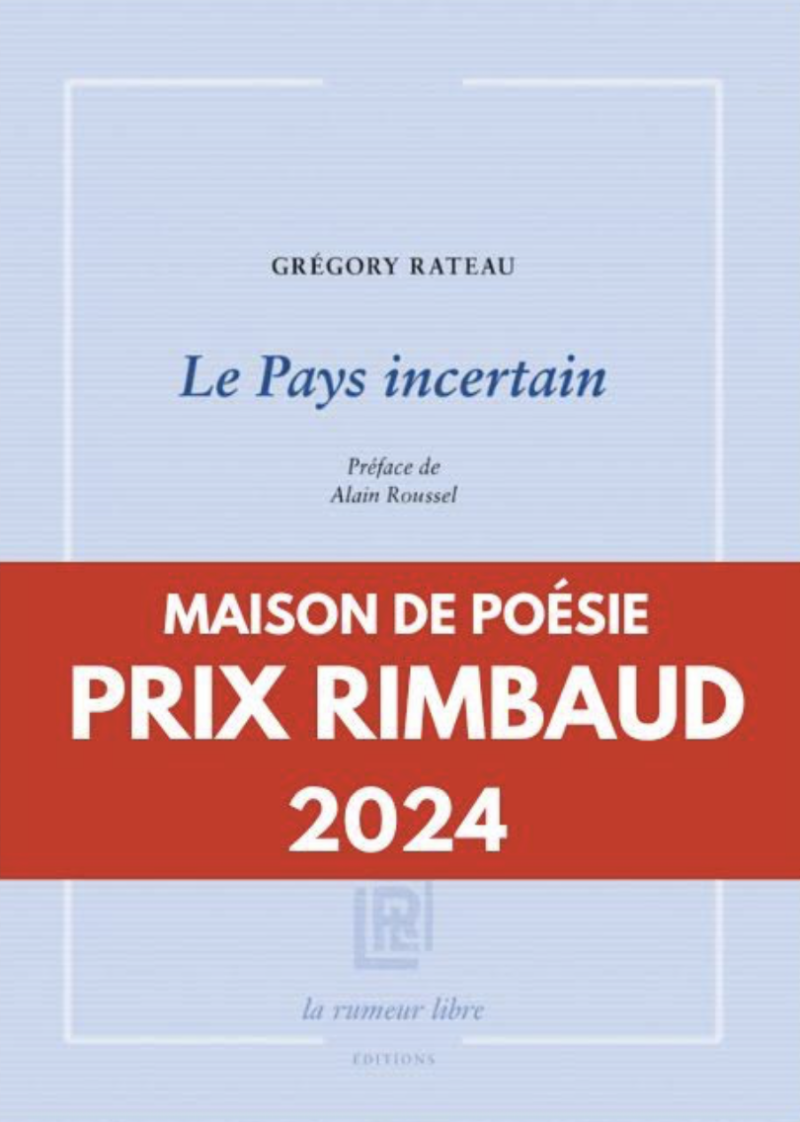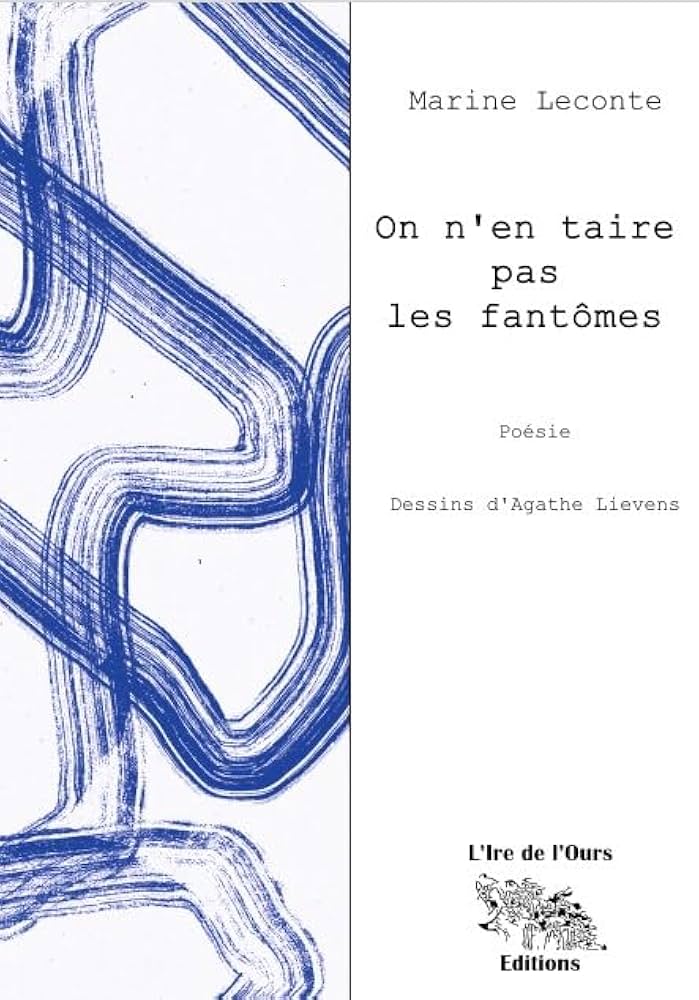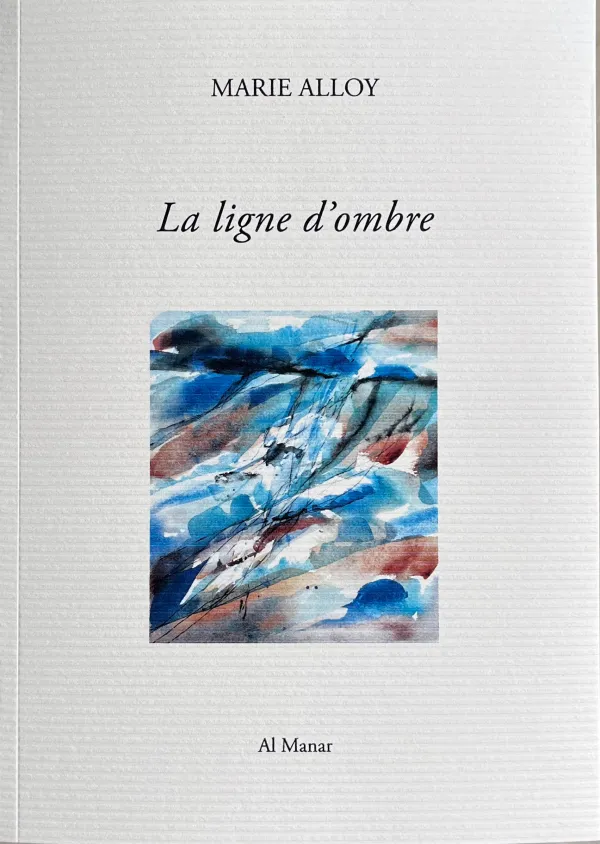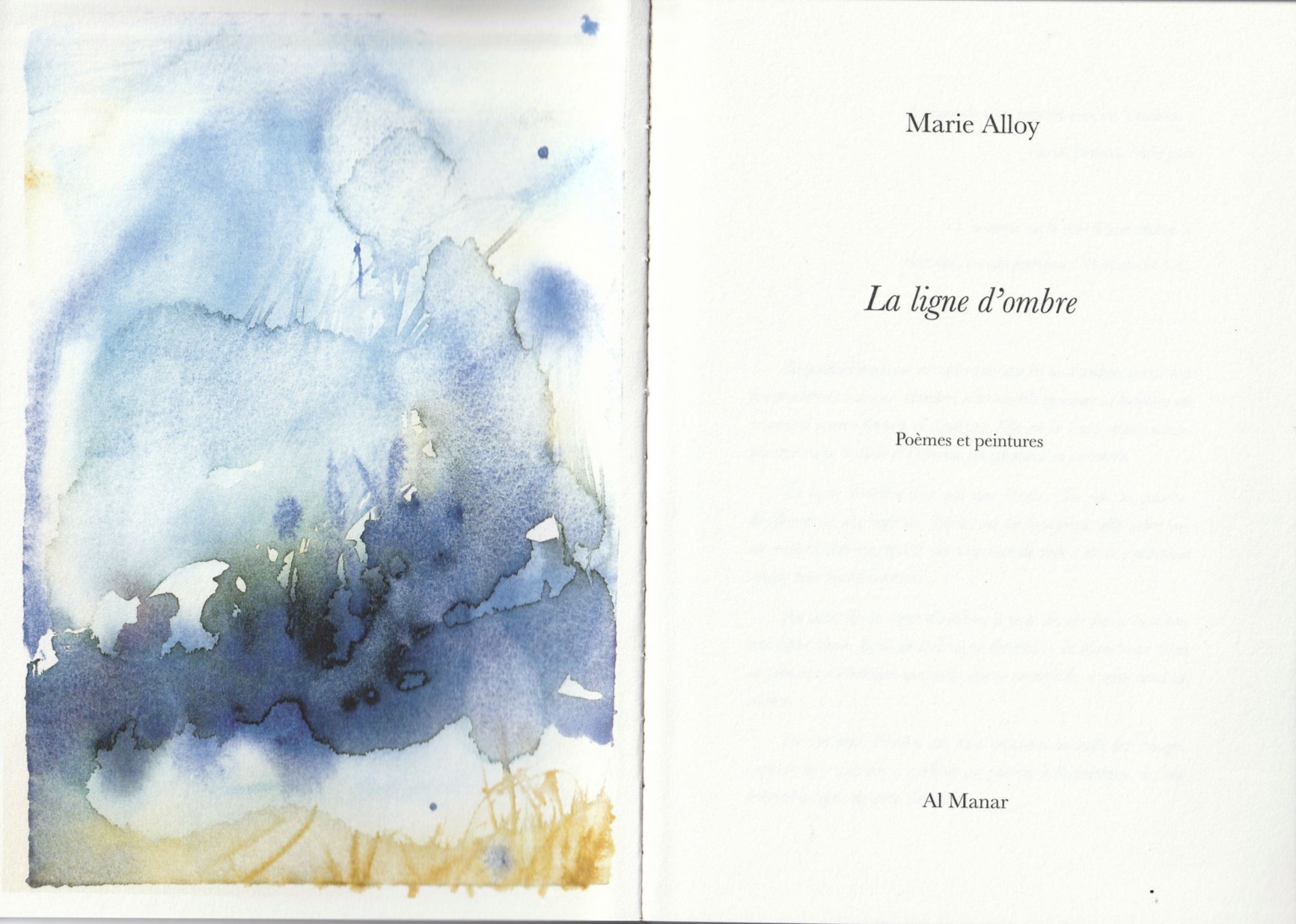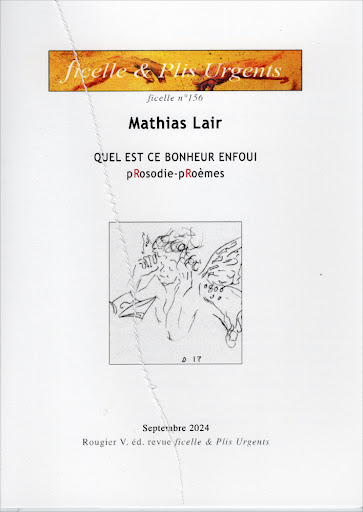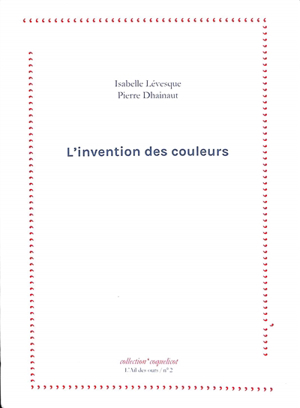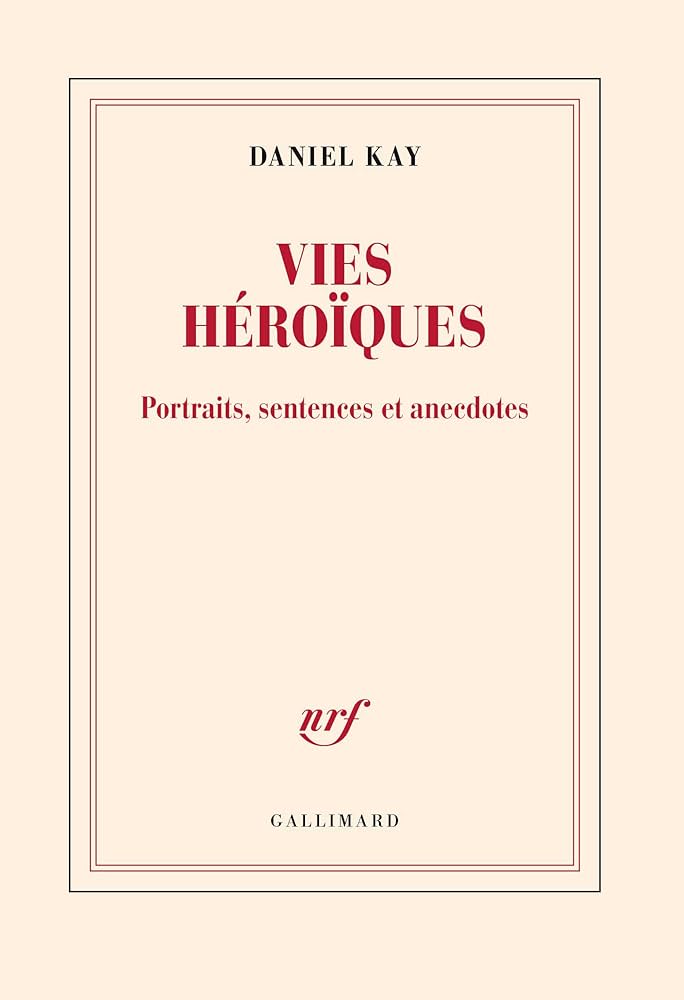Dans l’archipel du poème : entretien avec Sabine Péglion
Auteure de nombreux recueils, Sabine Péglion est une poète au parcours déjà long, qui a résolument placé la poésie au centre de sa vie. J’ai toujours été émue par son extrême sensibilité, l’acuité de son attention au monde, sous tous ses aspects, qu’ils relèvent de l’humain ou de cette nature dont elle aime à se saisir à pleines mains au quotidien, pour l’observer, la veiller au fil des saisons. Ses livres les plus récents sont parus aux éditions La tête à l’envers et à L’Ail des ours. Son écriture est marquée par la quête de la note la plus juste et de l’épure. Comme le cristal que l’on taille, ses poèmes s’ouvrent à la multiplicité des reflets et leur lumière vient nous toucher chacune et chacun dans la singularité de nos chemins et de nos expériences.
L’originalité de la recherche que mène Sabine Péglion vient aussi d’une double pratique. Elle écrit des poèmes qu’elle accompagne elle-même de dessins à l’encre de Chine, d’encres typographiques ou de peintures. Avant de nous arrêter sur L’espérance d’un bleu, son dernier recueil paru en juin 2024 chez La tête à l’envers, donnons à la poète l’occasion de parler des rapports qu’elle entretient avec la poésie ainsi que les arts plastiques. Écoutons celle qui a partagé longtemps littérature et poésie avec ses élèves, celle qui a animé avec passion des cafés-poésie où elle a reçu de nombreux poètes. Elle sait si bien l’importance des mots et de l’échange pour tenter d’approcher ce qu’est la poésie, ce qu’est une pratique de poète.
THE AUTHORS' VOICE - Un poème pour nos amis grecs, Sabine Péglion, TEXTO LEXIKOPOLEIO
Dans un entretien que vous avez accordé à Pierre Kobel, vous dites de la poésie : « Elle fait appel à tout notre être, pas uniquement notre intelligence » En quoi cet engagement de la totalité de ce que nous sommes est-il nécessaire ? Devient-il une sagesse, une sorte d’art de vivre ?
Je n’ai aucun rituel, aucune organisation réelle mais je note sur un cahier ou sur des bouts de papiers (qu’il me faut parfois retrouver avec difficultés) des phrases en apparence très banales, qui m’ouvrent intérieurement une voie, un chemin sur lequel je vais m’avancer. Peut-être juste l’ébauche d’un paysage, un geste, un personnage qui passe devant moi et dont l’image s’imprègne. Par exemple le poème «Le Pont de l’Alma» tiré du recueil audio «Rumeurs du Monde» est né de l’image d’un SDF, au milieu d’une foule animée, poussant un caddie sur lequel s’amoncelaient différents sacs plastique.
Effectivement, une fois le poème construit, tout un travail est nécessaire sur le rythme, les sonorités, pour parvenir à être au plus juste avec soi-même et se rapprocher au plus près de ce qu’on ressent en soi.
Poème de Sabine Péglion illustration de Renaud Allirand, ARTS ET LETTRES vive les artistes !
Lecture par Sabine Péglion de son recueil Ces mots si clairsemés Éditeur : la tête à l’envers, LautreLIVRE CA.