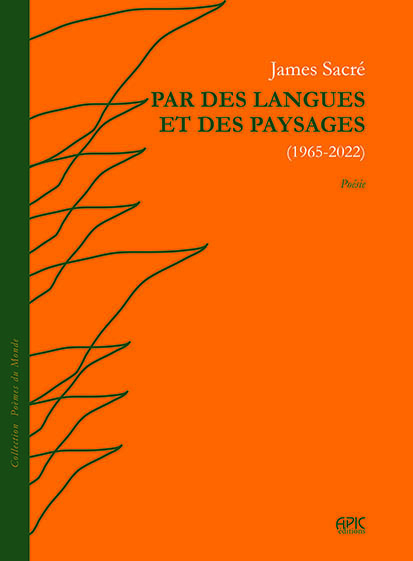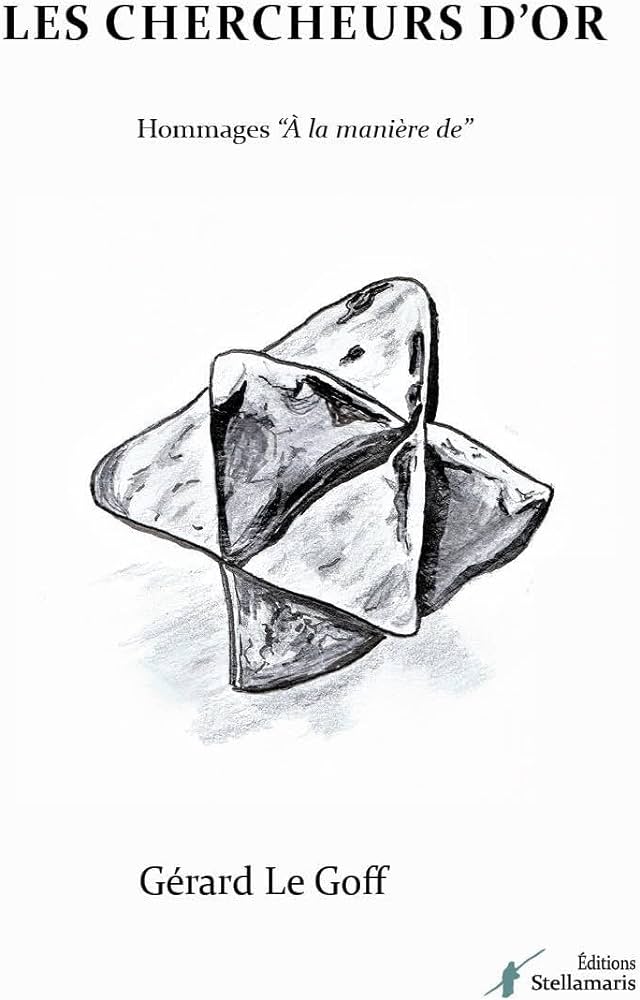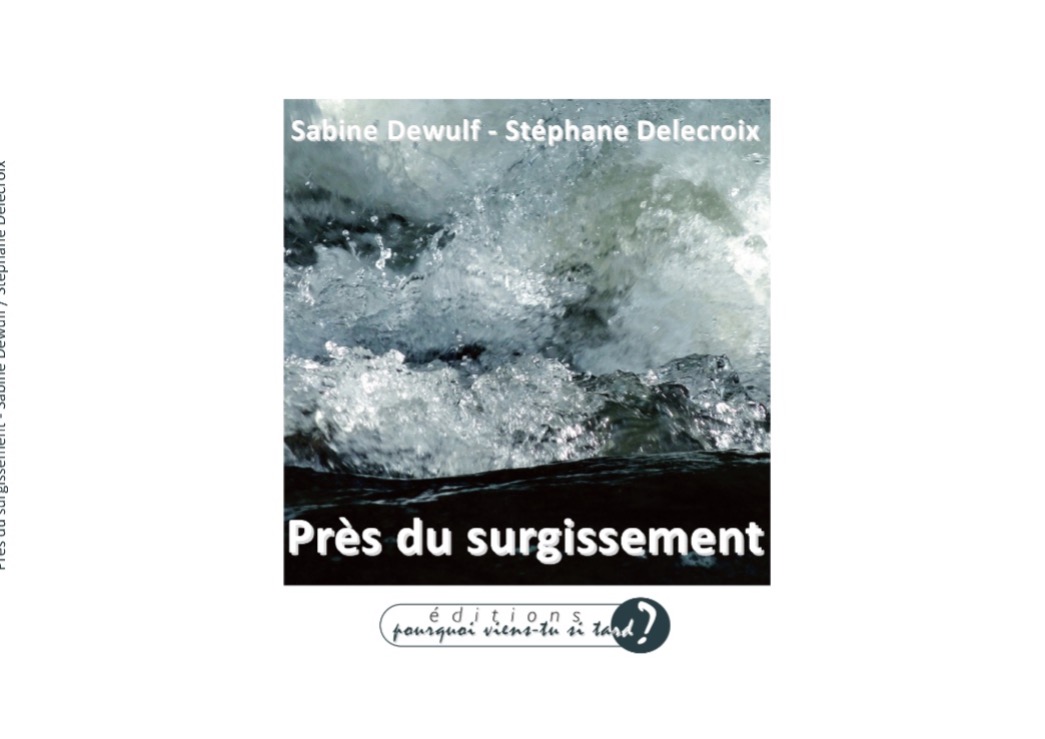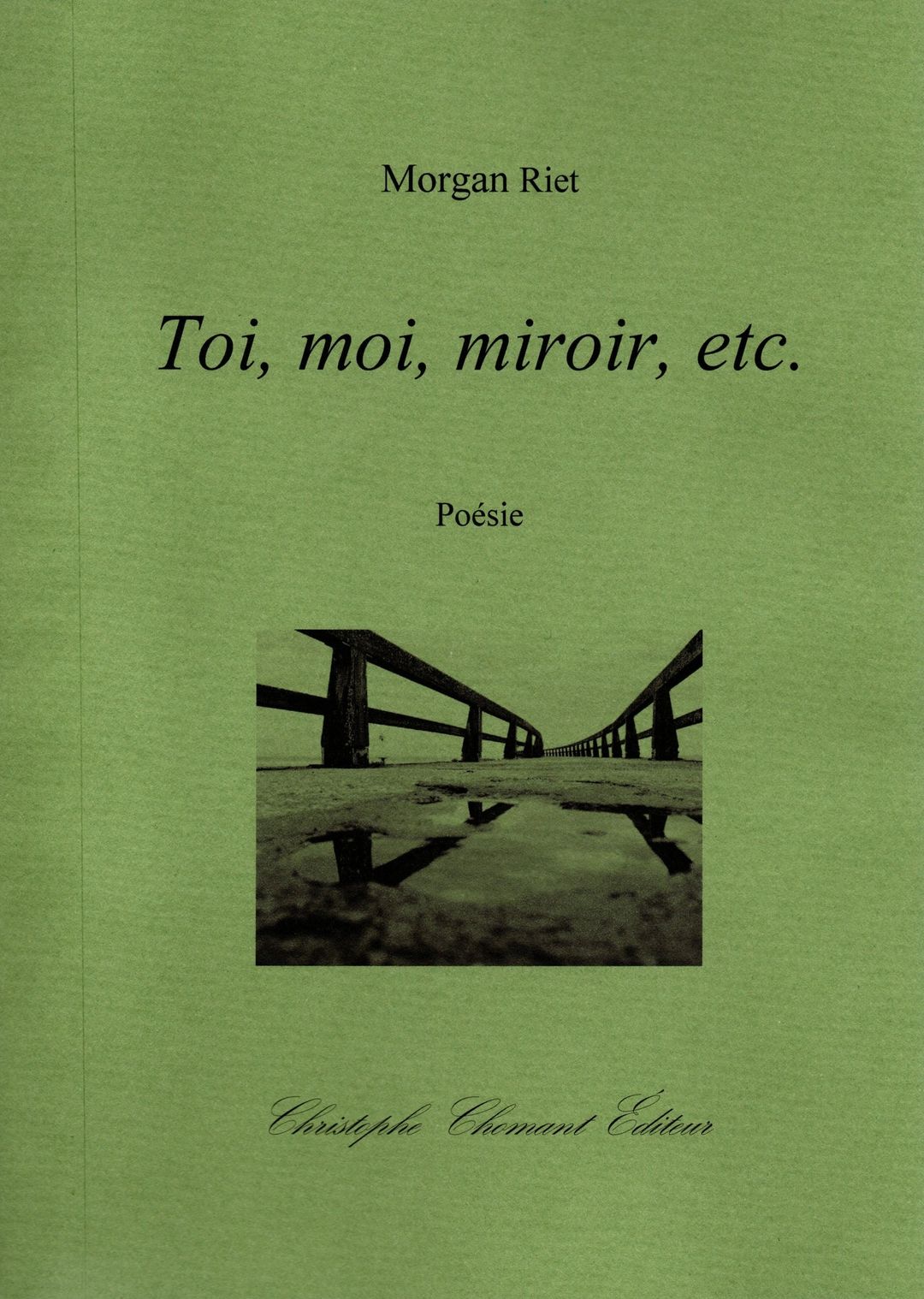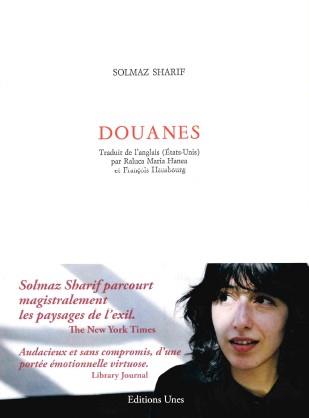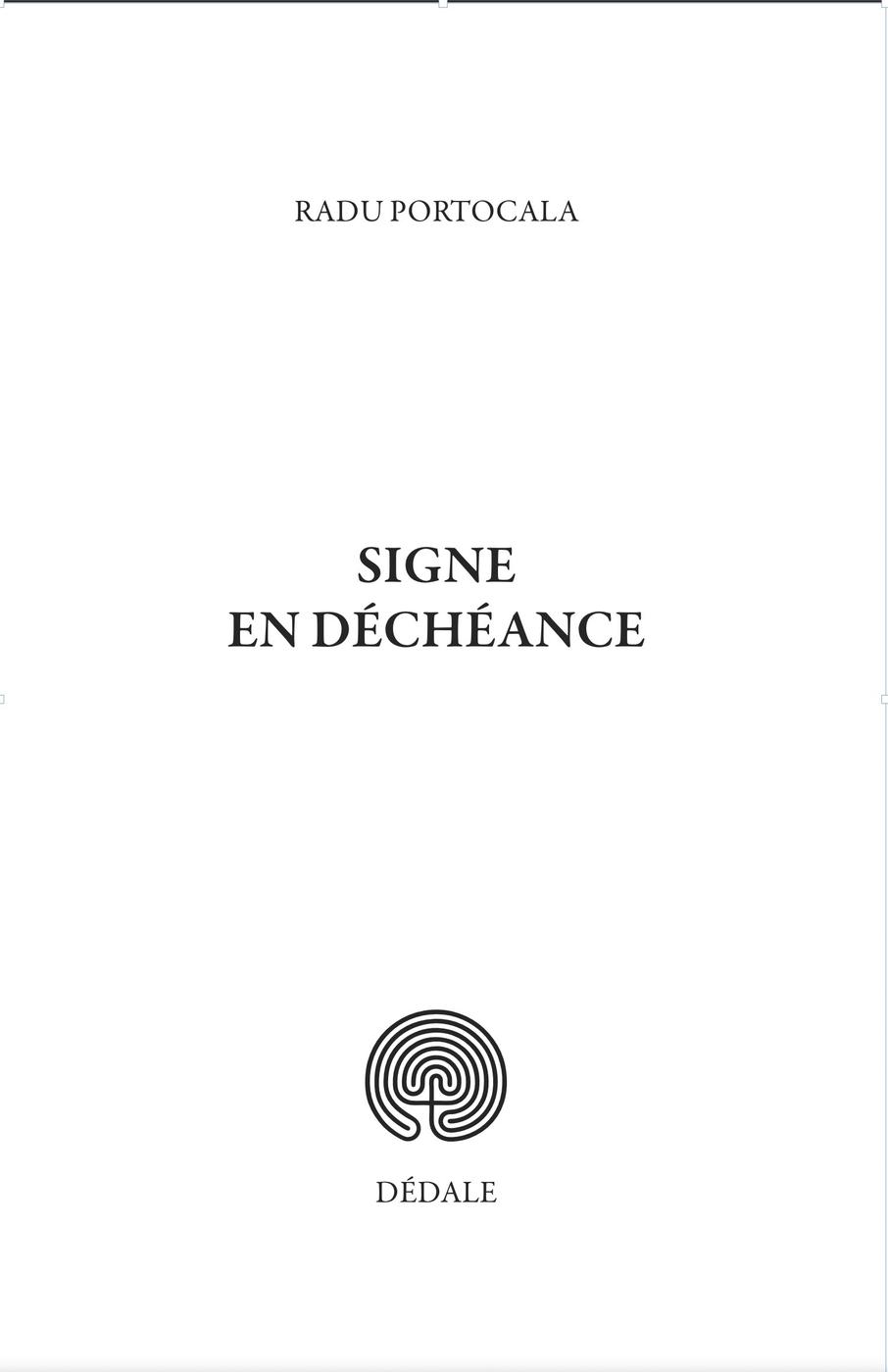Cathy Jurado, Intérieur nuit
Trois personnages ou plutôt, trois Personnes, d’abord, cette déchirure entre un « je » qui dialogue avec un « tu » lointain, impossible, parti, absent, et, ensuite, un « il », ici et maintenant. Le « il », géographe d’un cœur dont il ne connaît pourtant pas « l’hémisphère secret ».
Les saisons se succèdent, « Hiver, Printemps, Été, Automne, Hiver, Printemps, Été, Automne » avant l’Épilogue … Et tourne et retourne cette douleur d’être si proche du trop lointain et de rester à ce point étrangère à cet homme d’ici et maintenant. Le poème, en se déroulant, exprime cette tragédie intime et secrète, cette douleur de plus en plus insupportable d’un absent trop présent d’une part et, de l’autre, d’une présence trop terne.
J’ai tenté d’aimer sa maison
Son parfum sa cuisine sa géographieJe ne déferai pas ma valise ici
j’ai vieilli
j’ai vieilli en toi à travers toi
avec le temps qui nous a disjoints
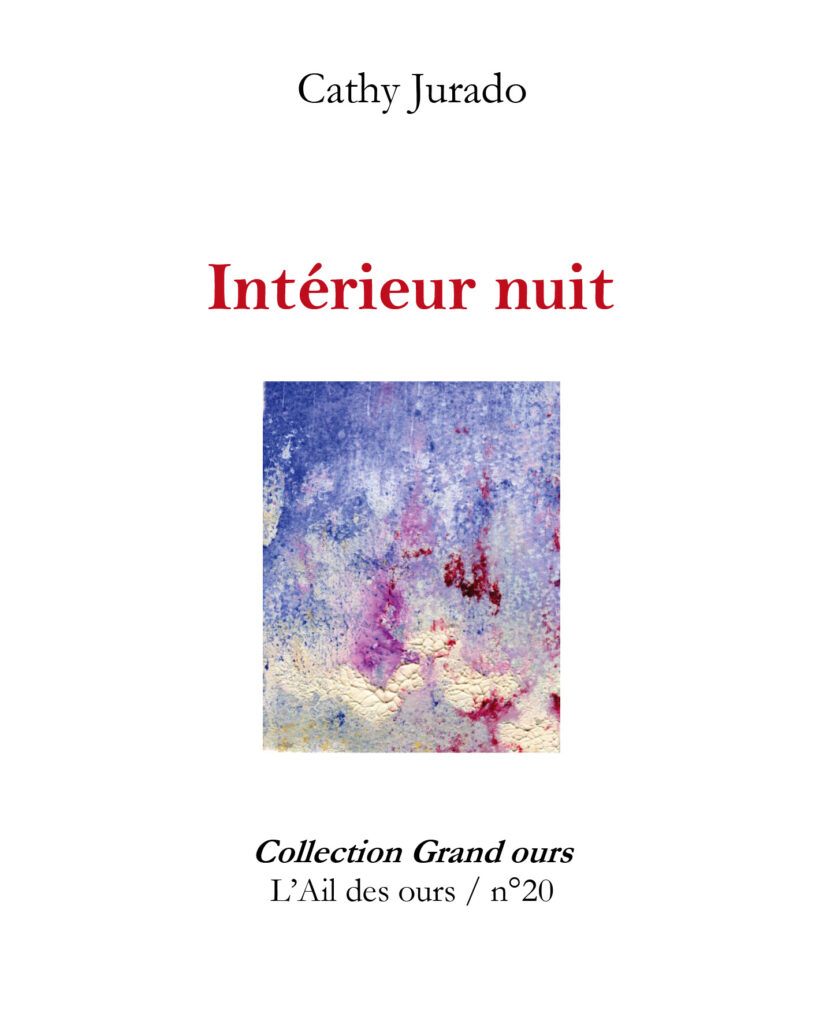
Alain Nouvel Cathy Jurado, Intérieur nuit, Collection Grand ours, L’Ail des ours / n°20.
Hantée par son enfance, par un passé qui ne passe pas, la narratrice qui dit « je » n’arrive décidément pas à aimer sa vie présente ni cette maison trop grande qui n’est pas sienne :
Je crois que cet homme devrait m’émouvoir
parfois lorsque je rêve
il enlace avec moi un peu de la pénombre
un peu des reliefs de mon rêve
parfois ses bras
font fuir un instant ton ombre et ce qui t’appartient
l’enfance qui ne me lâche plus
et même avec le temps
sa tendresse croît en moi comme une vigne
agrippée à la tristesse (…)
Cette maison est un refuge, mais seulement « lorsque s’éteint au-dedans / le poème incessant de la mémoire »
Ce « géographe », en effet, semble bien pitoyable, tentant de se faire aimer, doux et accueillant, en vain :
est-ce que tu te sens chez toi
comment répondre
j’ai mis un peu de musique
une chanson de Lhasa de Sela
où tu surgis toujours
Tandis que « toi », l’enfant aux ronces, tu sembles, au contraire, sans pitié, comme la vie, comme le temps. Tu pars, tu reviens, n’en fais qu’à ta tête.
tu conduisais trop vite
tu parlais trop fort tu avais faim
tu étais l’animal qui ne dort jamais
Quoi qu’il en soit, ce texte a la beauté d’une fable, ces trois personnages sont en même temps assez caractérisés et assez vastes et vagues pour devenir des allégories. Et, finalement, le « je » ne quitte ni tout à fait l’un ni tout à fait l’autre mais les deux à la fois, ce jeu pervers consistant à fuir la vie et préférer ses souvenirs idéaux.
Un très beau texte, très émouvant, très juste, très évocateur. Et une situation tragique à trois personnes magnifiquement mise en mots.