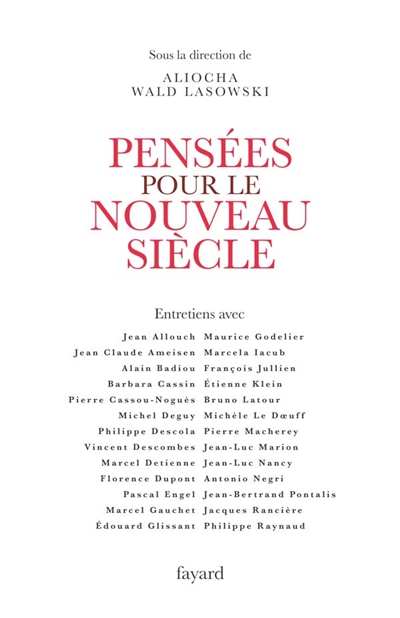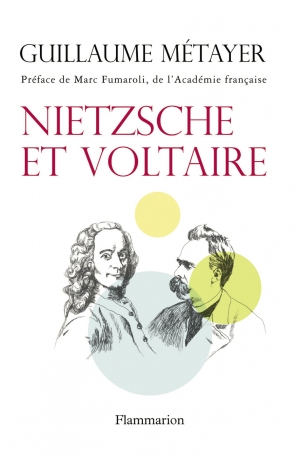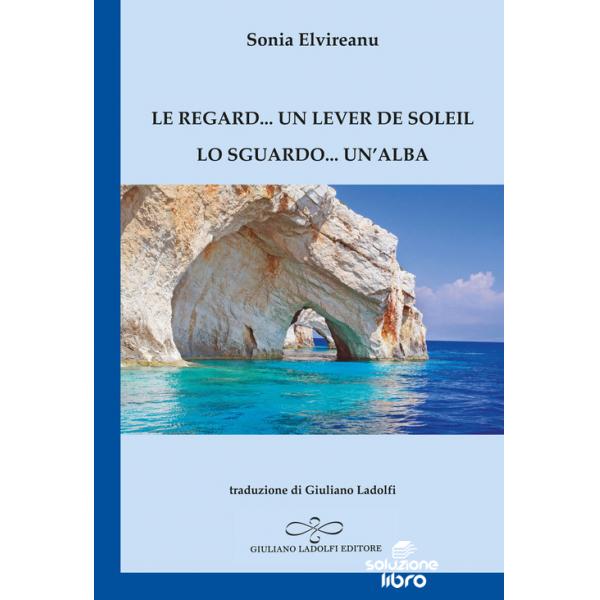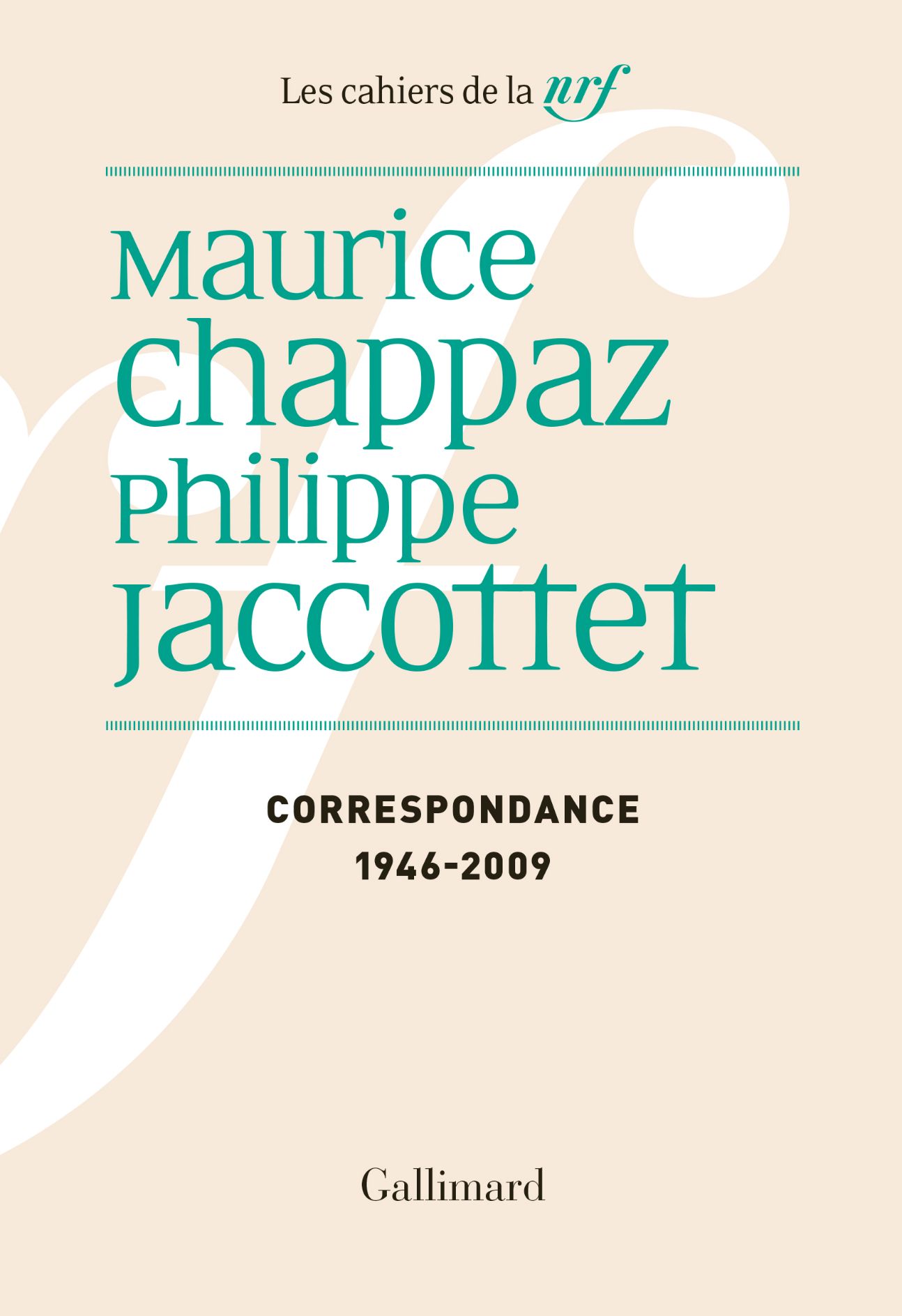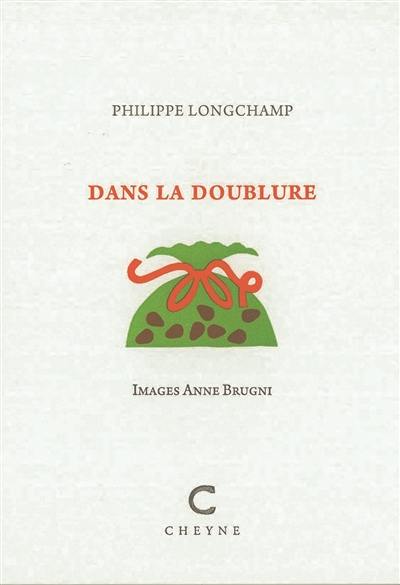Jean-Philippe Testefort, Salamandre et autres poèmes
Cette passion
Inutile entre toutes
Qui m’interprète
Doit en passer par quelque écriture sinon
Je ne suis qu’une plaie
Mutique et incompréhensible
Au corps-à-corps
Avoir l’expérience au long court
De tenir l’ultime verrou comme un garde-fou
Régénère par différenciation
Transfère le désir par contamination
Faisant signe de tous bois à l’encre sympathique
Peau, papier
Tant que la régénération ne s’amorce pas
Caresses et écrits vains tournent autour pour la provoquer
Pour que, à proximité de l’abîme
Métaphore et case creuse, fantasme et ratage
L’autonomie du lézard gagne sur la cicatrice
Que les griffes et les graphes épellent les chairs
Écorchent l’actuelle morphologie des conduites
Réincorporent les virtualités du vide et de l’absence
Aérant la baudruche moléculaire
Lui donnant le minimum d’une contenance
Restaurée
Qui la suspendra
Un peu encore
Aux courants des relations
Par lesquels se révèle la singularité
Involontairement déréglée
Contretemps en mode mineur
Dans les souples arcanes du réel
Plissé à l’extrême
Aimer
Extrait de On n’en meurt pas, j’voudrais juste pas crever, éd. Unicité (2021).
∗∗∗
De la base et du sommet
Sept fois pour le moins le cerveau dans ma caboche
S’était retourné avant que je ne m’engage
Mais un piège s’ignorant prend les traits du sage
Quand il ne remue que des images fantoches
L’hésitation vibre de ne pas savoir ce qu’elle sait, le miroitement débonnaire de sa
bouille convexe attise l’élan vers la lumière et emporte son aveuglant aveu de
gratification immédiate vers la ressource d’une souffrance d’abord illisible
La plus capricieuse dans ce ciné de mioche
Celle qui toujours me devance sans ambages
Maternelle à la façon des premières pages
Trainait son fantôme en invisible sacoche
Ainsi que l’on manque son train, il y a des ratés inauguraux qui présagent
d’insolubles tourments dépassant de beaucoup ce qu’un être normalement constitué ne
saurait endosser sans perversité sitôt en charge de l’affleurement concave et
ténébreux de l’autre
Un amour inconditionnel à la ramasse
Dessinant sa peine en courbes anorexiques
Ne peut guère ne pas se lancer dans l’impasse
L’incorporation repoussoir d’une brutalité patriarcale précocement subie enseigne
une méfiance stratégique pour laquelle l’indépendance prime, à la défaveur de
l’accueil
D’une quête acharnée au remède toxique
Cette fleur éternelle qui ne se dépasse
Qu’en sauvage déchiffrement de son lexique
Une emprise dédoublée s’exerce sans volonté au lieu mouvant de la différence, sur la
barre, écologie affective originale au risque des taxinomies emboîtées
Extrait de On n’en meurt pas, j’voudrais juste pas crever, éd. Unicité (2021).
∗∗∗
Au cœur de ce vif et perçant savoir
Du jeu miroitant des assentiments
Des invitations auxquelles se pendre
Infans je suis resté
À l’école de l’entrevu
Où les regards boivent leur confusion
Dans le tremblement d’une concordance
Piètre lecteur je suis resté
Hanté par la crainte de la méprise
Suspectant la possession de tous les maux
Et de commencer dès les premiers mots
À la frustre intuition je me suis réservé
Aussi n’ai-je eu de cesse de rêver
D’un langage
D’un langage de l’évidence
De l’évidence charnelle
Langage qui viendrait me prendre par la main
Sans équivoque ni déclaration
Langage des frissons
Des harmoniques qui nous chantent
Nous perdent
Nous perchent
Hélas !
Tant mieux
Extrait de De ma part du démon, éd. Unicité (2020)
∗∗∗
maintenant que
les saints même les républicains
essaiment dans le discrédit
des cartes de crédit
maintenant que
le pater la concordance le goût
comme la relation
confinent à l’incertitude
maintenant que
dans la vague des métissages
craquent les corsets du devoir
sous la botte du fanatisme nu
maintenant que
même notre bateau
de boat-people planétaires
peine à nous embarquer pour de bon
sans arrière-pensée
maintenant que
Extrait de délivrance du vers, éd. Unicité (2019)
∗∗∗
Délectation
Fenêtres ouvertes
L’air chaud te caresse les joues
Tes cheveux
Coupés fin
Te rafraichissent de leur humidité éventée
Le soleil à l’aplomb
Les arbres ont déserté l’asphalte
Comme quantité de voyageurs préoccupés de se sustenter
Tu es seul sur la route
Tu es content d’être ainsi seul
Au volant de ton véhicule
Bien calé dans ton fauteuil
La tête sur son appui
Bras et jambes détendus sans être ramollis
Tu te sens dans ton élément
Tu pourrais battre des records
Profiter du débrayage méridien pour foncer
Mais tu préfères prendre ton temps
Sans traîner
Tu observes l’exubérante campagne
Les ballots de paille fraîchement ficelés
Les courbes bien nettes des collines
Le damier des cultures à perte de vue
Ici les blés encore verts
Là le jaune strident du colza
Ou encore le mauve pâle du pavot
Les vignes qui se gonflent de lumière et de serments
Aux confins de la perspective
La chaussée gondole
Il ne faudrait pas de grandes œillères
Pour que tu te croies en Provence, en Castille
En Andalousie
Ailleurs
Tu viens de clore tes affaires
Tu rentres chez toi
Les vacances sont là, enfin
Pas officiellement
Elles ne débutent que ce soir
Elles sont en sursis
Et tu profites de ce rabiot a parte ante
Comme une gracieuse soustraction
Gratuite
Subreptice
La meilleure qui soit
Entre le déjà plus et le pas encore
Moment sans acompte d’une détente offerte
À la connivence sans pareil avec le ciel
En délire de pensées délivrées de leur laisse
Et qui, soudain
Te viennent à la pelle
Sans peine
Toi
Généralement si laborieux
Tu t’embrases d’évidences qui
Telles des bulles de champagne
Explosent en artifice dans ta tête et plus encore
Comme un intenable trop-plein
Dans ton sac posé à tes côtés
Tu cherches un crayon à tâtons
Une feuille, un calepin, une enveloppe
Vite !
Même un ticket de métro ferait l’affaire
Frénétiquement
En aveugle
Regard fixé sur l’horizon
Tu gribouilles quelques mots fugaces
Tremblants, illisibles
Puis tu reposes l’attirail et reviens à la route
Ainsi de suite
Quelques salves d’écriture acrobatique et de licence
mécanique
Plus tard
Te voilà aux portes de chez toi
Calme
Le sentiment d’un étrange devoir accompli
Prêt à redevenir le parjure du désir
Extrait de À tire-d’angle, éd. Unicité (2017)
∗∗∗
Pourquoi rester hanter par le spectre du cercle
Quand les visages des siècles éparpillés
Épargnent les piliers de la séparation
*
Tousse, crache, racle tous ces énoncés écorchés
La débâcle raisonnable de nos conduites
Pousse et cache la grammaire de l’impulsion
*
Qu’importe d’où vient le timbre pourvu qu’il frappe
Ses sillons écoulent les sèves anonymes
De l’effroi et de la joie, brodées en passions
*
Les rêves vitrifiés de nous en souvenir
Trament les contours de l’accueil privilégié
Où viendront se nicher nos sujets d’élection
*
Voir des signes partout à s’en décerveler
Au seuil d’une science éprise de retenue
Dans le moment final de la fulguration
Extraits de 111 tercets pour s’y faire, éd. Unicité (2016)-
∗∗∗
Nuances
Tout comprendre et ne rien savoir
avoir appris et réfléchi
pourtant et comme un désespoir
se sentir seul et bien fini
Avoir appris et réfléchi
du chaos ne rien entrevoir
se sentir seul et bien fini
un sentiment amer et noir
Du chaos ne rien entrevoir
pousser les causes à l’infini
un sentiment amer et noir
jeté sur un papier jauni
Pousser les causes à l’infini
ultime et vain cri dans le soir
jeté sur un papier jauni
tout comprendre et ne rien savoir
Extrait de Des ordres, éd. Encres Vives (2006), réédition dans Au temps où les fantômes m’enchantaient encore (Anthologie désordonnée 1994-2014) Unicité (2020)
∗∗∗
Le sanctuaire hors les murs
Et toutes les nuits ces chiens qui se parlent
comme s’ils aboyaient
Meski ou les sources bleues
préférer ne pas guérir du chaud
les yeux rivés sur une tresse en feuille de palmier
sentir le sec saturer le reste de fraîcheur de la nuit
et surtout
ne pas bouger
s’interdire la moindre velléité
pas même rêveuse
laisser les fourmis engourdir
l’oppression gagner la pensée
être las
entièrement déplié
à peine moins vigoureux qu’une grappe de dattes vertes
Extrait de Un carnet du couchant, éd. Encres Vives (2005), réédition dans Au temps où les fantômes m’enchantaient encore (Anthologie désordonnée 1994-2014) Unicité (2020).
∗∗∗
X = 0
Couché sous les étoiles comme pour la dernière fois
les sensations se ramassent en débris
Une interrogation incertaine
descend le long de sa ponctuation
et s’évanouit dans sa fuite
goutte à goutte
Une trace de question
pas davantage
ruine la vigilance de cette nuit bullée d’idées
Le vide intarissable et tenace infuse
le vide accéléré et débridé apaise
le vide exécute son frayage de vide par à-coups :
affluant, il ne peut se taire
lacunaire, il ne peut se dire.
Du dedans de cette déperdition
un murmure
un souffle
un bruissement
un râle
hululements d’indices effarés
donnent au pied une marche molle
transitoire reposoir d’une diagonale effacée
Extrait de À la fuite de quoi, éd. Encres Vives (2005), réédition dans Au temps où les fantômes m’enchantaient encore (Anthologie désordonnée 1994-2014) Unicité (2020).
∗∗∗
L’œuvre nous retient
là où elle fuit et s’annule
dans l’impersonnel
*
Je nais de l’œuf évanoui
des poèmes qui
m’ont anticipé
*
Chaque jour vivre content
de se voir plagié
par ses devanciers
*
Surplace migrer
vers la discrétion d’un oui
extrêmement nu
*
Nous n’avons pas su
nous taire aujourd’hui
demain sera plus heureux
Extraits de Les pas rayés, éd. Encres Vives (2007), réédition dans Au temps où les fantômes m’enchantaient encore (Anthologie désordonnée 1994-2014) Unicité (2020).
∗∗∗
Ellipse par le cœur
Hilare désormais
de ne pas t’appartenir tout à fait
dans cette mer aux humeurs lunaires
Un travers de mémoire ivre de découvertes
folie au souffle criant d’ironie
T’intime d’avancer sous mes pieds nus écorchés
Quelques nénuphars venus de nulle part
Ces frêles planches de salut
susurres-tu
S’affaisseront sous l’impulsion de tes chutes
Mais une course à fleur de peau
sans but ni ambition
Efface d’un coup de vent admiration et quolibets
Alors
ne te retourne pas
regarde l’impossible dans les yeux
Et tu me rejoindras de l’autre côté de la parole
Sur le versant de sa fabuleuse trahison
Anthologie Sète 2022, Voix Vives de méditerranée en méditerranée, éditions Bruno Doucey (2022).
∗∗∗
Pourra-t-on jamais sympathiser avec l’ébahissement engorgé, haletant, en suspension
d’avenir ?
avoir l’expérience d’une patience d’avant le mot patience, d’avant le sentiment, d’une
patience tout à son impatience encore, impatience qui n’en peut mais d’avoir à se rogner bon
gré mal gré
ne pas pouvoir se soustraire à cette expérience, comme une erreur, comme,
seulement comme, mais quand même, le réel en erreur, en solution ouverte, indécise, incertaine, précaire, un raté
qui prend, qui pince, insiste, persiste, s’accroche au réel se supportant de ne pas pouvoir faire
autrement que du réel, sans autre échappatoire que lui-même
féminine angoisse
découverte d’avoir à ménager
d’avoir à désirer
d’avoir à schématiser un commun sur le néant d’un besoin démuni, avide et à vide, par
l’exigeante sollicitation de l’immense et tyrannique poids déposé à l’arraché d’une douleur
tonitruante, délivré tout en cris, atrophié, ridé, corps gluant, sanguinolent, aveugle, incapable,
arraché avec les dents de cette poche femelle raréfiée, relevée par miracle d’une extinction
courue d’avance, presque
traversée femelle rendue féminine par le renvoi spéculaire de sa viscérale fragilité saisie
comme une foudre dans le geste même de demeurer auprès de ce corps strident,
insupportable, affamé
Extrait de Essai hypocrite sur le féminin et quelques thèmes adjacents, éditions Unicité (2023).