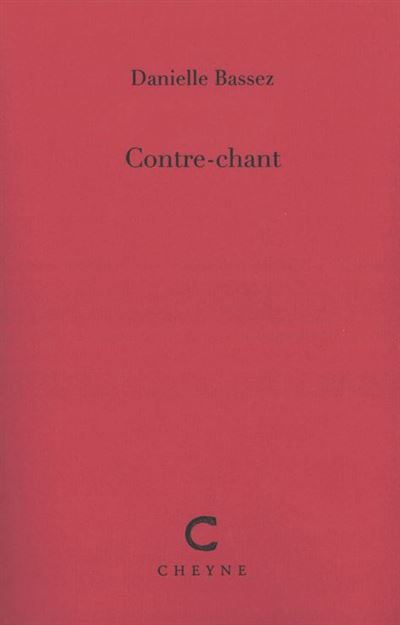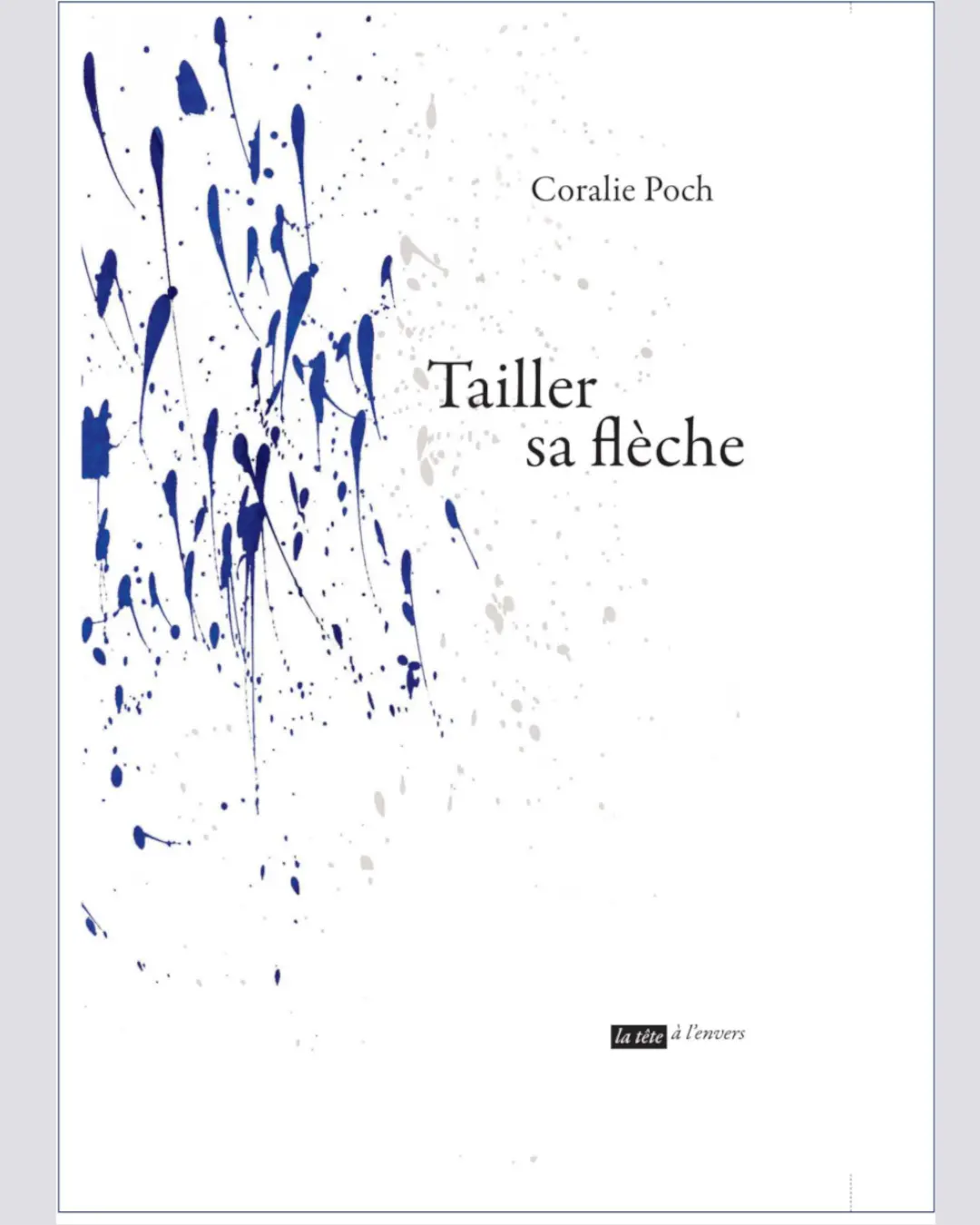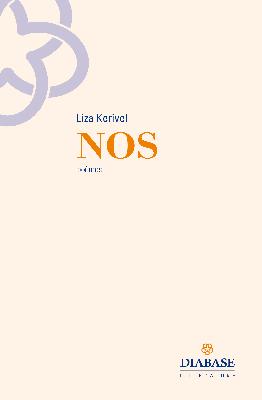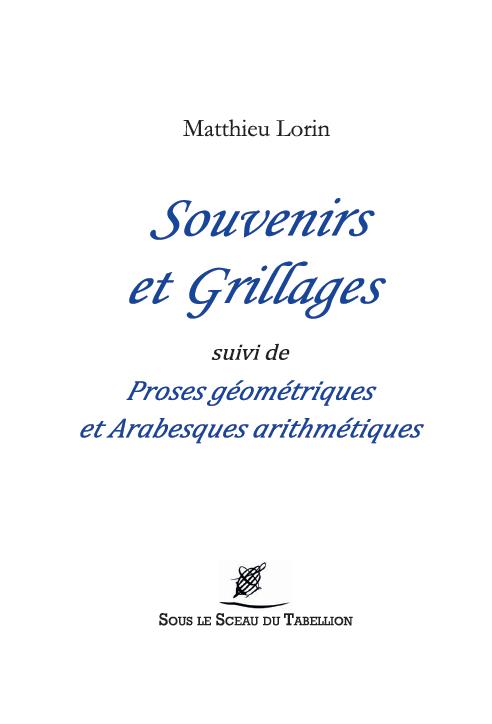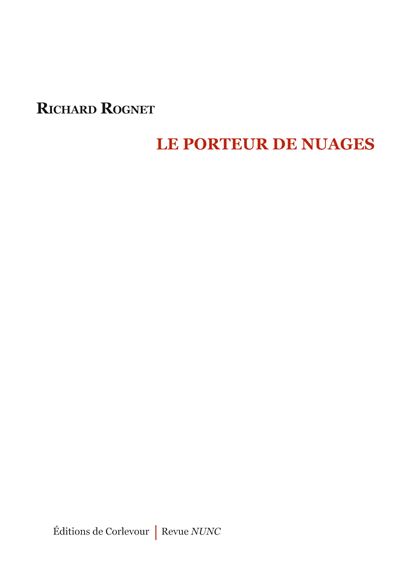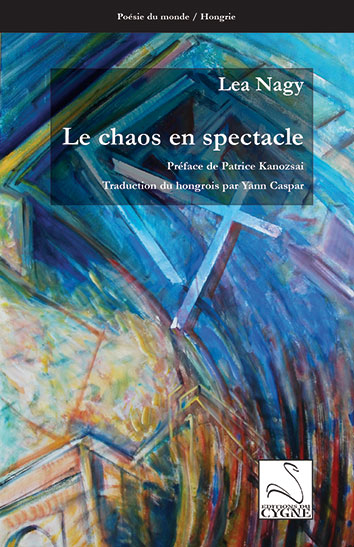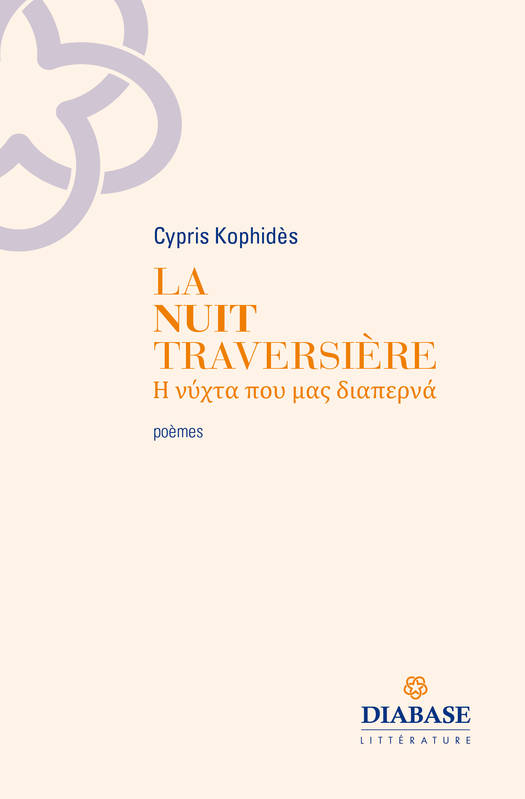Car tu es un personnage tragique, comme Phèdre, t’étant mariée par dépit avec un homme que tu n’aimais pas, après avoir vécu une passion impossible, être tombée enceinte de cet homme de l’Est que le rideau de fer t’empêcha de rejoindre. Tu te laisses enfermer dans cette vie familiale : « Dans cette affaire, tu es l’acolyte. Indispensable. Secondaire. Encensée. Accessoire. A côté (…) Tu regardes devant, très loin, quelque chose en toi. » Tu cherches ailleurs. Enfermée dans ta solitude, tes souffrances, tes passions, tes amours impossibles, la mort de tes enfants. Ces douleurs, tu ne peux les partager avec personne. Même pas avec A. Surtout pas avec A. Avec toi-même, seule, dans tes carnets. Pourtant, A. c’est ton Hippolyte « Charmant, jeune, traînant tous les cœurs après [soi] » (P.27) Tu l’aimes ainsi, d’abord, avant de déchanter.
« Et toi-même (comme) tu t’es perçue, équivoque, contradictoire, comme cette Pasajera, qui a envie de tous les hommes, de toutes les femmes qui croisent son chemin. Femme-delta. Mais après tout, as-tu conclu, les gens qui m’aiment, c’est cela qu’ils aiment. » (P.113)
Tu es bien une « Femme delta », une femme du Sud, tu viens d’Algérie, tu es cette étrangère qui portes « sur toutes les questions débattues un regard inhabituel. » (P.21) Pour A, tu es la mer et, aussi, la mère.
Récit à la fois simple, sobre, rempli de révélations et plein d’ellipses, où se côtoient prosaïsme et mystère. La si simple complexité d’une vie, les ambivalences si naturelles d’une âme. Le récit de détails et d’anecdotes qui complexifient. Comment la vie se mêle à la mort. Vous vivez avec A. une relation amoureuse non sans trahisons ni ambivalences, non sans mauvaise conscience ni intermittences du cœur.
Je t’aime, cela me suffit, te dis-je.
Je t’aime, cela ne me suffit pas, répliques-tu.
Ce déséquilibre presque métaphysique entre « tu » et « je », leurs deux façons de vivre leur relation, nourrit l’ensemble du récit. Vérité et mensonges de la tendresse, cruauté, intensité de la passion, des rencontres, infidélités, absolues mais éphémères, poésie des souvenirs, parfois délicieux, parfois terribles. Et A., ce témoin avide de tout comprendre de l’Incompréhensible qui se déroule sous son regard. Cet amoureux sans condition qui t’aura accompagnée jusqu’à la fin. Qui t’aura observée, entendue plus qu’aucun(e) autre. Pourtant, chacun dans vos solitudes. T’a-t-il comprise, t’a-t-il trahie ? Pourquoi cherche-t-il tant à te comprendre ? À te cerner ? Phrases sèches et incisives, comme des lames de rasoir.
Tes amants sont des amants de rêve, de nuages, et dans les faits, ils sont peu nombreux. Dès qu’ils prennent chair et os, ils te déçoivent. En quelque sorte, tu mènes une double vie, dont les niveaux se superposent : celui de l’imaginaire, où poussent les fleurs de l’amour idéal, et l’autre que tu nommeras, sachant de quoi tu parles, la réalité rugueuse. (P.27)
Un récit naît de la douleur, un poème d’évidence et de mystère celui d’une vie qui n’est pas arrivée à se dire, ni à s’écrire. Qui finit par se dire et s’écrire, pourtant, grâce à un(e) autre. Un poème comme une tragédie est un poème. Toi, tu resteras pour toujours silencieuse, désormais. Tragique de ce qui se dit, de ce qui ne peut se dire, de comment on le dit ou ne le dit pas.
Tu élabores des plans, cherche (sic) un ordre. Classes des brouillons qui s’empilent. Y reviens, les transformes. Tu n’arrives pas à coudre ensemble toutes les pièces de ce roman. Tu te fatigues. Tu traînes derrière toi cette œuvre inaccomplie, comme un remords. (P. 136-137)
Il faut attendre ta mort
Tes carnets, il m’était interdit de les lire (…). Tu te méfiais de moi, à juste titre. J’étais curieux de ta vie, je voulais tout savoir (…), je les lis.
J’encaisse les coups. J’apprends d’abord que tu écris la nuit (…) Ainsi, je dors, et je n’ai rien senti. Je n’ai pas senti que tu ne dormais pas, que tu te levais, que tu t’installais à la table de la cuisine, à trois heures du matin, pour t’y délivrer de choses que tu ne pouvais dire en plein jour. (P.13-14)
Mais A. accomplit-il cette œuvre que ta vie porta sans pouvoir la réaliser, ou la trahit-il avec Contre-chant ? Qu’il ait lu ces carnets intimes et qu’il en ait révélé le contenu, qu’il en ait « compris » la portée, est-ce un accomplissement ? Il écrit moins pour toi que pour lui. Post mortem, il a dû se déshabiller de celui qu’il avait cru être, accepter cette douleur que tu lui avais cachée : qu’il ait pu te décevoir, que tu aies pu regretter d’avoir tout aban-donné de ta vie pour lui. « Je lis. Il me faut des jours pour m’en remettre. J’écris pour donner forme au torrent qui m’étouffe » (P.14)
Néanmoins, A. fait ton éloge, conte dans ses nombreux méandres ton histoire, qui est aussi celle, tragique, de l’Europe, une histoire pleine de bruit et de fureur, de rideau de fer et de liberté. Tu as vécu la guerre et la Résistance au Nazisme, les débuts des purges tchèques du communisme naissant, ton premier fils vient de là. Et tu deviens, avec ce Contre-chant, grâce à l’amour de A., un personnage, un symbole, un emblème, un mythe moderne ?
Un récit brûlant, haletant, puissant et sans complaisance, d’amour adulte.