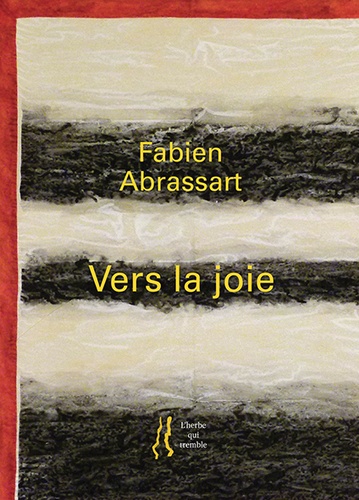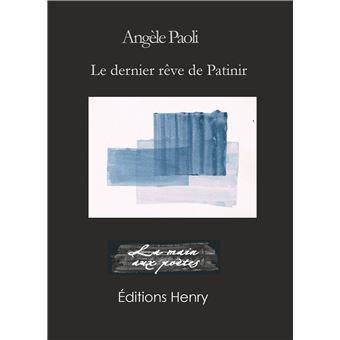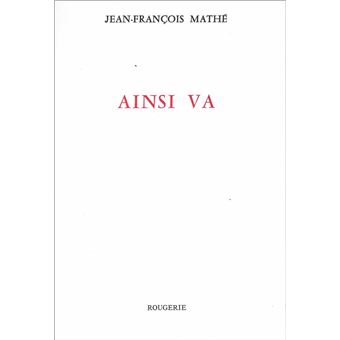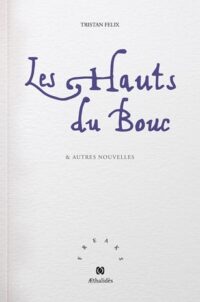Leo Zelada, Transpoétique
Ce recueil est une anthologie du poète péruvien Leo Zelada, composée de sept parties dont les premiers textes sont parus en 1993 et les derniers sont des inédits. Transpoétique est le nom donné à l’une des suites de poèmes publiés en Espagne en 2016, c’est aussi le nom d’un de ses plus beaux poèmes.
Transpoétique, comme son titre l’indique, nous emporte au-delà du poème. L’utilisation du préfixe suggère le changement : changement de lieux (l’auteur a quitté son pays natal pour parcourir le monde), changement de style (underground, dystopique, fantastique…) et changement de culture (Zelada est marqué par les plus grands poètes de tous les temps et de tous les continents, de Baudelaire à Kafka, de Cervantes à Blake, de Pessoa à Borges, d’Héraclite à Li-Tai-Po (il adopte alors, dans Le chemin du dragon, les formes de la poésie et de la sagesse d’extrême-orient : koan, Yuefu, Haïku…). Transpoétique, parce que le préfixe suggère également la « traversée » : dans son sens premier, le poète a traversé les Amériques, allant, sac à dos, de Lima à Los Angeles, mais aussi traversée de l’Océan et, au sens figuré, de la vie. Des moments douloureux au cours desquels ses idées suicidaires l’entrainaient dans un monde d’illusions et d’hallucinations (cf. Délirium Tremens). Seule la poésie me sauvera du délire, écrit-il.
Zelada écrit contre la solitude, les mots naissent là où les cigarettes et l’alcool ne peuvent plus rien :
La fumée de la cigarette
n'apaise pas mon angoisse,
ni l'alcool incessant qui imprègne mes veines.Loin de ma patrie je cache mes larmes
dans un parc isolé
où la nostalgie me dévore.
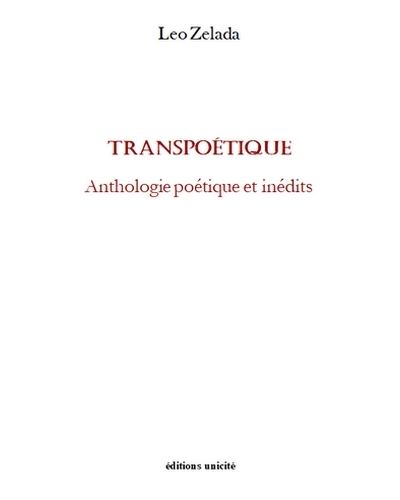
Leo Zelada, Transpoétique, Traduction de Laura Magro Peralta et de Maggy de Coster, Unicité 2022, 82 pages, 13 €.
Hanté par la mort mais sans cesse en quête de lumière, de beauté et d’amour, l'homme sans ombre qui porte sur son dos l’abîme de son être avance envers et contre tout, guettant chaque signe – le monde en regorge « pour qui veut voir » – dans l'imperturbable inclémence du vent, la voracité insomniaque des vers, où les mots sont d’étranges oiseaux que Léthé emporte… et il écrit, même si dans le poème intitulé Koan de l’illumination, la sagesse chinoise lui enseigne de brûler le papier et la plume…
Je n'ai pas peur parce que je n'ai rien
la chance vient quand vous n'attendez plus rien.
La poésie de Leo Zelada se construit sur l’exil. Un exil sans fin, inévitable car le poète sait bien que toute citoyenneté est illusoire :
La poésie est ma seule patrie
et sa langue ma langue universelle.
Transpoétique signifie aussi « à travers la poésie». Entre un hymne au soleil et l’invocation de l’esprit de la nuit, le poète nous offre une poésie sombre habitée de cris de désespoir, d’incantations et de prières, à travers laquelle il rend hommage à son père (le premier poème est écrit en Quechua, la langue de son père, celle des Incas), dans un véritable hymne à la culture de ses ancêtres où transparaît une étrange symphonie de couleurs. La lune et les arbres y sont rouges, les étoiles, vertes, la bière et le désir, bleus, le soleil, blanc... couleurs qui se répètent d'un poème à l'autre, d'une image à une autre, en particulier le bleu qui apparait pas moins de treize fois dans le recueil. « Lorsque l'écrivain répète un mot qu'il a déjà écrit, il montre par là-même qu'il lui est difficile de se séparer de ce mot, que dans la phrase où figure ce mot, il aurait pu dire davantage. »1 Zelada dit à minima, il utilise la couleur pour faire vivre ce qui ne se dit pas, ce qui ne se voit pas, ce que l’on n'entend pas, ce qui peut-être reste caché dans son inconscient, et c’est toute l’âme Inca qui se révèle et éclate dans la solitude grisâtre de l’exil.
Si les dieux sont omniprésents, il y a dans cette anthologie une autre présence, quasi constante : celle de la poésie, avec laquelle l’auteur entretient une liaison charnelle :
Quand j’écris, je traverse la nuit pour toucher de mes mains
la beauté cachée de la page blanche.
car la poésie est amour, un amour véritable :
-Poésie-
j'ai essayé de t’embrasser comme on étreint la nuit.
La poésie, dont les mots seuls ont le pouvoir d’apporter lumière et couleurs au sein même de la douleur et du manque :
Se réveiller sans le parfum bleu de ton haleine
c'est creuser la solitude marine du désir.
La poésie, qui accorde à qui l’écrit un pouvoir surnaturel :
Toutes les constellations de l’univers tiennent dans ma main.
Oscillant entre réalisme et pensée magique, la poésie de Leo Zelada est habitée par un souffle puissant, mêlant les images avec impétuosité et éclat, où les expressions populaires s’invitent dans des vers au lyrisme savamment dosé. L’homme, qui invoque le soleil tout autant que les esprits de la nuit, porte en lui toute la mythologie inca et quand il dit : J'ai été protégé par la splendeur maternelle de la lune, on comprend qu’il ne s’agit pas d’une simple image poétique, mais que le poète est « fils » de la lune. Comme il l’est aussi du soleil, astre présent dans de nombreux poèmes, et que, par son écriture, il reflète l’image du dieu Pachacamac2.Car l’écriture a un pouvoir purificateur :
Les poètes sont des chats libres
qui contemplent la nuit avec des yeux purs.
Il est regrettable que les traductions soient de qualité très inégale (celle de Laura Magro Peralta nécessitait une relecture car certains textes ne semblent pas à la hauteur de la poésie de cet aventurier solitaire, cet homme-loup comme il se définit lui-même qui, après avoir fréquenté les bars jusqu’à l’ivresse, avance au milieu d’une foule triste, enveloppé de silences/et de métaphores brisées, et écrit des vers empreints de mélancolie et de folie (Si un poète ne parle pas de l’humain, il n’est pas poète, écrit-il) mais au cœur desquels surgissent à tout moment le feu, les couleurs et les dieux.
Notes
[1] Sigmund Freud, Psychopathologie de la vie quotidienne.
[2] Pachacamac : dieu inca, fils de la lune et du soleil.