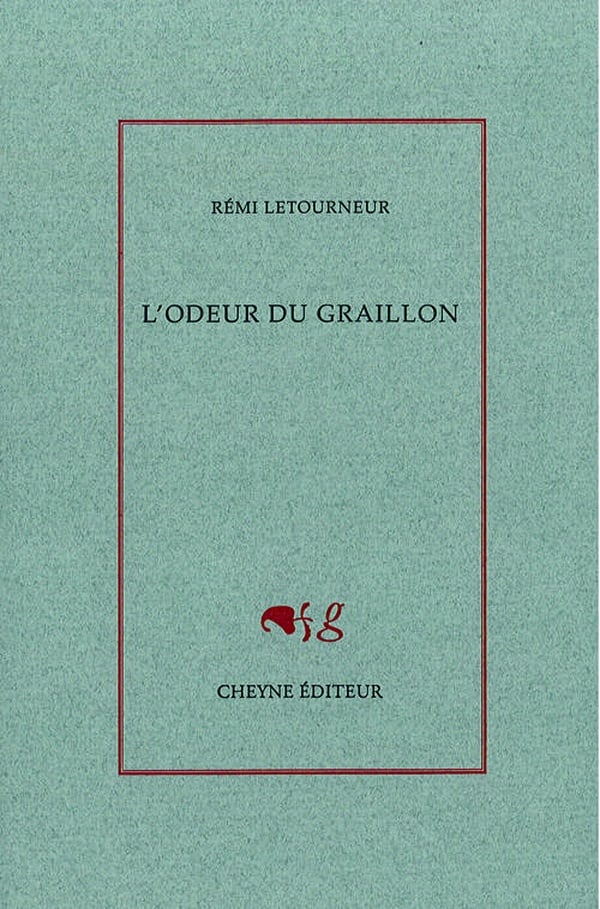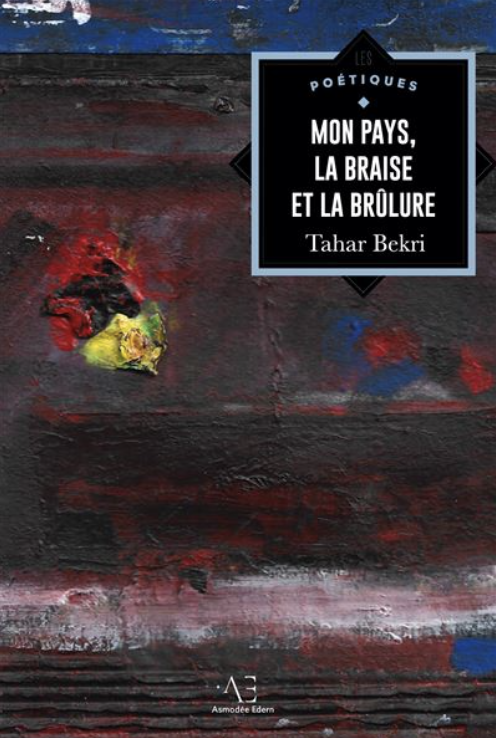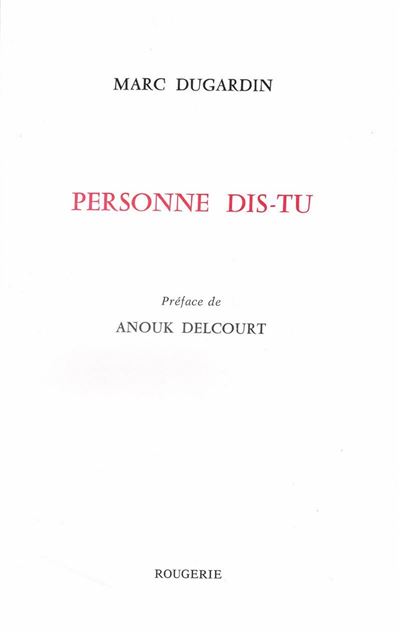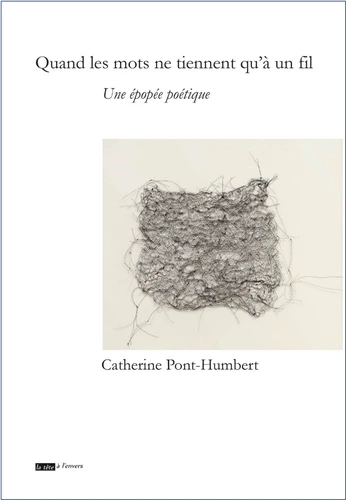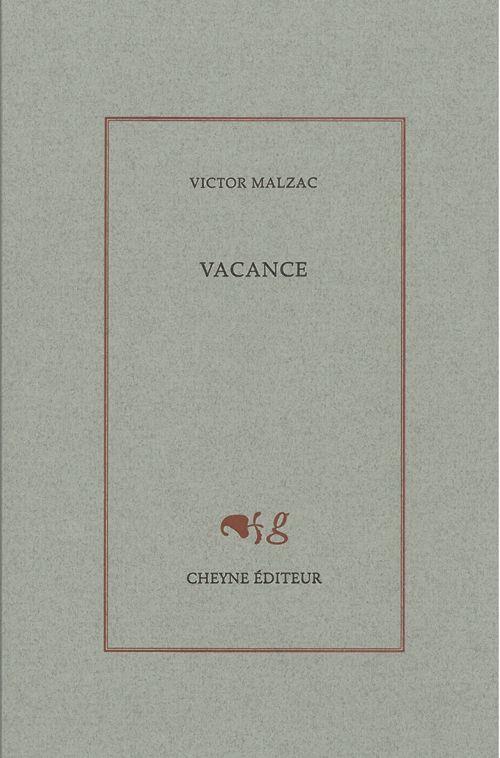Claude Ber, Le Damier de vivre
Ouvrir ce beau livre de Claude Ber, auteure récemment d’Il y a des choses que non (2017), La mort d’est jamais comme (2019) et Mues 2020), c’est tout de suite tomber sous le charme, la grâce même, des cinq aquarelles de Gérald Thupinier qui accompagnent les quinze poèmes en prose de Claude Ber, splendides à leur tour, riches, intenses, vitaux dans leur rythmique souplesse.
Deux arts s’entretissant, s’honorant si finement, tout en dépliant la pleine subtilité de leur distinction esthétique, sans aucun geste d’illustration et loin de toute ekphrasis. Et puis les premiers mots de la première suite, ‘Pavé noir, pavé blanc. La marche du cheval d’échecs sur le damier de vivre’ (I), confirment le haut et dansant sérieux du poème, la puissance de son attachement à l’énigme de notre présence au monde : sa mouvance, son ‘jeu’, son incertitude, ce sentiment de hasard qui habite sa logique. Suit le début d’une longue et cascadante perspective sur l’immense, à jamais mutante gamme de notre vécu, tantôt superbement appréciée, tantôt naviguée avec difficulté ou douleur : ‘Le tragique des destins et l’éblouissement renouvelé d’exister. Les pointillés du bonheur entre les drames. Le chapeau de la cime dégringolé dans l’abîme et la main pleine au poker de la plénitude. L’hécatombe du cancer et l’apogée de la jouissance. Case blanche, case noire. La dévastation de la terre et la mansuétude de l’amour. L’inhumain de l’humain toujours recommencé et le désir dressé en oriflamme…’ (I). Tous les éléments de ce qui est et ce que nous sommes, inextricablement cousus, brodés, dans la même étoffe moirée, chatoyante, à peine crédible, mais là et partout, ‘dans, écrit Ber, l’inusable bascule des vagues rabâchant leur éternelle redite de mort et renaissance’ (I).
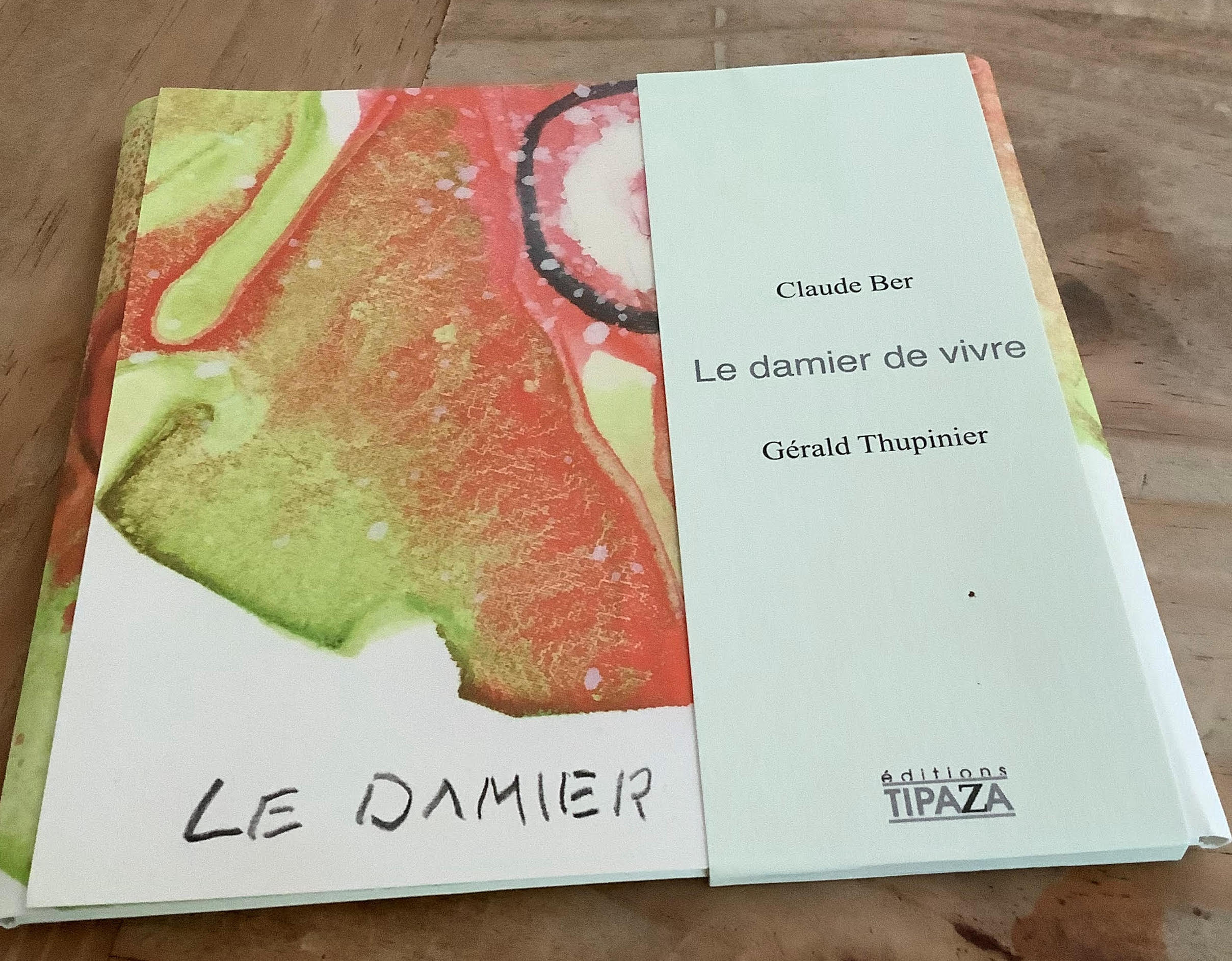
La deuxième suite creuse davantage cet étrange enchevêtrement de l’émerveillement et de l’horreur face à ce qui est, comprenant que ‘mathématiquement les raisons de désespérer équivalent à leur inverse sur la durée de l’éternité’, Ber soucieuse d’ajouter ‘mais qui peut compter sur l’éternité?’ (II), le mortel semblant vouloir afficher son absolutisme quand on observe, avec le poème, les infinies preuves de la non-continuité de la chair, surtout celle que l’on ne cesse de manger, ‘dorades et congres, branchies asséchées [à l’étal]’, ‘tête de veau bêl[ant] de toutes ses mâchoires mortes’, ‘graisse de cochon égorgé’ pour accompagner nos désirs de ‘paix et bienveillance’ (II). Et toute cette tensionnelle contradiction-fusionnement comprise comme si manifeste, si vieux jeu, ce qui pousse le poème à se demander ‘à quoi [la parole peut-elle] aspir[er] qui n’ait été déjà tant répété que ne reste d’elle que la carcasse?’ (II).
Et juste au moment où le poème paraît prêt à acquiescer à une condamnation de ‘l’humanité catastrophique de mon humanité [,] sa présomption et sa bêtise belliqueuse[,] son insatiable avidité et son dénuement[…,] son poids d’irrémédiable tassé au fond d’un sac biodégradable’ (II) – juste à ce moment critique, ce point de rupture irréparable, il – le poème, tout ce qu’il représente d’indicible, d’imaginable, d’improbable et de possible – replonge sa conscience dans ‘les aloès fleuris et bourdonnant d’abeilles’ de la troisième suite (III). Dans, dirais-je, un Cela, dont parlent précisément les Upanishads, et qui semble excéder même tous les signes de cette espèce de binarité, de dialectique qui persiste à vouloir dominer notre conception vécue de ce qui se passe au cœur de notre être-au-monde, ce noir-blanc, cet abîme-cime que le poème déploie. Règne ainsi cet indivisible sans nom véritable, cet infini contenant tous les noms, irréductible, car un Un au-delà de ses foisonnantes multitudes, offrant l’expérience de l’ineffable de l’amour, sans doute, pénétration dans ‘la fente de la vie même entre-baillée. Une pause de paix dans son bruyant silence. Ma main augmentée de magie caress[ant] ton visage. Son éclat rayonnant dans la bouffée solaire des mimosas. Leur poussier de clarté comme une réminiscence. Une invite à notre propre lumière aussi fragile et passagère que la leur. L’aimer, dépiauté de mainmise, la vibration le prononçant, y déclin[a}nt un absolu accessible. Intact du mot qui le désigne’ (III). Voici un passage extraordinaire, splendidement visionnaire, ouvert sur tout ce que le langage parvient à peine à murmurer, pris comme il est dans les rets paradoxaux de son besoin de dire ce que Bataille et Blanchot appelaient ‘l’impossible’, d’articuler l’indésignable.
Et tout le recueil, avec ses quinze suites et leur si serein dépliement de phrases courtes, lestes, fluides, bi- ou tri-partites, jamais gonflées ni désinvoltes car site d’un vécu intensément et pourtant généreusement caressé – tout le recueil puisant inlassablement dans un visible, un sensible, ces infinis micro-expériences de ce qui ne cesse de surgir d’un macro-phénomène où tout s’interpénètre et affiche ses interpertinences vivement senties quoique logiquement fantastiques. Le sentiment de ‘l’horreur du monde [qui] n’entame pas la magnificence de l’amour qui n’entame pas l’horreur du monde’ (V) reste le signe le plus vif de l’ubiquité d’une plénitude combinatoire de l’être. Le poème y ‘acquiesce’, semant partout dans ces riches suites ‘décrass[ées du mythique] et de [toute] prétention abusive’ (VI) les signes d’une ‘beauté’ à la fois ‘inaccessible’ et ‘évidente’ et d’une ‘bonté pour essuyer sa peine’ (VIII) au sein de ceux d’un ‘accablement de bœuf harassé’ qui risque de déborder (X). Cette totalité de ce qui est marquerait tout d’une grande intensité dans l’expérience de Claude Ber et en affirme sans cesse la haute et absolue pertinence de ‘n’importe quoi’, cette ‘certitude’ (XI) de ce que Jean-Paul Michel appelle le là de notre être-là. ‘Ma vie, lit-on, toujours branchée à son voltage. Intensément puissant. Intensément intense’ (XI). Un rapport, un lien incassable, électrisant, sans fin énergisant, venant des choses qui sont et du moi qui les vit, dans, simultanément, leur nudité et leur ‘transfiguration’ (XIII). Car, comme la dernière des quinze suites nous fait comprendre, toute l’expérience que véhicule, mot sur mot, le poème, reste ‘secr[ète]’ (XV). La draper des formes mouvantes du poétique ne change rien de son caractère d’indécidabilité, de non-‘décisivité’; tout ce qui est demeure obstinément ‘obtus’ au cœur de l’intense, cette ‘confusion de broussailles et une naïveté de dormeur réveillé en sursaut’ (XV). Le poème – ce sont les derniers mots de ce si finement sculpté Damier de vivre – vécu et déroulé en tant que ‘chant [avec] sa plainte dans les tunnels du temps. Leur silence irrémédiable’ (XV).
Un très beau livre d’une femme remarquable, juste et poétiquement sereine au cœur même des tempêtes.