Fil de lecture de Lucien WASSELIN : une éditeur et ses auteurs, LA PASSE DU VENT
La Passe du vent éditeur a été créée en 1999. La collection de poésie s'est peu à peu imposée par la diversité des voix accueillies. Chaque volume se présente de la même façon : après un recueil (le plus souvent inédit) suivent un entretien, plus ou moins fouillé, mené par Thierry Renard et une brève présentation de l'auteur (parfois écrite par ce dernier)…
*
Ahmed KALOUAZ : D'un ciel à l'autre.
C'est le troisième livre d'Ahmed Kalouaz que je lis après "Paroles buissonnières" et "À l'école du renard". Je suis bien loin d'avoir tout lu de cet auteur prolifique mais je suis sensible à la cohérence de sa démarche. Rien de gratuit dans son écriture, il note dans ses proses ou dans son autobiographie, comme dans ses poèmes les rapports privilégiés entre le moment et l'universel, il interroge le monde qui n'a besoin que d'un peu d'amour, à partir de son enfance…
D'un ciel à l'autre se présente comme un recueil de 50 poèmes, des poèmes que traversent les ombres d'Aragon, d'Elsa, d'Éluard (et de Nush), de Jean Ferrat, de Jacques Bertin (Chalonnes, Les Ponts-de-Cé), Hölderlin (à qui Aragon a consacré un poème dans Les Adieux). On ne s'étonnera donc pas que le ton de ces poèmes soit plutôt éluardien (car Ahmed Kalouaz chante l'amour avec beaucoup de délicatesse), voire franchement élégiaque. D'ailleurs, on remarquera l'erreur que commet Thierry Renard dans l'entretien qui clôt ce livre, quand il parle de proses ("courtes proses poétiques", "petits poèmes en prose qui naviguent à contre-courant, d'un ciel à l'autre") alors qu'Ahmed Kalouaz écrit en vers (du moins va-t-il à la ligne avant la fin de la page)… Mais ce lapsus a le mérite de souligner la continuité dont fait preuve Ahmed Kalouaz d'un genre à l'autre !
Ahmed Kalouaz s'intéresse aux choses simples de la vie comme l'amour qui transforme cette vie, le temps qui passe… Mais il sait aussi parler de choses plus graves, comme dans "La nuit pourrait tomber" où se dit que "le ventre est toujours fécond, d'où sortit la bête immonde" et que le fascisme pourrait revenir avec son cortège de tragédies. Et ce n'est sans doute pas par hasard si les deux derniers poèmes du recueil parlent de trains : ceux qui conduisent vers les camps de la mort et ceux qui symbolisent la séparation des amants. Dois-je l'avouer ? C'est dans ces derniers poèmes que je préfère Ahmed Kalouaz…
*
Laurent DOUCET : Au sud de l'Occident.
Il me faut l'avouer avant même de parler du poème de Laurent Doucet, "Au sud de l'Occident". J'ai remonté, il y a quelques années, la vallée de l'Ourika en bus ; dans son coffre, le conducteur avait enfermé quelques volailles vivantes pour les offrir (ou les vendre !) au terminus. Je ne sais toujours pas quel sens donner à cette anecdote. Mais plus qu'un recueil de poèmes, "Au sud de l'Occident" est un long poème où le silence à sa place, symbolisé par le blanc qui sépare de brèves notations. Car Laurent Doucet ne bavarde pas…
"Au sud de l'Occident" est un voyage sans pittoresque vers l'inconnu. Une chose plantée dans le désert qui n'a jamais été décrite. "ocre / et âcre" écrit Doucet, comme la vallée de l'Ourika que j'ai vue. Que voit-on quand on voyage ? Rien, sinon des images d'Epinal ou convenues. Rien de tel ici dans ce poème mais qui est le Mejdoub ? Sinon ce poéte soufi, né à El Jadida au XIème siècle ? S'il est vrai que le Mejdoub demeure largement inconnu (Mejdoub signifierait celui qui est attiré par le haut), ses paroles restent et ont inspiré divers commentaires. Le poème de Doucet serait alors l'un de ces commentaires. "Les Mejdoubs ont en commun […] de communiquer une parole qui éveille et combat le rabaissement matériel de l'homme face aux besoins matériels" note M'Hamed Jemmah.
"Qui voudrait vivre aujourd'hui au fond d'une vallée / jouant du oud, et calligraphiant ?" questionne Laurent Doucet. Je ne sais quel est le pouvoir d'un poème ou d'un livre ; ou je ne le sais que trop. Mais je comprends mieux ce que j'ai vu lors de mon voyage au sud de Marrakech grâce à ces deux vers. Je comprends l'insatisfaction et le rêve d'ailleurs des Berbères et je sais que le oud et la calligraphie ne sont que des luxes d'Occidental, ou l'expression d'un ailleurs rêvé, désiré. Parce que le présent est toujours source d'insatisfaction. Certes, il ne faut pas se résigner, ce serait alors accepter l'inacceptable. Les anglicistes s'intéresseront particulièrement à la traduction faite par Laurent Doucet lui-même dans la langue des poètes de la Beat Generation. Car "Au sud de l'Occident" est offert en version bilingue. C'est un véritable défi que s'est lancé Doucet puisqu'il répond à Thierry Renard : "… la traduction de la poésie n'est pas possible strictement (la polysémie des mots, mêlée aux jeux des sonorités, du rythme, des homophonies et des sous-entendus etc. ne sont pas complètement transposables)". L'anglais comme "butin de guerre" ? À voir de près…
*
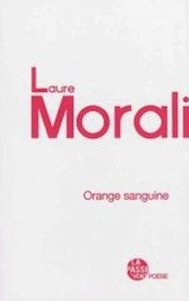
Laure MORALI : Orange sanguine.
Laure Morali partage ses jours entre le Québec et la France, elle voyage beaucoup ("à l'épaule / un pays un autre / dans le ventre"). Comme elle respire. Le recueil est soigneusement composé de huit sections. Chacune est placée sous le signe d'un écrivain dont un haïku ou un très bref fragment sont mis en exergue. Suivent alors des poèmes plus ou moins longs, tantôt narratifs (pour les longs), tantôt évocateurs (pour les courts). Détails prosaïques, impressions, souvenirs font la substantifique moelle de ces poèmes ; mieux, ils constituent la quintessence des lieux traversés. Laure Morali devient le paysage ; mais elle est continuellement en quête de son identité introuvable ou complexe car elle est le résultat d'une histoire mouvementée…
Ainsi la troisième section (qui s'ouvre par ce bref poème de Bashô : "Du papillon le vol / à travers la prairie / cette ombre seulement") est une quête discrète des origines. Ou un rappel. L'Afrique est évoquée, sans doute l'Afrique du Nord quand on sait que Laure Morali (on le devine à la lecture) descend du côté paternel de Pieds-Noirs et qu'on remarque que cette partie est intitulée "Les orangers"… "la vie s'enroule / au soleil" écrit-elle. Mais il s'agit de "rapiécer le monde / en l'ajourant" car "Quand je suis née / quand elle est morte // entre les deux un seul visage". Plus que des origines (qui ont leur importance), Laure Morali est à la recherche de son identité, ici et maintenant. Même si l'orange sanguine traverse le recueil… Même si la sixième suite à pour titre "Sanguines" et qu'elle évoque, peut-être, le grand-père…
Les hasards de la vie (Laure Morali est née à Lyon, elle a vécu et étudié en Bretagne, elle est souvent en avion ou sur les routes, elle est plutôt nomade…) en font une citoyenne du monde qui ne s'est jamais attachée à un endroit. Elle explique bien cela dans la conversation finale avec Thierry Renard. Elle est d'une spiritualité sans dieu… Aussi ne faut-il pas s'étonner qu'Orange sanguine soit d'abord paru au Canada dans la collection Mémoire d'encrier.
*
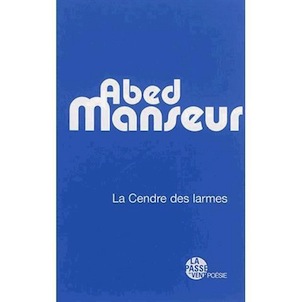
Abed MANSEUR : La Cendre des larmes.
Abed Manseur est né en 1965 en Algérie ; il y a étudié les lettres françaises à l'université d'Oran. Ce qui explique qu'il "malmène" aujourd'hui la langue française, comme Jacques Prévert ou Boris Vian dit-on. Comme Ghérasim Luca, ajouterai-je (au moment où j'écris ces lignes, vient de paraître le n° 1045 d'Europe, mai 2016, qui est consacré à Luca). En effet ce dernier écrivait dans La fin du monde (publié en 1969) : "Je te flore tu me faune / […] / tu me mirage tu m'oasis". Ou comme Henri Pichette qui osait au siècle dernier : "Je te vertige, te hanche, te herse, te larme…" Alors qu'Abed Manseur, dans la première suite de poèmes (Les poussières) de ce recueil utilise le substantif à la place du verbe, ce qui donne des vers étranges comme "Je te champ" ou "Je me pauvre"… Monique Delord, dans sa préface, dit d'Abed Manseur qu'il se proclamait volontiers "faiseur de trucs". C'est ainsi que le lecteur peut identifier d'autres trucs, comme le poème réduit à une suite d'affirmations, toutes logiques prises indépendamment mais qui, lorsqu'on les lit d'un seul trait, révèlent un enchaînement illogique, insensé… Comme le non sens, les libres associations (parfois phoniques), comme les jeux de mots reposant sur l'homophonie (comme de puits / depuis ou était / été)… Cela donne une poésie assez fantaisiste, un aspect expérimental qui renouvelle l'écriture poétique… Une poésie très libre et sonore plutôt que visuelle, réflexive ou narrative : Abed Manseur prend son bien là où il le trouve… Mais Abed Manseur sait dénoncer avec vigueur les injustices dont sont victimes les humains (comme dans le poème intitulé De la Nouvelle Orléans à Bagdad). Quoi de mieux ou de plus efficace que la poésie pour exprimer l'indignation ? Et surtout, il est un poète de l'amour puisqu'il invente des mots inouïs et tord son cou à la logique même quand cet amour est interdit d'une façon ou d'une autre…
*
Ces quatre recueils confirment cette diversité d'autant plus qu'ils proviennent d'horizons différents et témoignent d'itinéraires variés. Ils rappellent que la poésie est multiple.
*