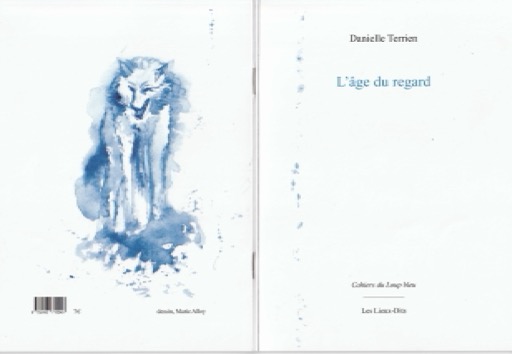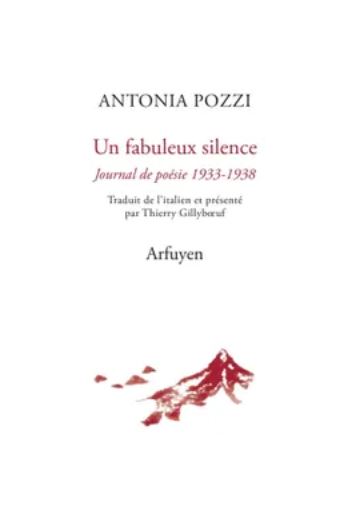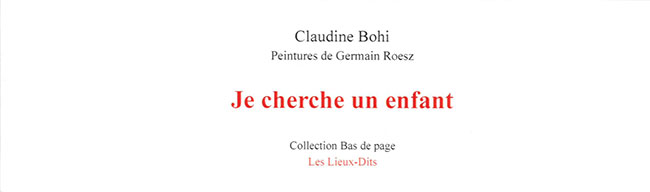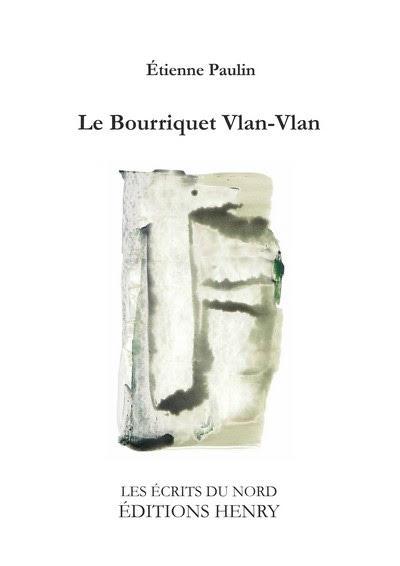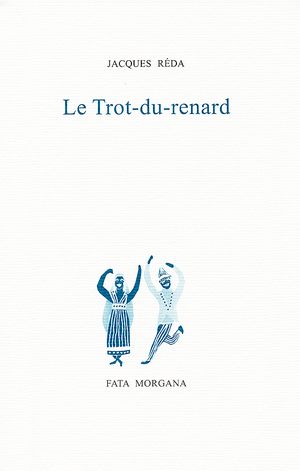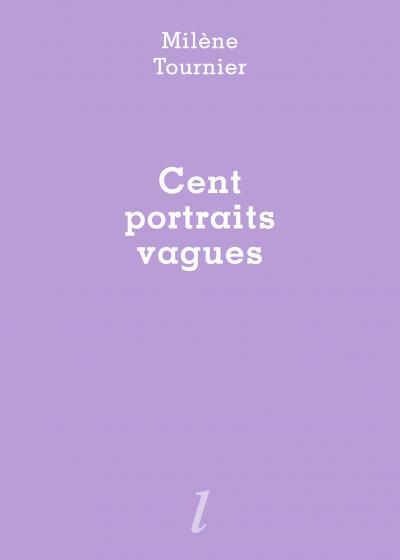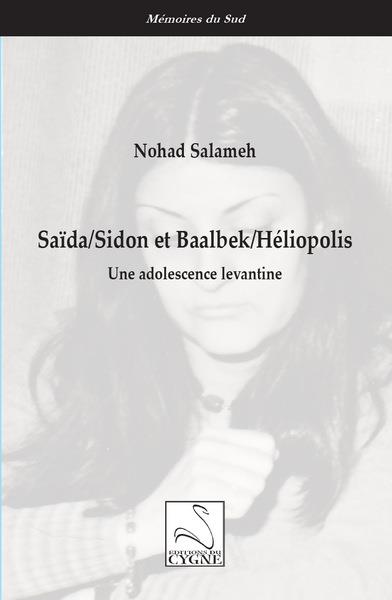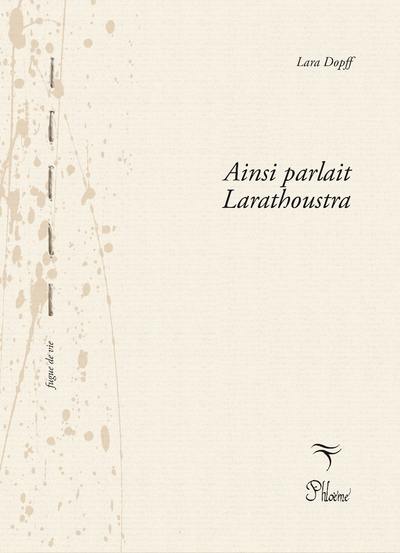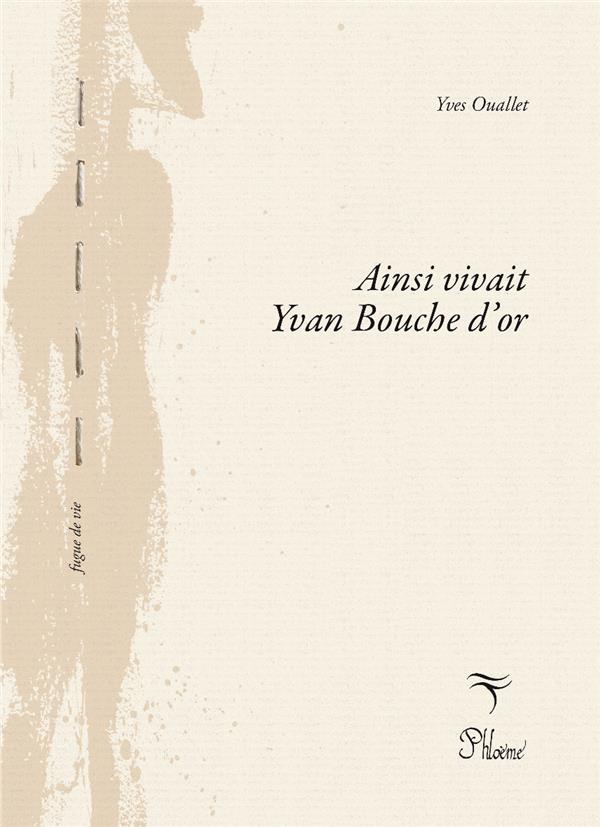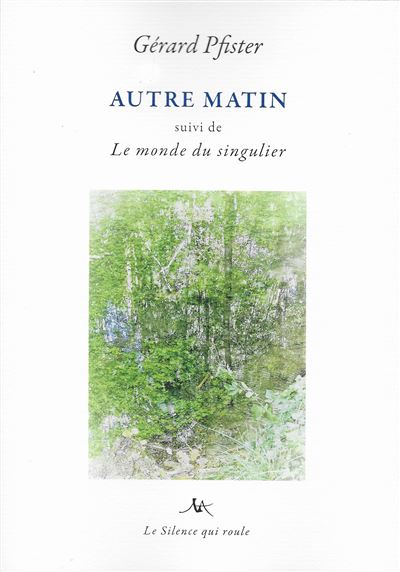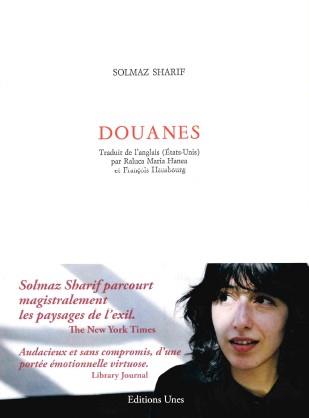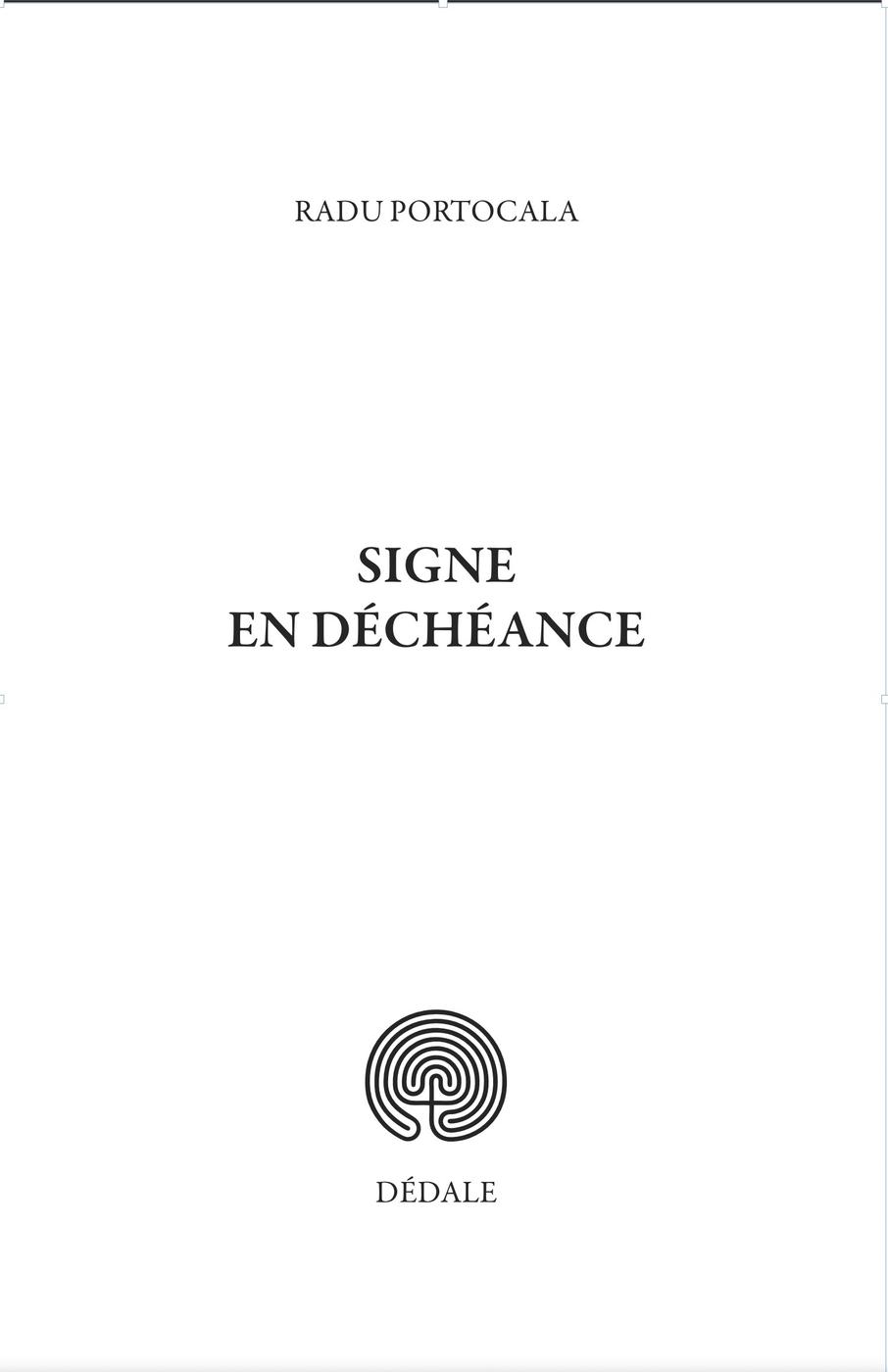Cécile Guivarch, Si elles s’envolent
L'auteure de ces beaux livres de mémoire ("Renée en elle", "Sans Abuelo Petite", "Cent au printemps", "Sa mémoire m'aime") prolonge sa réflexion humaniste avec ce bouquet de textes adressés à ses mère, grand-mère, grand-tante, aux poètes (Marina Tsvetaeva), aux vedettes de l'écran (Marilyne, Brigitte, Françoise, Simone) et à toutes ces femmes qui ont tant oeuvré pour que leur sort soit moins funeste.
On retrouve la grâce, la finesse, et l'empathie de la poète qui sait si bien parler du temps révolu, de toutes les tâches ingrates, de tous ces corps appelés à travailler sans peur de suer ni de courber le corps sous la peine.
En brèves inflexions, sous la bannière de Denise Desautels ou de Denise Le Dantec, Cécile honore le labeur sous toutes ses formes, au temps où les moissons se faisaient à la main, et "recommençaient chaque printemps/ les mêmes gestes d'élan et de coeur", quand "c'était dur" de vivre, de travailler, femmes ou hommes même combat.
"Ma grand-mère comptait ses couches/ comme un oignon" : que de lessive à couler en rivière, que de linge à curer au soleil pour qu'il soit plus blanc.
Les usages du temps, les affres du corps, la splendide mémoire des corps : tout ici relève d'une ethnographie singulière, menée par une poète qui ne fait pas fi de ce qu'elle a vu des anciens, mais en garde rigoureusement les traces.
D'ailleurs, elle se niche, petite, dans certains fragments : "mes jambes comme des ailes/ j'avale le vent bouche ouverte" (p.18).
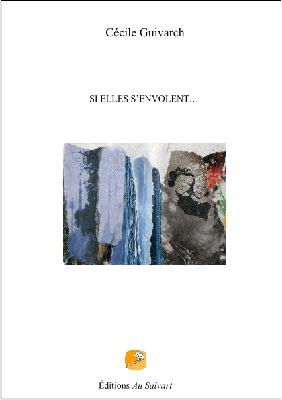
Cécile Guivarch, Si elles s'envolent, éd. Au Salvart, 2024, 74 p., 12 euros.
L'écriture fluide, nerveuse, qui ne s'embarrasse pas d'images, retrace avec force la période ("ce village sous Franco/ cinquante ans en arrière") .
Un très beau livre.