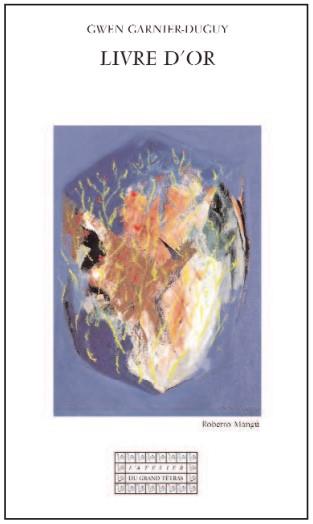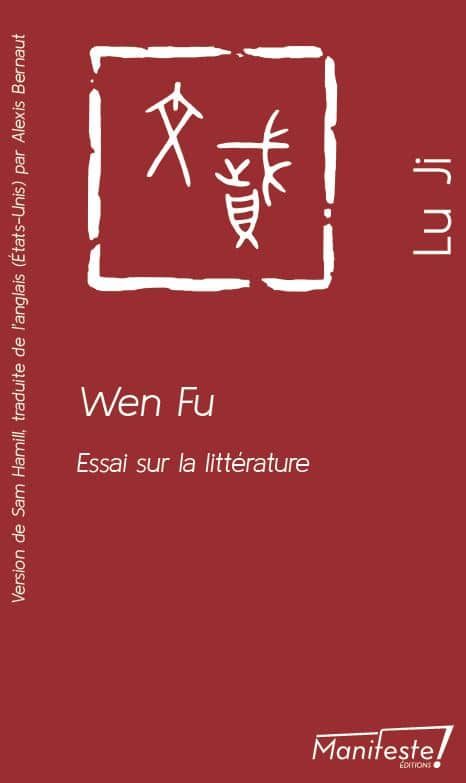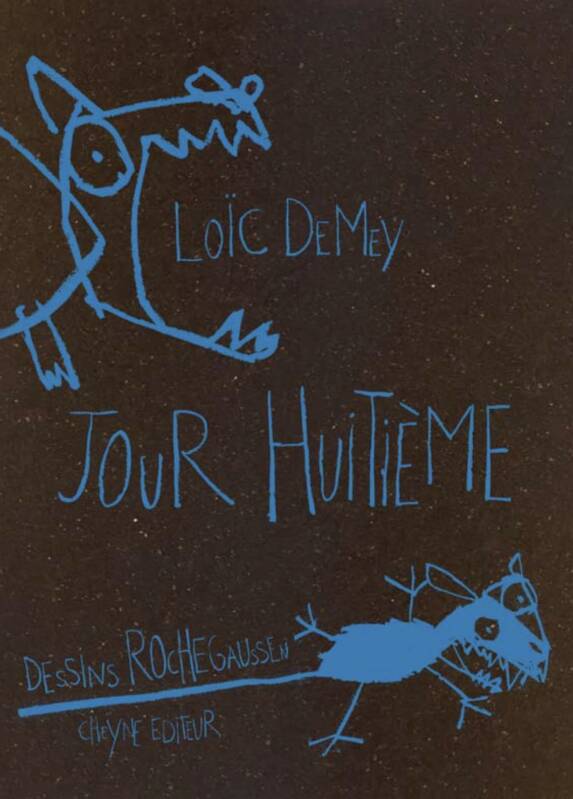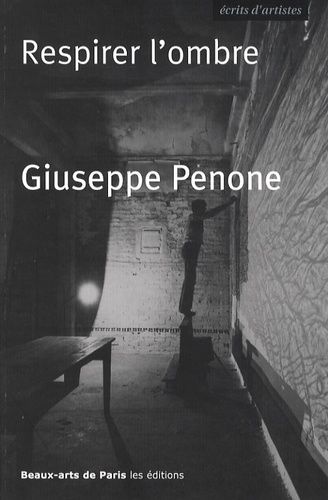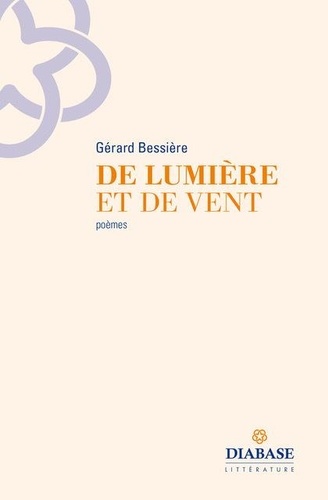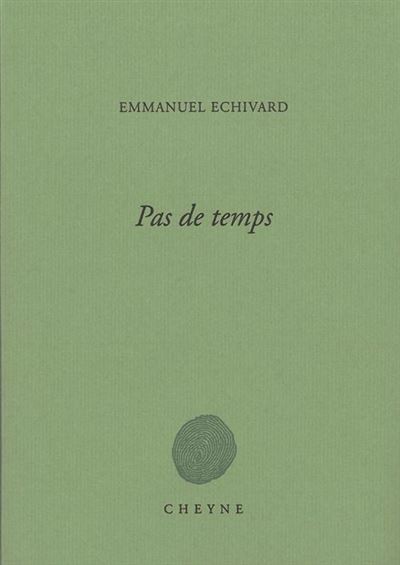Michel Fardoulis-Lagrange, Prairial
Prairial est le premier et seul recueil de poésies de Michel Fardoulis-Lagrange et qui mérite autant d’attention que pour ses romans. Nous savions que poésie ou roman, entre les deux, il y a peu de différences chez cet auteur.
Sa prose qu’on ne doit pas hésiter à qualifier de poétique (nommons là « roman-poésie » pour reprendre la formule de Michel Leiris dans sa préface à l’ouvrage de MFL « Volonté d’impuissance » paru en 1943, éditions Fontaine ; et inversement « poésie-roman »), fait donc écho aux poèmes dans cet ouvrage. On y trouve les mêmes images chez l’un et l’autre, les mêmes contraintes, les mêmes regards, les mêmes affirmations dans le sens de l’espérance, parfois le même hermétisme, et toujours cet univers cosmique. MFL vient d’un monde à part avec des révélations à nous faire, comme Jésus l’a fait en son temps.
Le religieux et le sacré proposent un espace littéraire, et probablement pas autre chose, qui garantit les rêves et les quêtes de Michel (tout comme ils ont garantie ceux de Rimbaud pour les mêmes raisons), lequel nous emporte vers des mondes d’ombres et de lumières croisées où l’on rencontre des personnages qui n’ont généralement pas leur place, en tout cas pas ainsi, dans la littérature dite classique. Peut-être est-ce aussi une des raisons qui trouble le lecteur et rend difficile sa lecture. Pour lire MFL, on doit certainement entrer en lui et devenir lui à travers ses yeux. Ce qui n'est pas aussi difficile à réaliser qu’on le prétend. Il faut juste se laisser bercer par la musique des mots et des phrases de Michel Fardoulis-Lagrange comme on se laisse bercer par les vagues les yeux fermés.
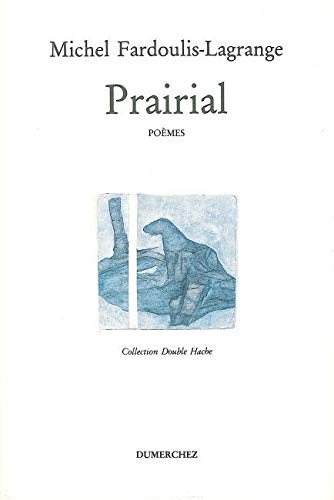
Michel Fardoulis-Lagrange, Prairial, Éditions Dumerchez, 1992, 23 € 71.
L’œuvre de Michel Fardoulis est donc unique, presque indescriptible, presque « inanalysable ». Ce qui rend pourtant formidablement intéressante son œuvre, c’est le langage qu’il détourne au profit de l’intérieur de l’histoire, ou du poème, pour les protéger, pour rendre leurs vérités plus que pour l’accompagner. Formules inhabituelles et personnalités (personnages) explorées comme si pour la première fois la langue s’exprimait. Langue du roman ou du poème, ou bien plutôt les deux à la fois, ce mélange a tendance à effrayer comme à fasciner. Michel ne donnant pas le choix au lecteur, celui-ci est obligé de faire avec ce que l’auteur propose mais aussi avec ce qu’il ne propose pas. Et c’est peut-être ici que le lecteur peut essayer de s’engouffrer.
Dans « Prairial », les mouvements des personnages construisent les images de ce monde inventé par Michel et donnent un socle solide pour rendre viable celui-ci. Il est rare qu’un écrivain s’enferme totalement dans son propre univers jusqu’à ne plus voir le monde tel qu’il est réellement sans toucher à la folie. Tel est le cas de Michel. Son univers sans sourire, car occupé à une tâche qui donne tout au regard depuis des siècles ; son univers sans monde destiné à contempler le plus précieusement possible cet autre nécessaire pour vivre, tout cela fait de Michel Fardoulis-Lagrange un écrivain très singulier.
Enfin, on ne peut que penser au poète de Charleville-Mézière, dont l’univers poétique de Michel Fourdalis est proche. Car il y a indubitablement du Rimbaud en lui. Leurs croyances à tout deux n’ont pas d’ambition autre que littéraire. L’un et l’autre étaient solitaires et vivaient dans le silence. Sans tomber dans le drame, le génie offre ici ses figures les plus marquées.
Il faudrait redéfinir cette nouvelle forme d’écriture et l’inscrire à côté des autres et non pas au milieu d’elles. La langue de Michel Fardoulis-Lagrange parle dans et de sa propre liberté, elle n’exprime pas autre chose.
_________________________
Extraits
L’OBSERVANCE DU MEME
La nostalgie et les échos
prennent part comme jadis à la foulée.
Sur les rivages,
les gymnopédies.
Le regard réclame des oiseaux en bancs,
des méduses uraniennes.
Pourquoi ne pas aller toujours plus près
sans accoster,
saluer les compagnons d'égal à égal ?
Ce seront encore
les recommencements, les siestes légendaires.
D'égal à égal, les transferts,
les bruits métaboliques des corps,
il n'y a plus que cela,
la prébende des veines,
les navigations intestines,
les voluptés tribales,
les boulimies.
RAPPEL
Quel foisonnement d'ombres
jumelées aux buffles
vers le crépuscule !
O Moira,
s'exclament les filles
au même moment
devant le naufrage
de leurs robes.
Sérénité pourtant,
ici et là
des profils d'argile,
ceux des dormants
impénitents.
Les destinées ailleurs
sont des pétales de fleurs
que ramasse le vent
pour un mémorial
des senteurs.
Tadis et naguère
ne paraissent jamais certains,
ces irisations
d'une souvenance
léthale.
Et dans l'antre
se consume le dinosaure
avec ses lymphes immaculées