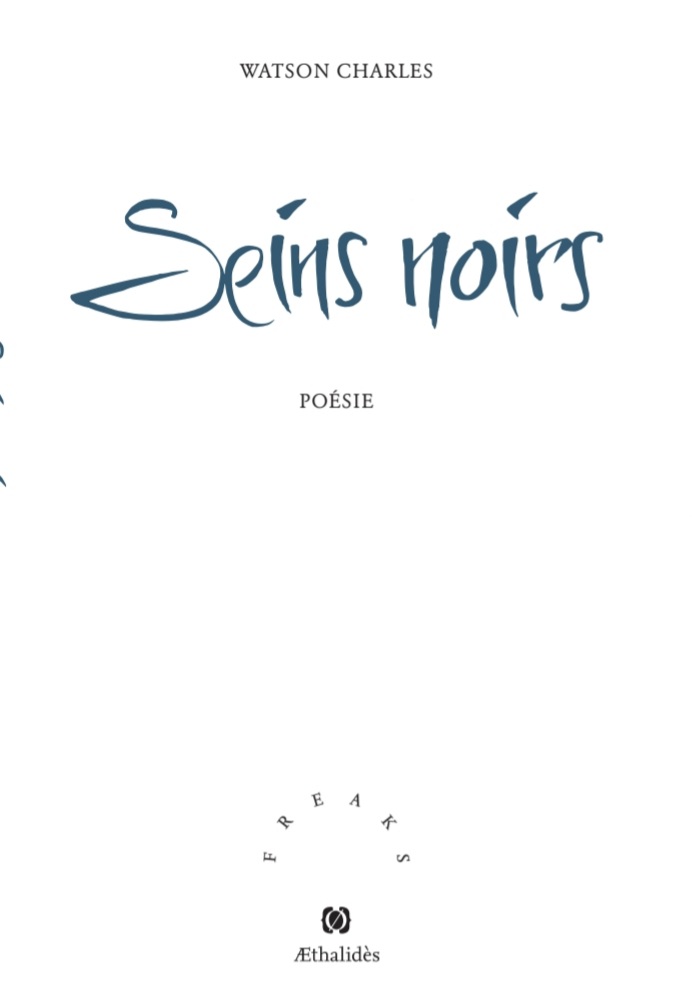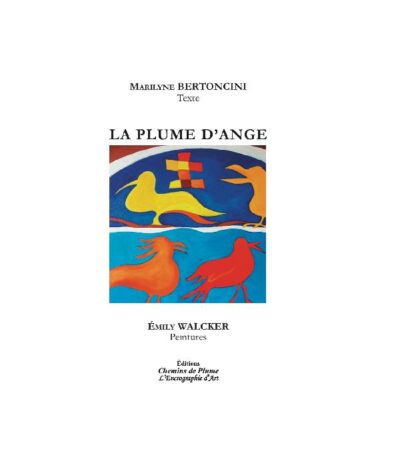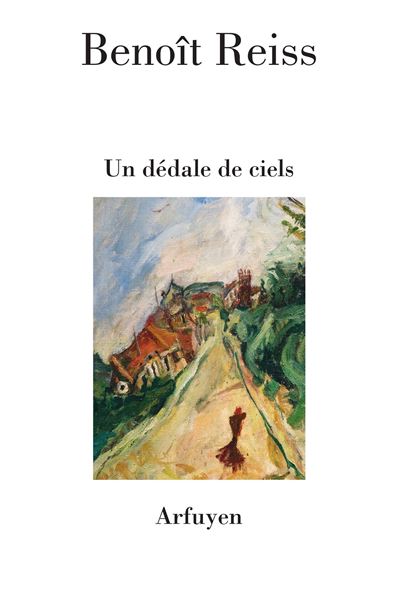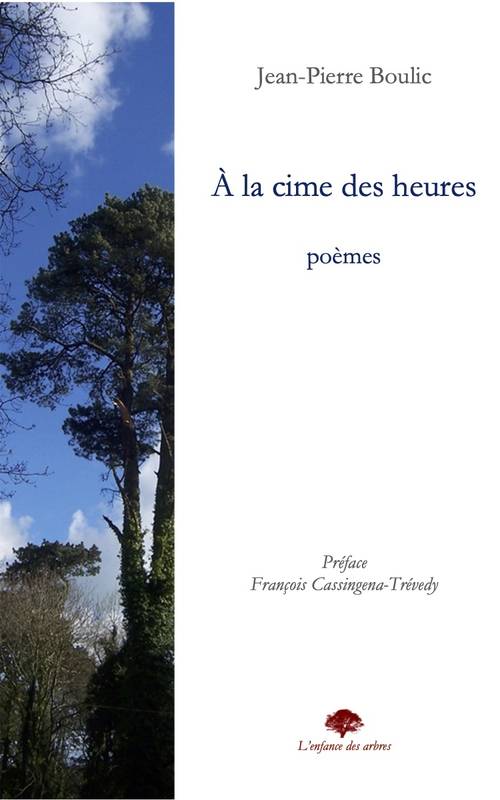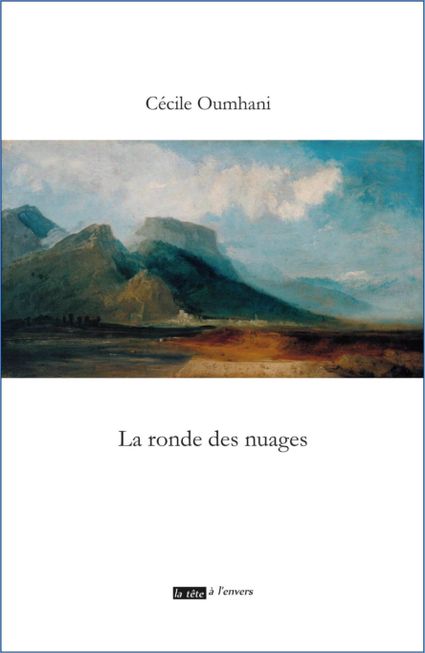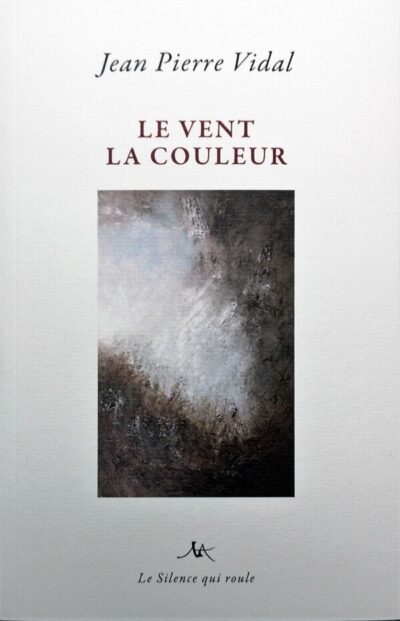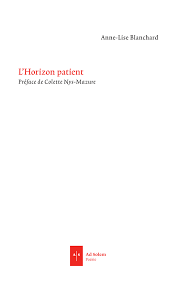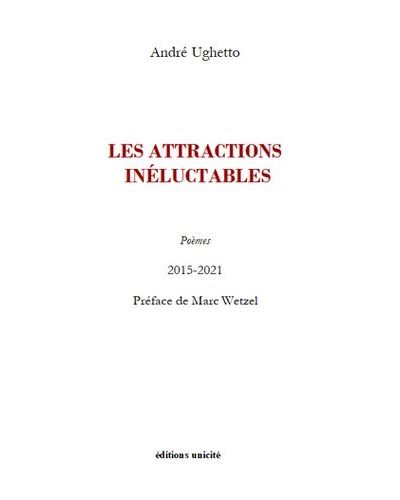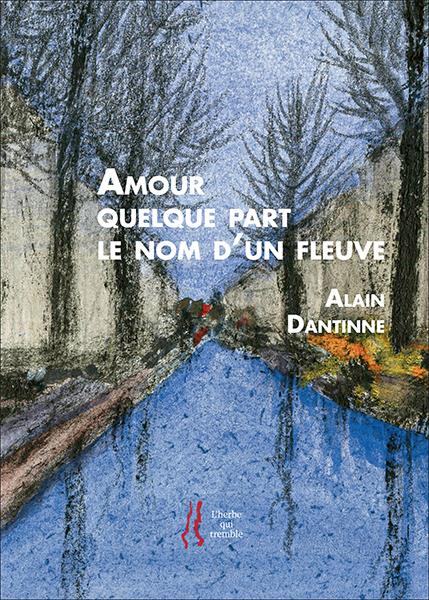Si le regard est important, l’ouïe l’est tout autant, car près de l’Océan, le vent souffle et l’occurrence du souffle est constante dans la première partie du recueil : Lieux
Le souffle qui nait au large (Demeurer p.16)
Un souffle va et vient (sans titre p.20)
Le souffle de la glaise (Désir p.21)
Un souffle se pose là-bas (L’Estran p.22)
Ton vécu devient souffle (Vécu p.23)
Sentir s’en venir un souffle (Ainsi p.24)
Le souffle qui vivifie la terre : La terre vivifiée comme pleine de grâce (Nouvelle saison p.28), c’est le souffle de la création. Le poète est comme le potier, un artisan créateur ; le poète devient ce « potier de lumière ».
Chaque rencontre aussi minuscule soit-elle abrite la présence, l’Esprit est au cœur du silence et de la « lumière du vide » se révèlent les mots capables de traduire ce qui est enfoui.
D’un rien naît la lumière : « l’étincelle d’un rien » pour entrer dans ce temps d’amour donné, un amour gratuit offert au monde et aux hommes.
La Résurrection silencieuse est au cœur de ce recueil, le poème Aller au cœur, annonce l’ensemble des poèmes de la partie L’étincelle d’un rien, mêmes images et même présence dans le poème Ne me retiens pas, celle qu’a rencontrée Marie-Madeleine au tombeau, à l’aube et cette parole énigmatique qu’elle reçut « Noli me tengere », présence aussi de l’ange annonciateur. On entre alors dans un autre temps, un temps accompli, et le temps de la louange est venu, un vers du poème Voir (p.58) :
Un souffle….
Loue les biens de ce monde. » renvoie à un poète dont Jean-Pierre Boulic pourrait revendiquer la filiation, Les biens de ce monde le recueil testamentaire de René-Guy Cadou , son dernier recueil, publié quelques jours avant sa mort.
Un poète qui lui aussi a su célébrer cette communion étroite du poète avec tous ces riens, tous ces biens qui nourrissent et son écriture et sa vie spirituelle. René Guy Cadou lui aussi attiré par la figure christique ; tous deux le savent, la poésie transmue comme l’amour le mal quand la poésie est parole d’amour et de paix, elle mène de la couronne d’épines à un cœur sans épines :
La poésie colombe
De la blancheur de ses ailes
Sur la branche de sureau
Porte un rameau d’olivier (p.60)
Le sureau renvoie à Judas le traite qui se pendit à l’une de ses branches, mais le temps accompli, de la trahison et de la mort, pourra naître la paix.
Dans ces images d’oiseaux et d’arbres, se cache l’étincelle de l’essentiel.
Dans le poème Mal aimé, l’oiseau s’abrite dans le sycomore, l’arbre de ceux d’en bas, l’arbre qui élève tout pêcheur et le présente à la bienveillance de Dieu, suit le poème Amour en résonance avec le texte évangélique aux corinthiens (13/4-8)
La multiplication des pains rappelle au poète cette faim qui habite l’homme, une faim que seul l’Amour peut rassasier. Cet amour a pris chair et lui seul désaltère, plus que l’eau du puits, la Samaritaine va le découvrir ; car au pied du puits, une rencontre et une demande qui feront « éclore l’âme ».
Le Christ toujours présent, le poète en témoigne, une Présence qui aujourd’hui comme hier nourrit, désaltère, car il est celui qui accueille toutes les blessures :
Le Christ dans la cuisine
…………………..
Souvent tu te retournes
Tu souffles tes blessures
Qui perlent au côté. ( p.70)
En la dernière partie Bénir le temps Jean-Pierre Boulic nous fait entrer dans le temps de l’Après, quand tout est accompli, le poète comme tout homme qui a rencontré la Parole, est envoyé en mission et doit selon la parole dans l’Evangile de Matthieu : « Secouer de ses pieds la poussière » ; paroles que reprend le poète dans le premier poème de cette dernière partie.
Secouer la poussière, continuer à avancer, se tourner vers d’autres horizons, aller porter la parole.
Le poète doit lui aussi s’en remettre à celui qui sait et comme le pécheur qui cherche en vain le poisson, le poète est appelé à jeter ses filets alors seulement il trouvera en « abondance les mots vivants. »
En ce recueil Jean-Pierre Boulic appelle à voir autrement le monde et comme Marie-Madeleine à se tenir au plus près de l’Amour dans le jardin, comme elle qui au matin de Pâques alors qu’il ne faisait pas encore jour, a cru voir le jardinier.
En ce jardin qui se fait cantique et louange, sans occulter la souffrance, les plaies, la souillure, savoir que « chaque heure accomplit le temps » et se savoir comme Marie-Madeleine choisie pour bénir ce temps nouveau.
Grâce aux mots du poème, accueillir à l’infini le Nom inépuisable, le servir et le transmettre par la force vivifiante des mots que lui seul habite, que le poète accueille et nous transmet
Le poète Jean-Pierre Boulic sait plus que tout autre, comme le disait François Mauriac que « La merveille est dans l’instant » ; Un instant accompli, habité et qu’il nous faut vivre.
L’expérience de l’Evangile n’est pas pour Jean-Pierre Boulic séparée de son expérience quotidienne. Il pourrait faire siennes les paroles de Jean-Pierre Lemaire : L’Evangile n’est pas pour moi séparé de mon expérience quotidienne. Je constate que les images bibliques prennent une part croissante dans ma poésie.
Le recueil est un hymne à la vie la plus ordinaire, il est le reflet d’un poète friand de la vraie vie et qui sait découvrir des pépites lumineuses dans les petits riens.