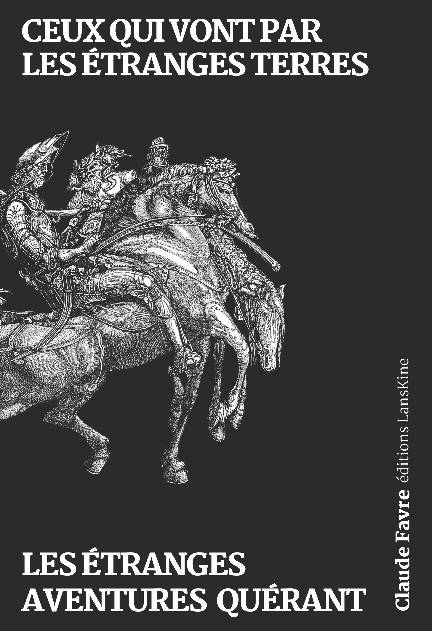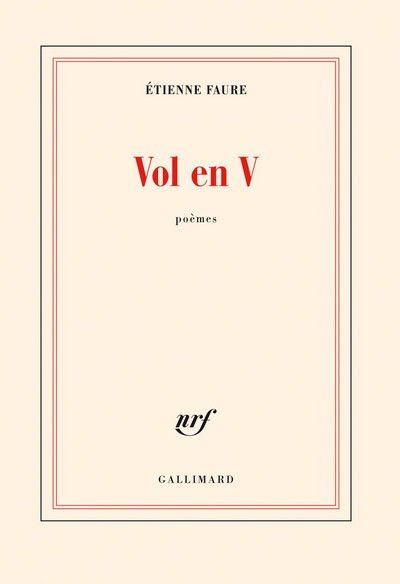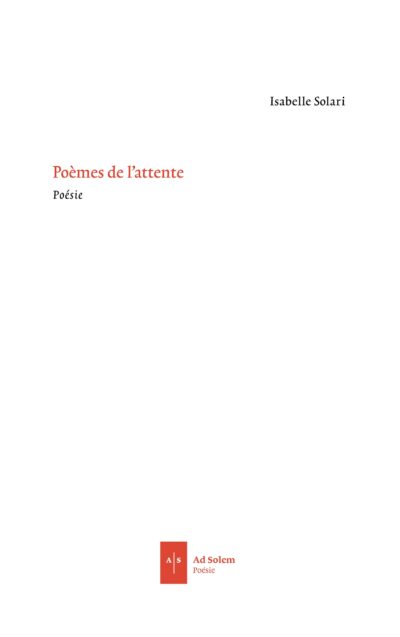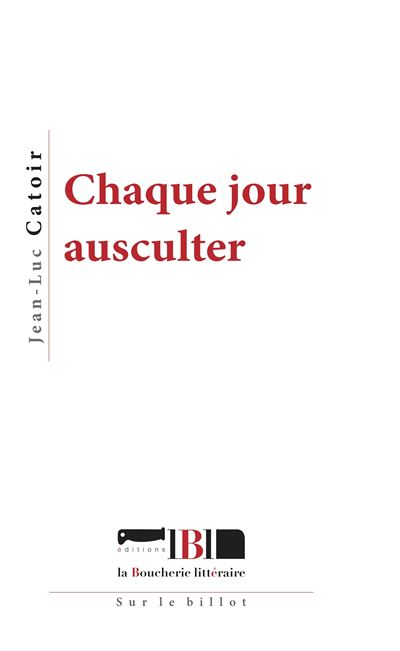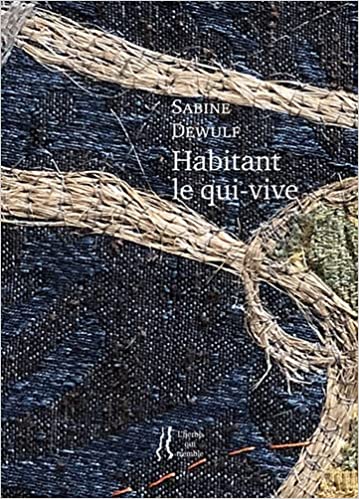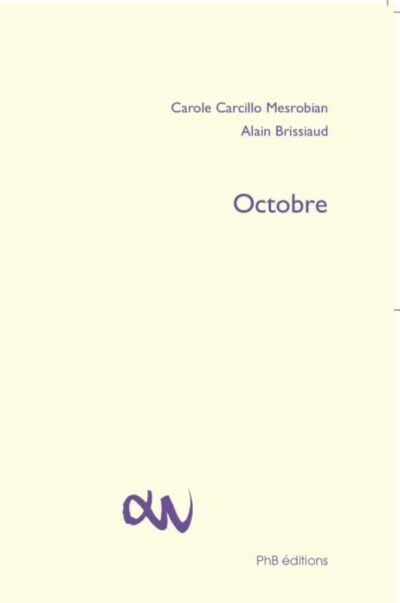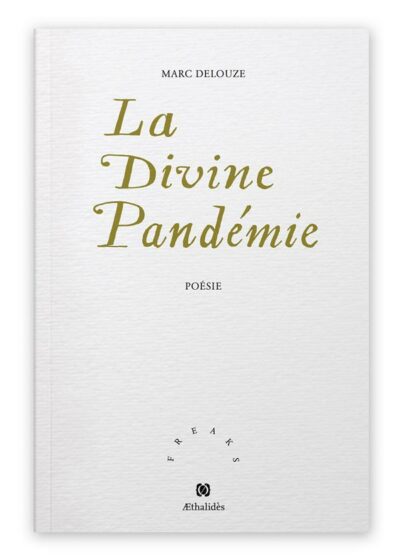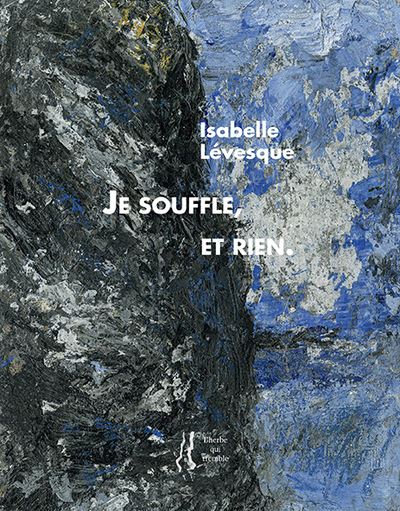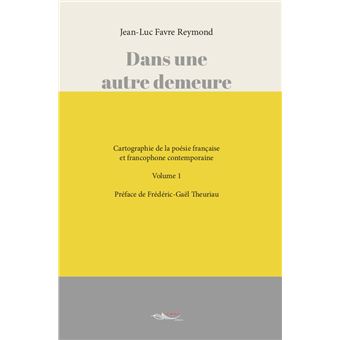Jean-Christophe Ribeyre, La Relève
On lit ce qui fait écho, on longe sinon des murs qui restent muets. Un personnage de mon roman en cours formule ainsi son conflit intime : être muet dans l’extase, ou écrire en plagiant… telle serait la question… Il me semble que Jean-Christophe Ribeyre déroule la même alternative.
Chez lui, le Je est « reconfiguré, numérisé », « modélisé », voilà pourquoi il attend, il cherche la relève de ce pur plagiat qu’est le
Je, simple donnés
Enregistrée,
déversée
Il voudrait
Appartenir au mystère neuf
de ce qui toujours se tait
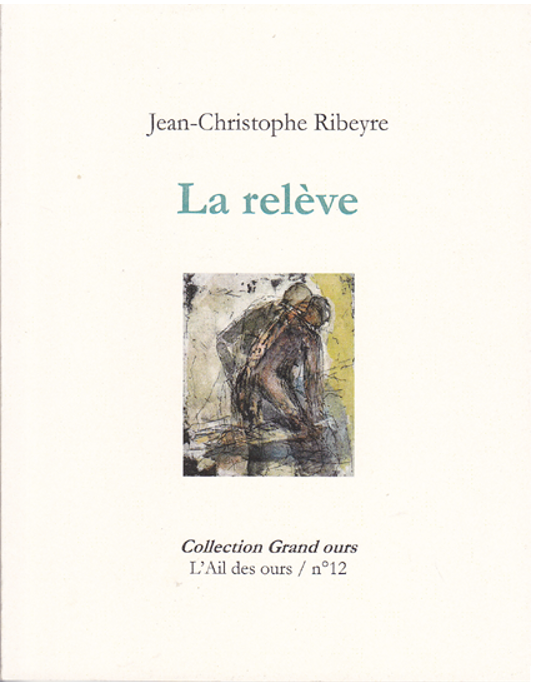
Jean-Christophe Ribeyre, La Relève, éd. L’ail des ours, coll. Grand ours, 51 pages, 6 €. Illustrations de Marie Alloy.
D’emblée, dès la première page, la recherche est énoncée :
Je voudrais habiter
l’imprévu,
ce temps choisi
de la lenteur
Ce temps, ajoute-t-il, « simplement / qui met au monde »… mais on en reste au mode conditionnel, et la condition reste introuvable, qui permettrait de « marcher / du pas de la / lumière / sur l’herbe du matin ». Ce qui adviendrait tiendrait de la paix du monde, que le poète devine « dans la rosée un instant au bord du chemin », « l’odeur verte des blés », la légèreté d’un baiser » ; et siègerait dans l’équivalence de l’être et du néant, « où ce qui est déjà n’est plus ».
Yves Bonnefoy a décrit son arrière-pays, il le parcourait sans y être pourtant, il le pressentait derrière l’indépassable horizon. À ce titre on pourrait le qualifier, selon la tradition poétique, de « voyant » – comme seuls les aveugles sont capables de l’être… Alors que Jean-Christophe Ribeyre semble, suite à quelle condamnation, banni du sien. Parce que son arrière-pays serait pourvoyeur d’effroi autant que de jouissance ? Cet état de jouissance muette où rien n’est plus d’être intensément…
Hélas on remonte toujours dans le « train où vont les choses », pour peu qu’on en soit descendu un instant. Afin d’y trouver refuge, pour ne plus trembler on s’absente de soi…
Mais on n’oublie pas ce qui nous a saisi sans nous saisir, on reste fidèle à l’expérience rêvée, on en a ramené une certaine liberté : on ne sera plus utile « à quiconque oserait prendre possession », on n’écrase plus, on n’humilie plus, on cherche à ne plus « étouffer en son nom »
J.- C. Ribeyre reconnaît l’un et l’autre, celui qu’il souhaiterait ne plus être et celui qu’il serait.
Ainsi notre poète allie l’intelligence au sensible. Sa poésie pense, quel bonheur ! Elle questionne notre condition de parlants qui nous astreint à l’« absence de soi à soi / et au monde ». Puisque c’est la langue qui nous coupe du monde en instaurant un signe à la place de la chose, dans un pur rapport de gratuité. Ainsi le signe honore-t-il son étymologie : le latin signum aura fini par désigner la statue, qui est le simulacre (simulacrum) de la chose.
Le projet poétique est donc frappé d’entrée d’impossibilité : impossible de s’y établir, on ne peut en avoir que le pressentiment. Sous des dehors simples et avenants, Jean-Christophe Ribeyre est un poète tragique.
Quand elle ne reconnaît pas ce hiatus, la poésie reste une mignardise.

Jean-Christophe Ribeyre, La Relève, éd. L’ail des ours, coll. Grand ours, 51 pages, 6 €. Illustrations de Marie Alloy.