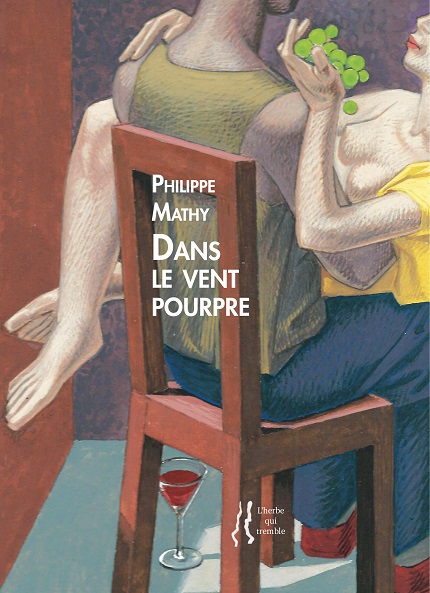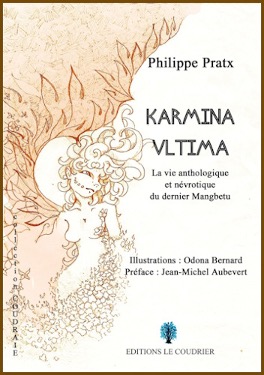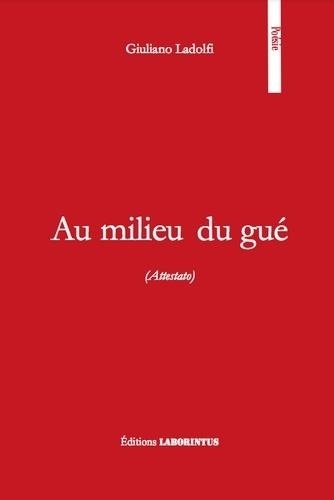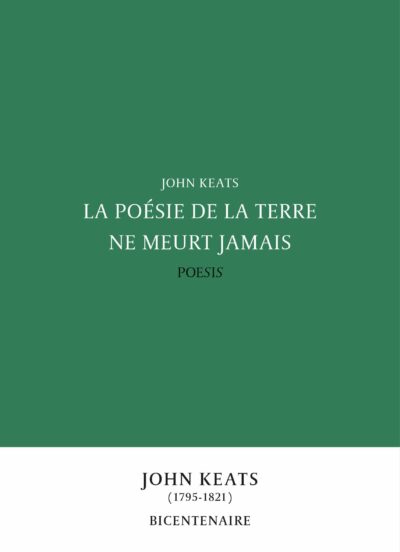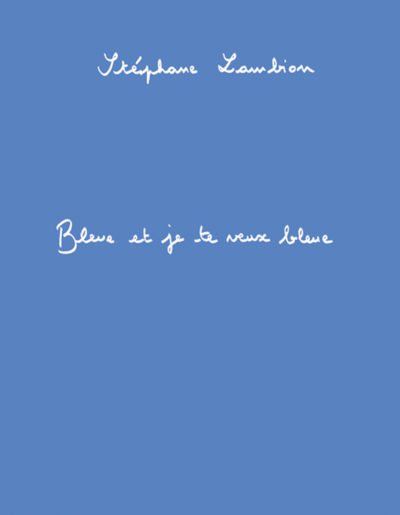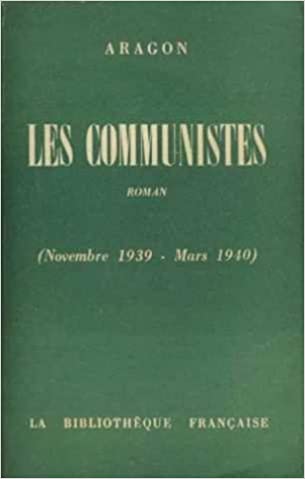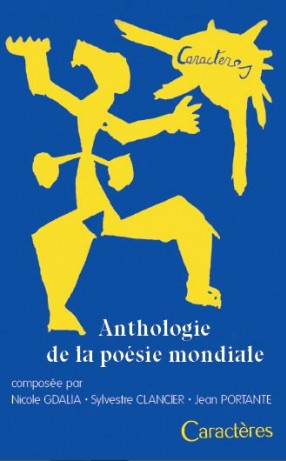Louis Adran, Nu l’été sous les fleurs précédé de Traquée comme jardin
Il est des textes qui résistent… Entre les règles qui s'appliquent à tous et la liberté grande de l'intime, ce choix de privilégier l'espace et les manières les moins courues. Des textes dont il serait hasardeux de tenter de mesurer la portée.
Dès le titre de l’ensemble, les paradoxes sont de mise et ils parlent fort, déjà : le recueil qui viendra en second est annoncé dès l’abord et celui qui le précède voit son titre présenté ensuite ; de plus, ce dernier est légèrement amoindri par le mot « précédé de », comme s’il ne s’agissait que d’un hors-d’œuvre. Tout cela joue déjà sur le futur lecteur et lui suggère comment le poète a considéré ses textes, leur hiérarchie, du moins leur mise en relation.
Pour Suzanne et Au tombeur, voici les deux dédicataires de ces deux recueils réunis ; Pour Suzanne « Traquée comme jardin » et Au tombeur, « Nu l'été sous les fleurs ». La première dédicace présente un prénom féminin et le second, un type d’homme qui se définirait par son pouvoir de séduction voire sa force physique. Dès l'abord, ces deux dédicaces peuvent permettre un éclairage, une élucidation du moins, peut-être un chemin, lequel s'ouvrirait d’une part sur cette quête du féminin, deux femmes apparaissant dans « Traquée comme jardin », « toi » (Suzanne ?) et « elle », sans qu'on sache très bien s'il s'agit d'un même personnage vu sous deux angles différents ou deux entités indépendantes, alors que, d’autre part, « Nu l'été sous les fleurs » évoque la complicité entre trois hommes l'ami de l'oncle (le tombeur ?), l'oncle et le narrateur poète.
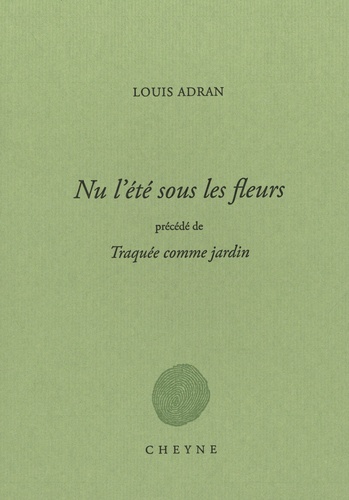
Louis Adran Nu l’été sous les fleurs précédé de Traquée comme jardin, Cheyne éditeur, 2021, 96 pages, 17 €.
Ces jeux sont fort subtils puisque les deux titres semblent être, de ce point de vue, en miroir, le premier commençant par un participe au féminin « traquée » pour se terminer par un nom masculin : « jardin », le second commençant par un groupe de mots (au) masculin « nu l’été » et se finissant par un nom féminin « fleurs ». Ce chiasme semblant annoncer l’une des problématiques du recueil, ces faux-semblants, ces faux-fuyants, ces ambiguïtés de genre.
Quoi qu'il en soit, les deux textes se présentent comme deux récits, deux épopées du quotidien, exploitant tous deux l'ouverture infinie que permet le temps verbal de l'imparfait avec une généreuse abondance (on en redemande), « tu gagnais les chambres » … « tu rêvais peindre » … « tu disais revenir » … des récits où n'ont lieu que des non-événements ne dérangeant presque rien à la continuité des jours. Le continuum que permet l’imparfait fait passer le lecteur d’un poème à l’autre avec fluidité, les verbes « Verbes surtout avait dit l'homme » marquant les successions d'états, les actes imperceptibles, les pas de danse se succédant en une continuité temporelle harmonieuse. Comme le dit la citation de Jean Genet, au début de « Traquée comme jardin », « une chorégraphie qui transformait sa vie en ballet perpétuel » … (Jean Genet Notre-Dame-des-Fleurs)
On entend bien que ces deux recueils doivent se lire ainsi, comme une succession de pas de danse, transformant la vie, ses imperceptibles événements, en un ballet. Ainsi doit s’entendre, peut-être, la dislocation de la syntaxe, comme le déhanchement d’un corps en mouvement ? On a soudain ce désir, à la lecture de ce bel ouvrage, de faire de même et poser « des actes nécessités non par l'acte mais par une chorégraphie ». Et que la beauté du geste (et la parole ici en est un) préside aux choix de vie faisant même « de la pauvreté des couleurs une danse ». Ainsi, de secrètes mais rythmiques parentés viennent se faire écho dans le texte, comme par exemple l'adjectif « cuivré », dès la première page de l'ouvrage « Fut le jardin cuivré » puis au début de la seconde partie « de vieux objets cuivrés » et vers la fin « certaines bêtes au dos cuivré ». Il y a d'ailleurs une unité de temps dans ce recueil, ses deux parties parlant de l'été, la seconde se terminant « début septembre ».
« Traquée comme jardin » célèbre une femme, à la deuxième personne « Belle trempée de nuit » et la souplesse énigmatique de la syntaxe rend infiniment bien le mystère cru d'une présence : « toi collée bleue dans l'ombre, nue terriblement, longue et lente, à reprendre sans cesse les jambes fines de douleurs endormies » (...) « Et ta jambe nouvelle après août, au-devant des sous-bois des allées, recousue comme une lèvre de prière, ronde, saine et faite très blanche » ; celle-ci est parfois appelée « ma sœur », mais encore « l'épousée, la voyeuse, la diseuse solitaire de draps perdus »... Néanmoins, à ce « tu » se rajoute parfois une « elle » sans qu'on sache très bien s'il s'agit d'un même personnage, vu sous un autre angle, d'une rivale ou d'une entité abstraite, telle une Madone « en sa robe claire terminée d'églises » ... En tout cas, ce trio mystérieux porte avec lui beaucoup de sens possibles, fécondant de multiples hypothèses de lecture. Mais qu’il nous soit permis d’en privilégier une, celle qui nous parut la plus touchante sinon la plus évidente, une sœur malade (le champ lexical de la maladie surabonde), décédée peut-être, et dont il est fait l’éloge :
Et se parant d’une dernière
nuit, du carré trouble des feuilles
comme une robeelle.
Il en va de même du second recueil « Nu l'été sous les fleurs » qui, lui, suggère, à travers un second trio, des amours plutôt homosexuelles entre « ton oncle » « le visage de ton oncle », « l'ami de ton oncle » et le narrateur poète, qui rejoint le couple. « Quelqu'un -dont on avait vu le bras enserrant la taille de ton oncle sur une photo » ... La sensualité est discrète mais présente « sa main gauche lâchait la taille de ton oncle » (...) « le corps de l'ami de ton oncle passait, repassait, viril » surtout dans l'évocation du couple, peut-être travesti : « Je les revois en juillet sans un faux pli, dans deux costumes légers deux robes peut-être, et leurs visages très lisses encore très beaux, et leurs nuques leur patience ». Là encore, on peut se demander à quel passé appartiennent ces deux hommes, s’ils sont encore vivants ou non, s’il ne s’agit pas d’un éloge funèbre. L’insistance obsédante de l’imparfait laisse la question sans réponse.
Mais ce qui unifie surtout les deux recueils, c'est la question qu’il s'y pose, de façon lancinante. Que signifie parler, que signifie écrire ? « Parler avait été la nuit depuis toujours » « Quelle nuit s'était tue en nous » « je reprenais sans cesse dans ma tête Terrain vague ou Cinq lèvres couchées noires » « Je rêvais de phrases aux visages précieux (...) je rentrais toujours noir au matin, sans que rien jamais ne fût écrit » « J'écrivais Gravats ou Mur nord... » « Je n'écrivais pas Pavillon noir » « j'ai vu, sans oser l'écrire pourtant » « Vestiges des cahiers noirs, avais-je pensé très vite, délaissés un à un et les mots, lentement par la nuit d'été sous les arbres, à dire voir, dire toucher les jardins ou les corps barrés de feuilles, ébahis »
Que font la parole, l'écriture ? Enferment-elles la vie ? La réduisent-elles au silence ? Parlent-elles, au contraire, fort bien de la douleur qu’elle provoque ? Ici, tout reste ouvert. On pense parfois, tout de même, à la poésie de Saint John-Perse, même si l'écriture se fait apparemment modeste et surtout singulière, afin de mieux s'effacer, peut-être, devant la splendeur tragique du jardin des êtres. « me suis mis à ne plus jamais écrire » dit le poète à l’extrême fin de son texte. La seule écriture qui vaille serait-elle celle qui n'imprime pas ? Surtout, devant l’énigmatique beauté d’un tel texte et devant celle du monde, se garder d'en rien conclure. À relire, néanmoins, sans modération.