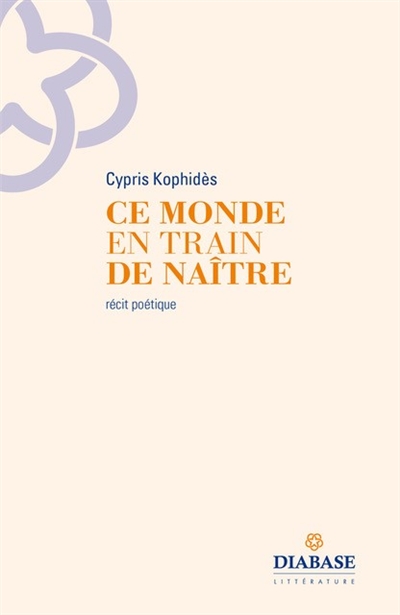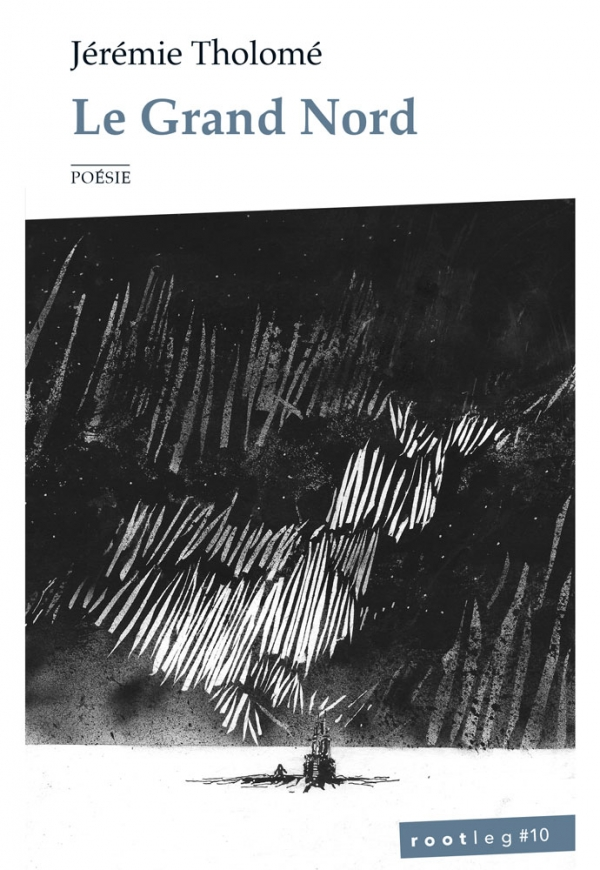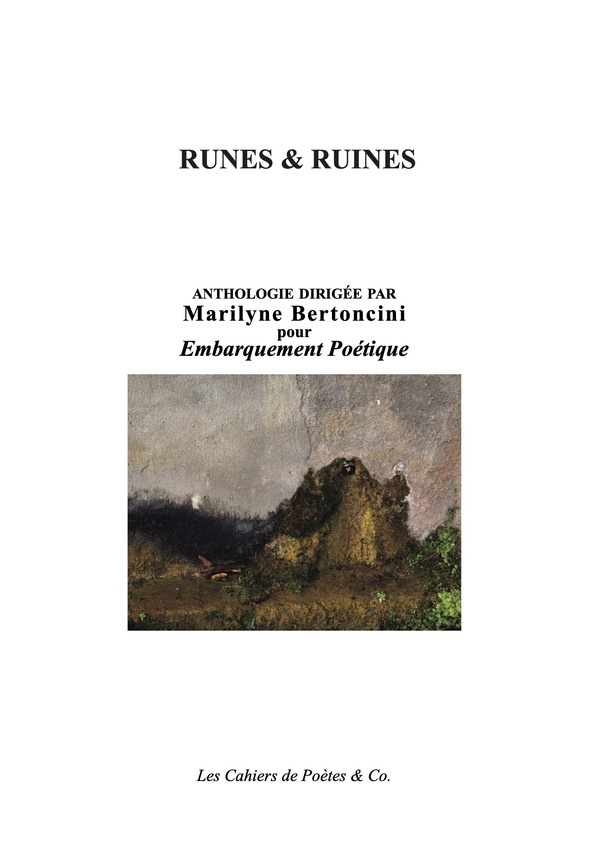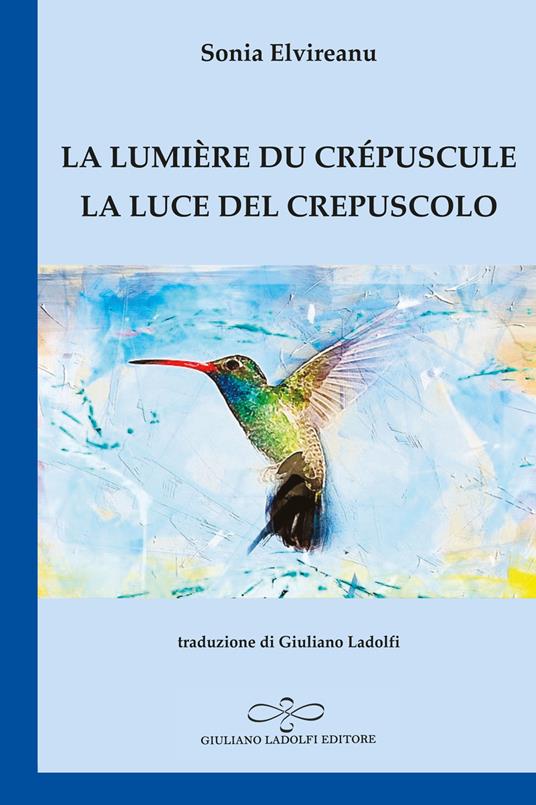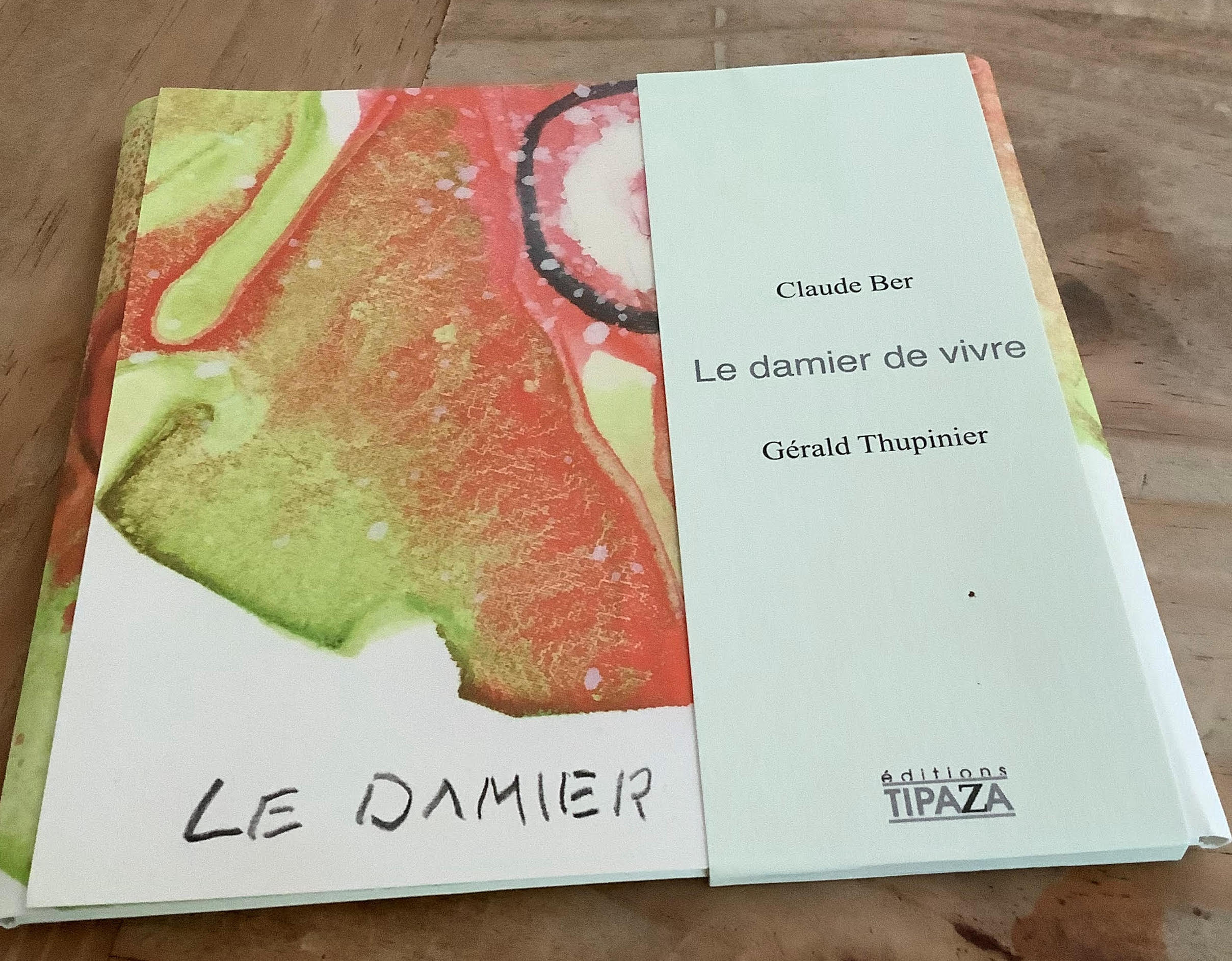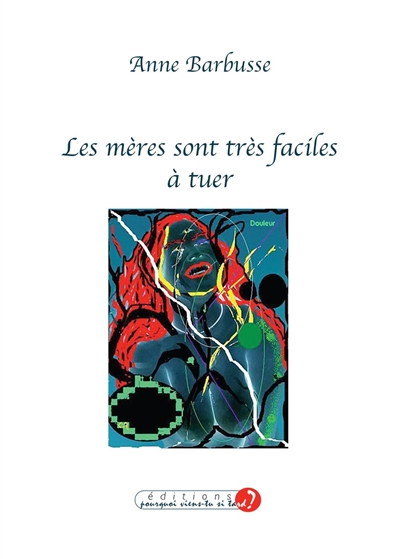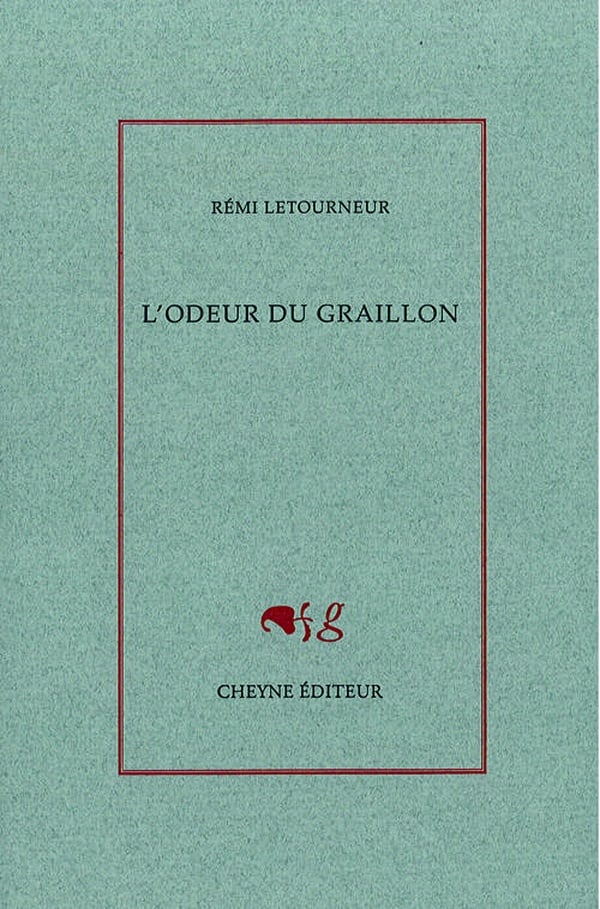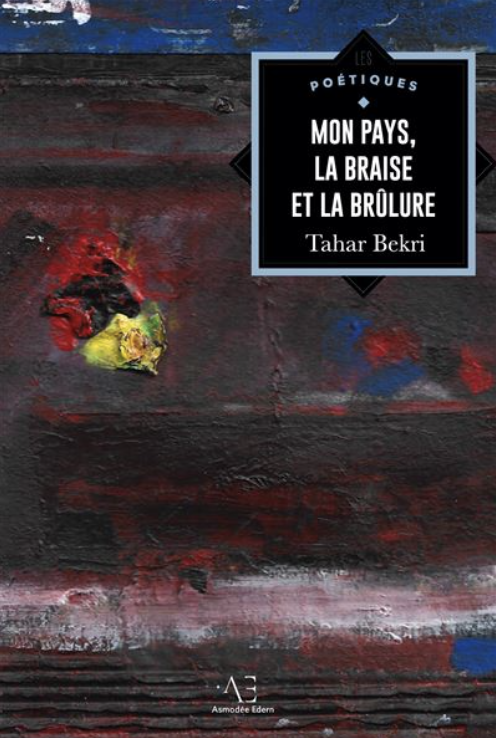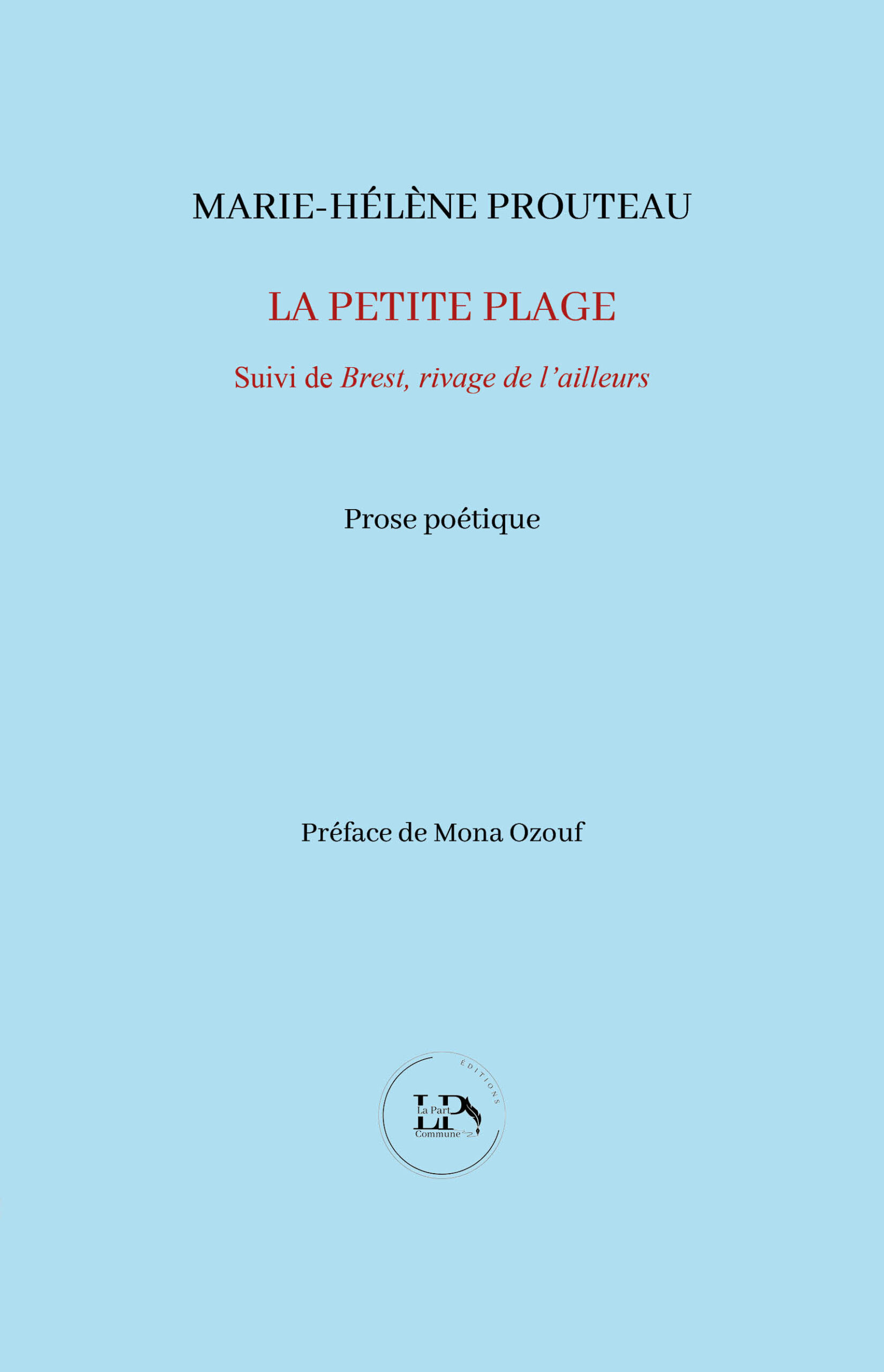Marie Roumégas, Premiers espaces, Liliane Giraudon, Pot pourri
Marie Roumégas et le silence de l'île
Marie Romégas dépeint une île sans nom, évoquant la Crète ou la Corse. Le soleil, la terre rouge et les maisons chaulées incarnent la dureté insulaire des paysages méditerranéens à travers des scènes simples et puissantes. Bien plus que derrière un objectif photographique une telle poète interroge l’imprévisible, l’improbable activés par le double désir : voir et ne pas voir. Voir enfin ce qui ne se voit pas d’emblée, pas à pas, saisir ce qui s’organise contre ce qu’il y a d’inique sous la loi qui préside à l’absence de vie. Ici l'île devient première : y voir par où ça passe où nous croyons que le monde s’engendre.
D’où ici le commencement, le recommencement, la déliaison, le dé-lire au sein de reliefs peu à peu étrangers dans leur familiarité pour lecteurs et lectrices au prix d’une incessante variation ou fuite. Pas d’événement dans les photographies (Marie R omégas ne fait pas le coup du thème ou du motif : juste des fragments de langue, fragments compacts luttant contre la décomposition ; fragments refaits de clichés retournés, d’images reprises, de mots retenus sous occlusion intestine.
Alors, peut-on parler de déroulement, de dépliement, de levée, de sortie pour reprendre ce qu’écrivait Kafka « le lieu de ma naissance », bref à ce qui fixe, qui fait référence. Écrire revient donc à instruire son propre procès dans une suite de visions, de figures de destin et de mémoire forcée de la langue que ton l'œuvre réactive sans fin.
Écrire l'île c'et donc tenter de se déplacer, faire un pas, exister comme effet du déjà initié dès de lieu. où l'auteure reconstruit des fresques afin de savoir comment c'était avant dans une telle archéologie du savoir. Des traces vibrent d'un bourdonnement d'insectes mais d'insectes qui ne disparaîtraient pas lorsque la lampe s'éteint.
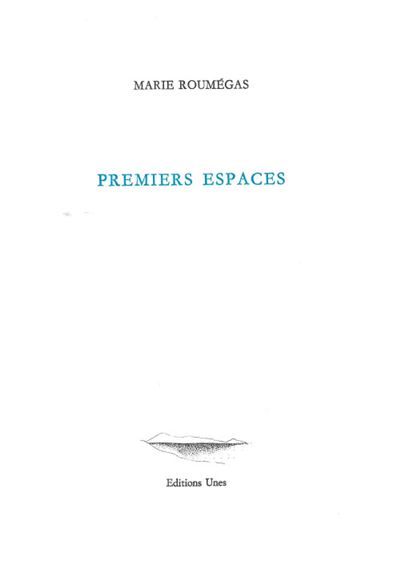
Marie Roumégas, Premiers espaces, Unes Editions, Nice, 96 p., 17 €.
L’artiste du haut de la montagne - où elle s’est sans doute retirée - cherche savoir comment c’était le passé. Elle en suit les traces, reprendre à partir de là. Voici après tout un drôle d’endroit pour une rencontre mais qu’importe. Transferts, rattachements. Mais isolations idem. Dégustation en silence de mouvements qui reviennent, liés à un essieu du temps.
Réunies en scansion les poèmes forment un tour de l'île. Ils inscrivent des légendes en nous de toute sorte de toute confluence où nous ne devenons des insectes fous emportés dans ses tourbillons farouches. Nul peut dire si nous sommes alors avant après la ruine : nous regardons c'est tout. Mais chaque image reste imprimée sur la rétine par les mots. En conséquence les poèmes sont turbulents, flotte sur l'île. Tout semble stable mais rien ne sera stable et fixe en nous. Puisque, à l'inverse de l'île, rien ne l’a jamais été et l’être ne possède pas de fond. Mais ici les textes multiplient les images quasi premières et dans le genre c'est bien.
∗∗∗
Liliane Giraudon et son road-mots-vie
Le titre Pot-pourri malgré son acception s’’apparente, de lie, s’agrippe au genre de la poésie et sans le moindre doute possible. Toutes les sections du livre touchent directement au poème. Er l’auteure de nous aider : « C’est quoi la poésie ? On la fait avec quoi en dehors des mots ? Ça vient d’où ? Ça traverse quel corps ? Avec des retouches, des morceaux de poèmes morts, des laissés pour compte. »
Liliane Giraudon construit une conversation avec sa poésie, son temps et en toute liberté de manœuvre. Elle revient en arrière, retrouve les traces du travail de ses poèmes – exécutions, réussites, échecs. De plus un falbala d’archives (pages de cahiers, dessins, collages, scénarios de films non tournés, morceaux de théâtre injouables, projets abandonnés) oriente avec émotion et humour vers ses derniers travaux aboutis.
Le livre construit de fait pour Liliane Giraudon le cursus de son autobiographie et de sa poésie. Les deux sont inséparables à la question « comment habiter le monde ? ». Et ses corpus livresques deviennent le réceptacle de traces qui, écrit-elle, s’agencent, « poursuivant la traque fantôme d’une forme-mouvement appelée poème. »
Sa poétique est à l’inverse du surréalisme. Tout est, au contraire, chez elle existentialiste. Qu’importe si parfois les escaliers d’un poème montent vers un « No Exit ». Mais ses poèmes sont plus des pièces que des cellules d’un perpétuel huis clos . Et chez elle il n’existe personne à blâmer ( sinon elle-même avec un poil voire une coupe de lucidité). Son travail est donc une ascèse et son œuvre rappelle parfois la sourde menace et la vulnérabilité. Dans ce but elle a multiplié les cellules souches plus que mères pour rêver d’harmonie et de paix contre chaos et zizanie.
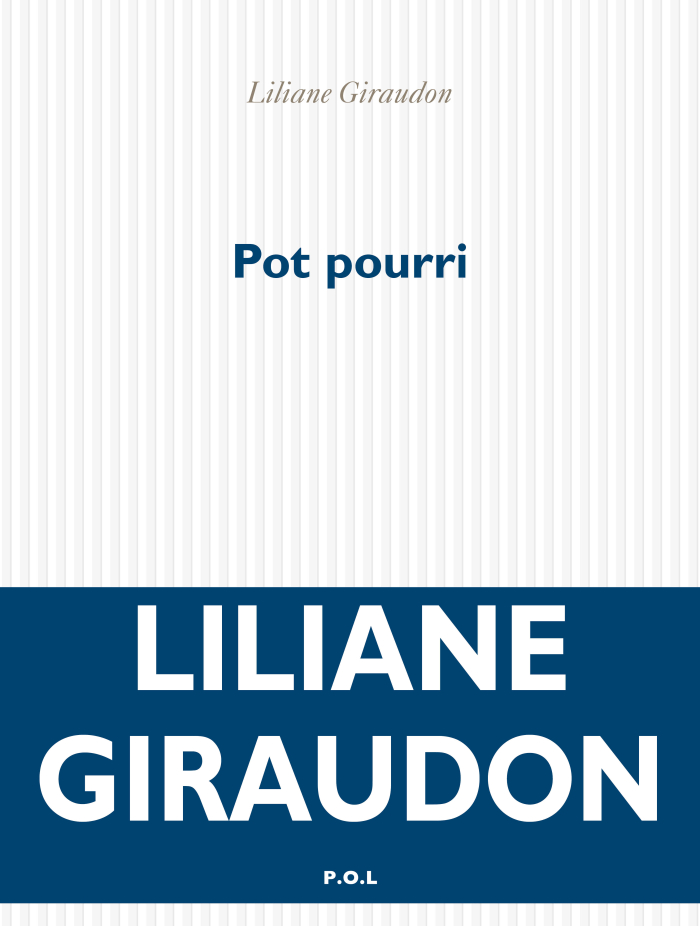
Liliane Giraudon, Pot pourri, P.O.L éditeur, 2025, 152 p., 20 €.
Saluons aussi une de ses qualités parfois superfétatoires : Liliane Giraudon ne joue pas les “malines”, ne reste jamais en postures figées. Elle cherche - par différents agencements, dont le dessin lui-même - libérer son esprit. Indulgente pour les Don Juan elle refuse le faux-semblant et le bellâtre. Certes pour elle le geste d’écrire ne suffit pas. Ce qui compte demeure le résultat.
Son livre rappelle enfin que créer reste un acte pas une théorie. C’est une dérive voire une « pathologie sublime » quand ses mots tatouent la béance et le plein. Le tout à la suite de son et de ses temps en ses textes pliés, dépliés, parfois troués, torturés, déchirés, tournés sur eux-mêmes en nœuds de résistance, reprise, répétition, rupture. L’objectif est de sortir parfois de tout effet de réel pour creuser l’énigme, le mystérieux. Sa poésie est donc Road-mot-vie avec parfois une belle complicité du mensonge mais pour refuser d’exhiber son leurre.
Reste chez elle la pulsion, la force d’affect, la fragilité des femmes spiralées. Pour Liliane Giraudon la vie est une grotte. Une telle ex-petite fille devient derviche en avers, revers, évocation plus qu’exposition là où dans ce texte, la documentation est accessible sous laquelle se cache une robe rose mais sans faire tapisserie. Une araignée dans sa tête tisse sa toile. Ici l’eau bout et l’au bout aussi chez celle qui dans son agressive douceur devient la sainte diablesse dont le bât blesse. Vampire au besoin elle ne suce pas mais crache son venin, sa puissance
Sans pathos, juste avec le symbolisme de l’élan vital jamais faire pleurer margot elle dit adieu à la petite fille en elle et veut toujours savoir comment les choses fonctionnent. Aussi bien les étoiles que le corps. D’où son intérêt pour les particules élémentaires et leurs articulations. Afin aussi que sa curiosité vis à vis de ce qui est érotique et sexuel ce qui n’enlève rien à son intellectualisme et mécanisme d’attraction. L’œuvre est avant tout un travail de découvrement, d’investigation contre l’ignorance et la superstition.
Chez elle la poésie est donc connaissance sans parler de sublimation, qui ne reste souvent qu’une habileté. Liliane Giraudon ne manque ni d’arrogance, ni d’ambition. Elle s’affirme indépendante et affranchie. D’un côté la sans peur, de l’autre (la coupable) qui tremble. Sans doute elle se sens très bien comme ça. D’autant qu’elle sait ce qu’elle vaut : raisonnable intelligente et “dérangée” (qui la rend plus riche). N’est-ce pas tout compte fait la meilleure définition de la poésie ?
Ce qui est important pour une telle auteure n’est pas l’origine de la motivation de son travail mais la façon dont elle est parvenue à vivre avec. Les deux sont inséparables. Sa tache reste de se concentrer son travail par tissage d’une toile afin d’accéder à son œuvre. Elle sait jusqu’où, à travers elle, elle on peut aller. Son travail reste guidé par une seule limite : ne pas se déposséder. Passer – au besoin – à côté de la vie mais pas à côté à côté du sujet. C’est prétentieux sans doute mais elle le sait parce qu’elle est modelée par ce qui lui résiste et aussi par ce à quoi elle résiste.
A noter : Le Centre international de poésie Marseille (Cipm) consacre une grande exposition à Liliane Giraudon à partir du 20 septembre 2025.