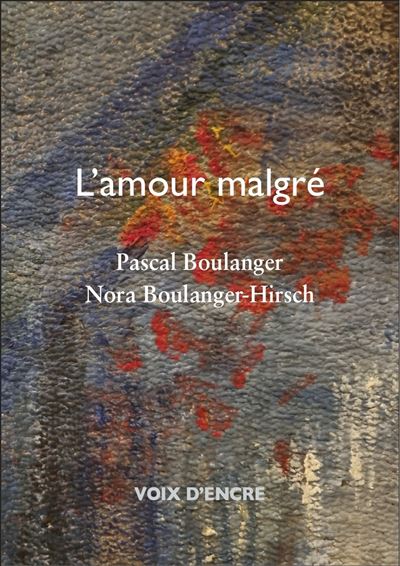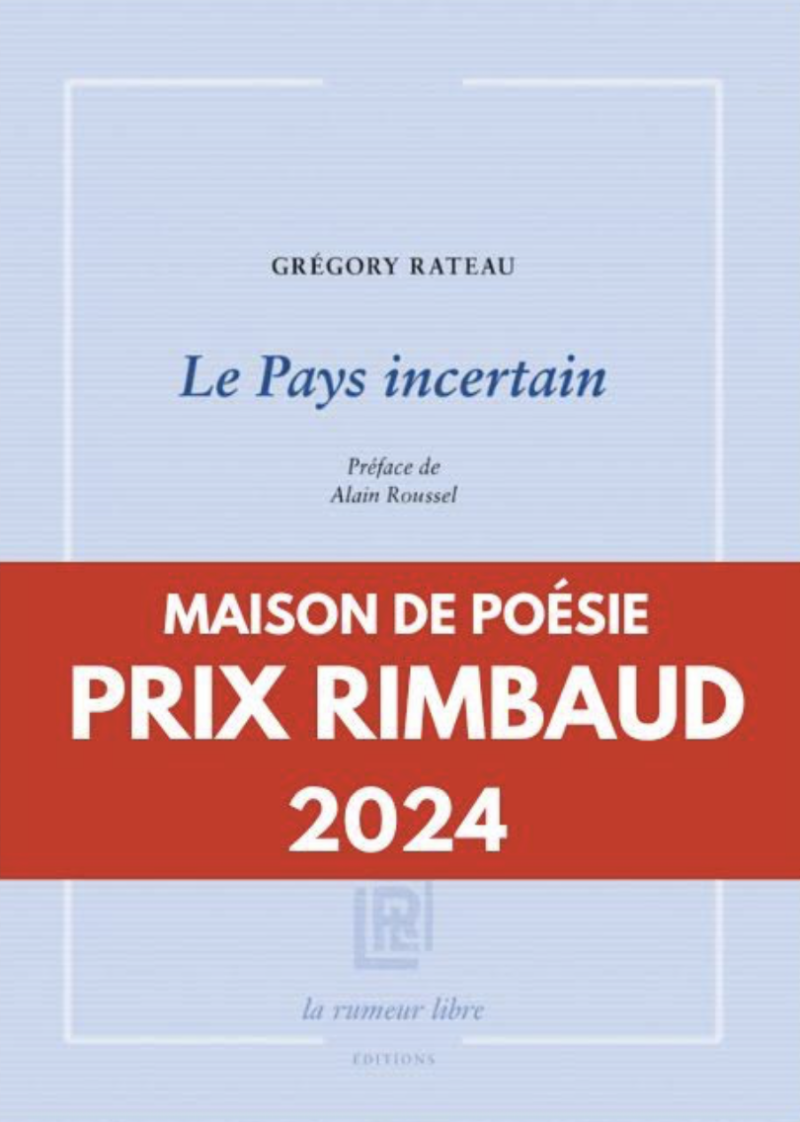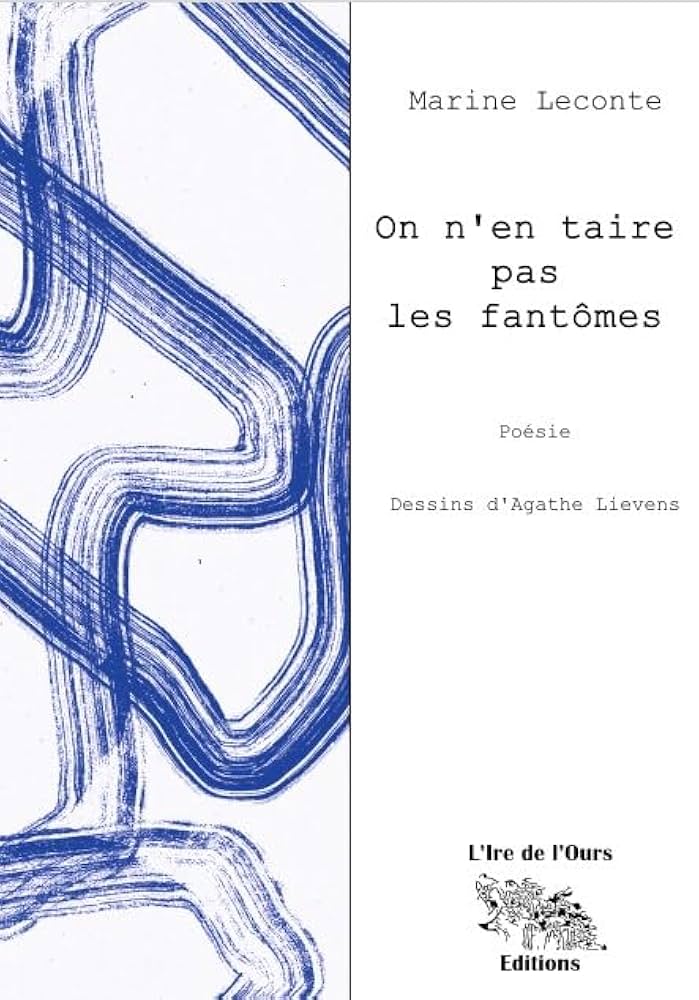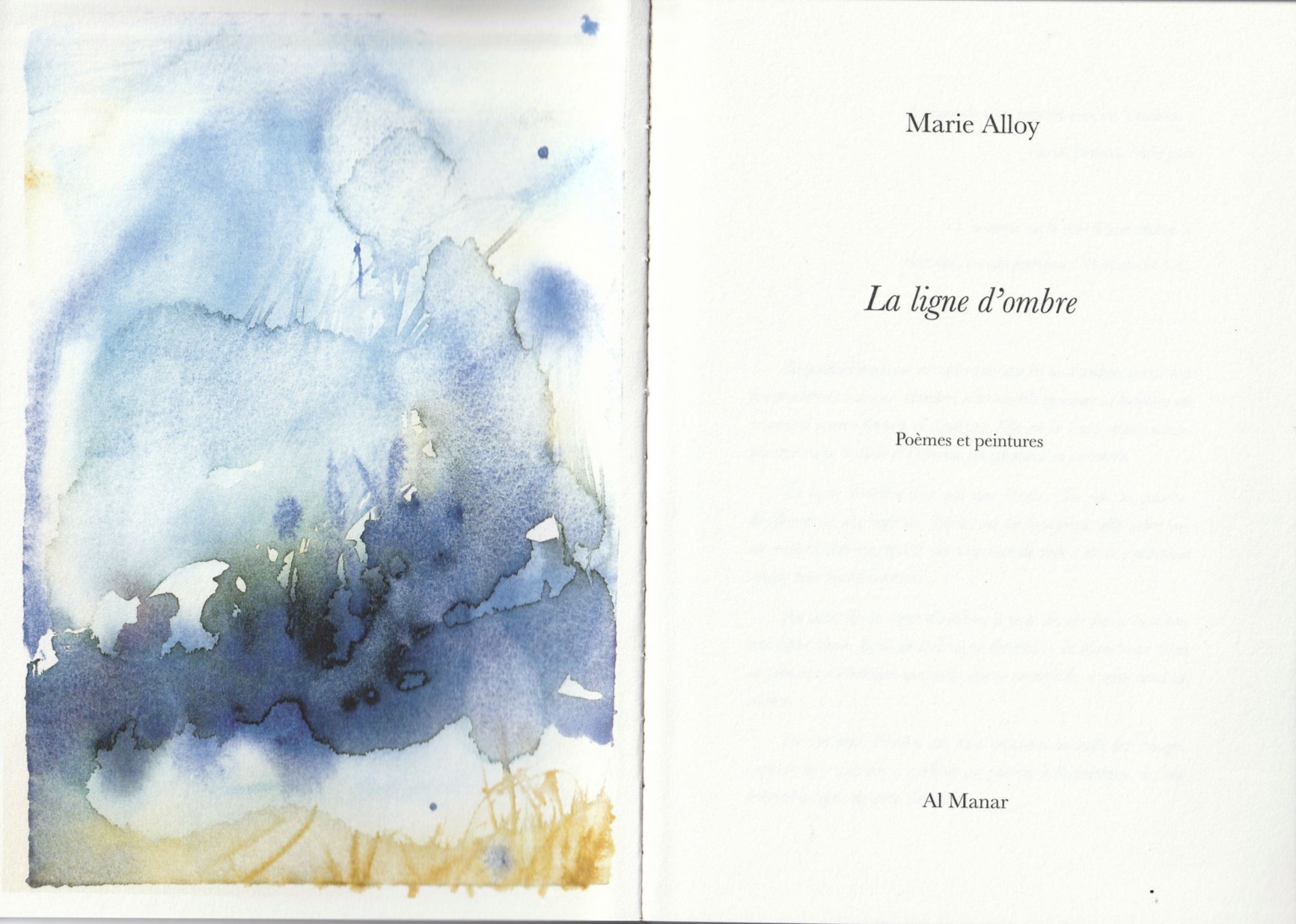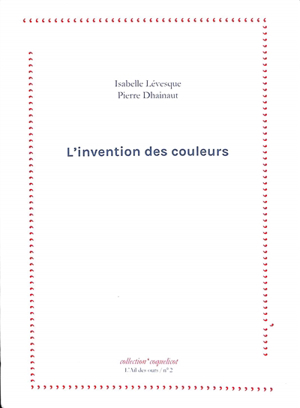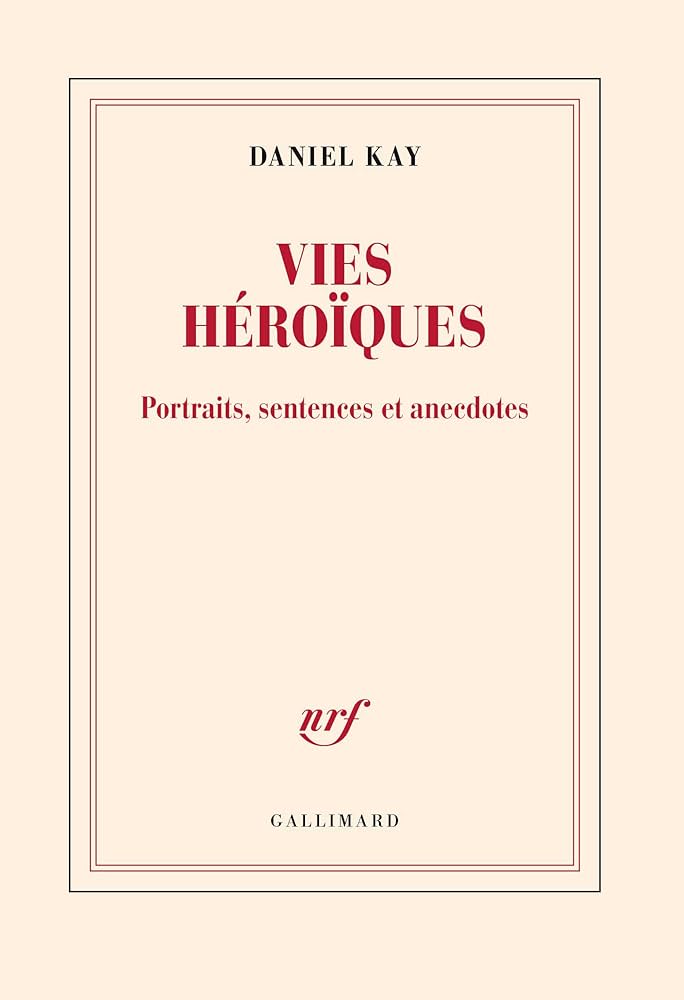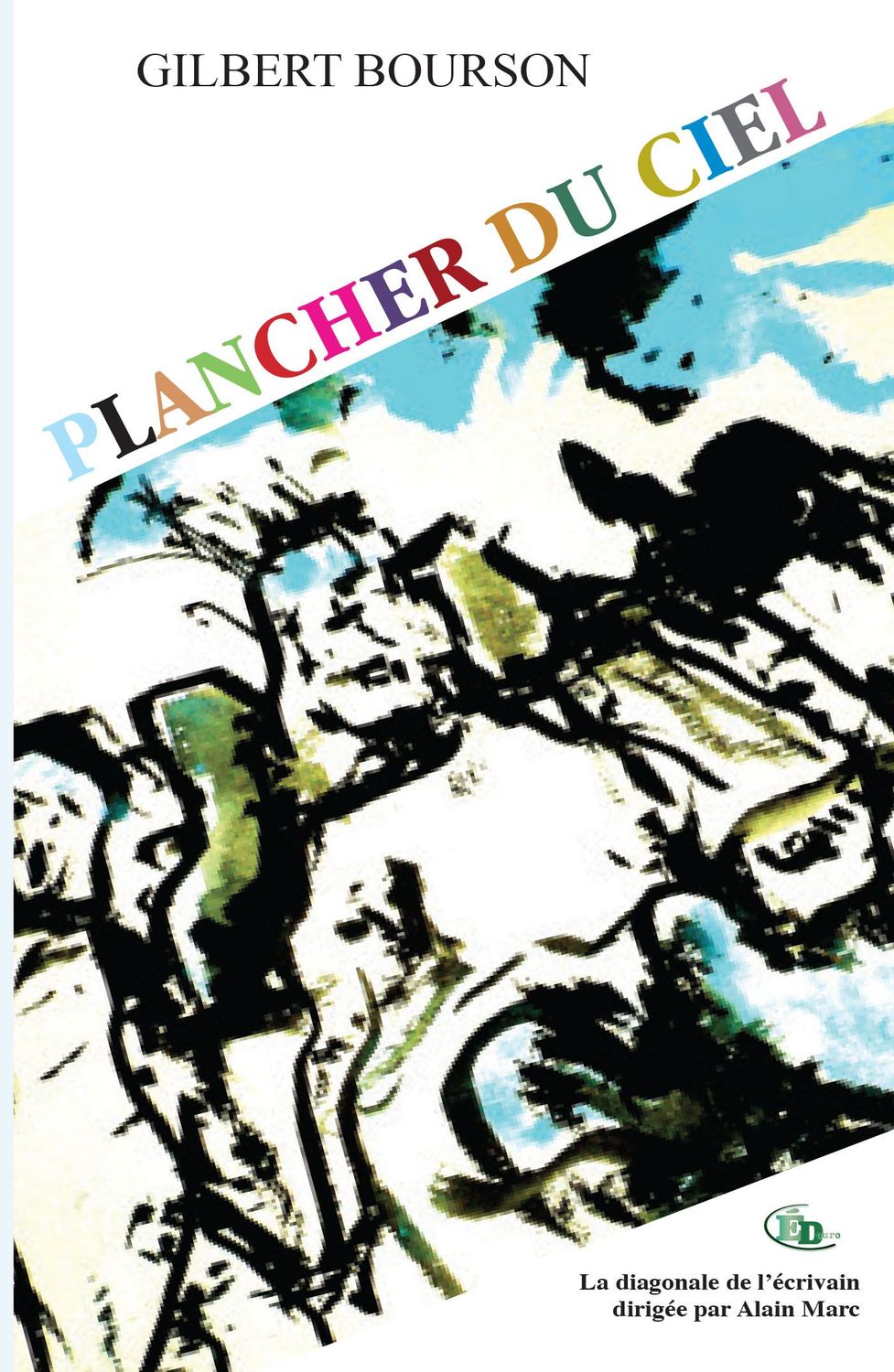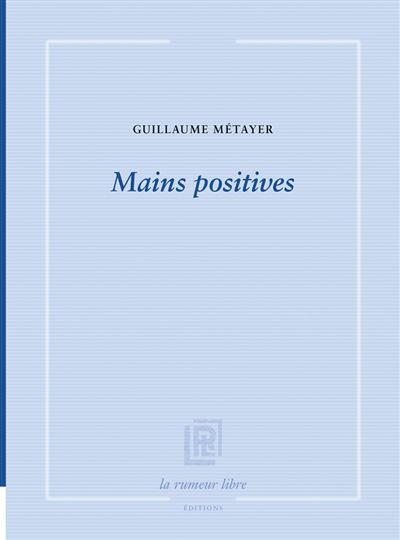Luigi Carotenuto, Deviens une fleur
« La poésie peut advenir dans la simple écoute du murmure des choses, c’est un exercice d’attention qui s’apparente à la méditation, au-delà du vacarme de l’actualité » dit Luigi Carotenuto lors d’une interview1. Dans ce nouveau livre, le poète s’éloigne du style ironique et désenchanté de ses premières publications.
À travers une poésie suspendue entre ciel et terre, entre obscurité et clarté, où les contraires ne s’opposent plus mais participent de l’Unité, Luigi Carotenuto exprime la spiritualité qui l’habite. Mais la poésie n’est-elle pas elle-même un chemin vers la spiritualité ? Le lecteur entre donc dans une boucle, mais une boucle laissée entrouverte, comme l’enso auquel il est fait allusion dans l’un des textes :
j’ai tracé le contour de tes yeux
et de ton nombril
pour parvenir au centre
de toi
je laisse une ouverture à peine de l’épaisseur d’un cheveu
comme dans l’enso zen
Ainsi, « l’Ouvert devient le nom poético-philosophique de l’Eden, celui de l’écoulement et du fleurissement du temps infini et muet2. »
Luigi Carotenuto écrit le silence, un silence parcouru de fulgurances, de visions, où le blanc de la page instaure le temps nécessaire à la méditation. Cette poésie, apaisée, ouvre un chemin de lumière, « Cette lumière de silence qui se tient en chaque chose, le poème tente d’en inventer en quelque sorte une équivalence : son propre silence, creusant la page, peut quelquefois rayonner aussi3. »
Deviens une fleur est un livre qui rayonne : Le soleil est dans chaque flamme, écrit l’auteur. Dans un style dépouillé et solaire, où chaque vers s’ouvre comme autant de pétales le long d’un chemin initiatique, il nous invite à entrevoir l’éternel à partir de l’impermanence des choses, nous rappelant ainsi que tout principe de vie ne trouve un équilibre que dans la complémentarité des contraires. De même que la lumière naît de l’ombre : dans le noir, veiller sur l’ombre/qui sert de berceau au blanc, on assiste à un renversement de la perception de la mort et de la vie :
la mort nous libère tous
dit un proverbe populaire
comme si tout était fini
quand on s’apprête à commencer

La plupart des vers de Deviens une fleur s’adressent à un interlocuteur. Il s’agit souvent d’un enfant – peut-être inspiré de ceux que côtoie l’auteur dans son milieu professionnel – et qui devient ici symbole de pureté et d’avenir, peut-être aussi de l’enfant épris de lumière qu’a été le poète4, cet enfant qui se révèle dans l’écriture et qui, sans le savoir, détient la sagesse d’un maître intérieur.
Enfant,
tu n’as pas idée
de tout le bien qui nous attend,
– dans le soleil il n’y a pas d’incertitude
les ruines sont des coquillages
ouverts
des fleurs écloses
des mains offertes
pour recevoir la lumière.
Au fil des pages, on comprend que l’emploi du « tu », qui désigne autant l’autre (y compris le lecteur) que le poète lui-même, est la manifestation de la mise à distance nécessaire à l’épanouissement de l’être intérieur.
se détacher de soi
pour
devenir des fleurs
Dans la sérénité du recueillement et la grâce du détachement, Luigi Carotenuto distille ses vers avec sobriété, simplicité et délicatesse, et si les aphorismes et l’emploi de l’impératif sont évocateurs de préceptes, Deviens une fleursemble davantage une confidence formulée à mi-voix, un « bruissement d’ailes5 » – qui n’est pas sans rappeler l’effet papillon de la théorie du Chaos – la transmission d’une conscientisation qui, exprimée par la poésie, devient une communion d’âme à âme dans laquelle se révèle l’énergie créatrice de la parole.
Dire éternel est déjà un bruissement d’ailes
Car ce livre est un livre à penser. Ce n’est qu’ensuite qu’on peut le lire, qu’on peut saisir la quintessence de cette poésie intemporelle d’une concision extrême dont les mots soigneusement choisis dans le champ lexical de la fleur suggèrent autant la beauté éphémère que la métamorphose, l’épanouissement et l’éveil (le Sahasrâra, lotus au mille pétales6). D’autres symboles jalonnent le texte : le carré, le cercle, les couleurs… tous pouvant être interprétés de diverses manières car c’est à chacun de trouver son propre cheminement. Si la numérologie n’est pas indispensable à la compréhension des textes, elle n’en éclaire pas moins les trois parties dont le nombre respectif de poèmes symbolise successivement la dualisme, l’unité et l’union. À noter que le chiffre 3, symbole d’accomplissement, peut être perçu comme dépassement de l’illusion par l’amour7, menant à la paix intérieure.
Ce recueil est à l’image de la méditation : un détachement apparent que l’on se gardera d’assimiler à une absence d’émotion : celle-ci, maîtrisée, prend ici le nom d’émerveillement. La douceur lumineuse et la discrète sensualité qui en émanent induisent un calme et une gratitude qui donnent envie d’adresser à l’auteur ces mots d’Arthur Rimbaud : « Le monde a soif d’amour, tu viendras l’apaiser8. »
Notes
[1] Extrait de l’Interview de Grazia Calanna parue sur le site de la revue culturelle l’EstroVerso le 5 février 2024.
[2] Entretien avec Pascal Boulanger, par Carole Mesrobian, Recours au poème, janvier 2024.
[3] Gérard Bocholier, Le poème, exercice spirituel, Ad Solem, 2014.
[4] « Depuis que je suis petit/je défie le soleil/en le regardant droit dans les yeux ». Traduction d’un inédit extrait de Ra patti ro suli (Du côté du soleil) de Luigi Carotenuto, recueil écrit en sicilien accompagné d’une traduction italienne de l’auteur.
[5] Titre de la troisième et dernière partie du recueil.
[6] Centre cérébral supérieur au-delà des six chakras dans le tantrisme hindou.
[7] Dictionnaire des symboles, Jean Chevalier - Alain Gheerbrant, Bouquins éditions/ Jupiter, réédition de 2012.
[8] Arthur Rimbaud, Soleil et Chair, poème écrit en 1870 et publié pour la première fois dans Reliquaire, poésies, L. Genonceaux, 1891.