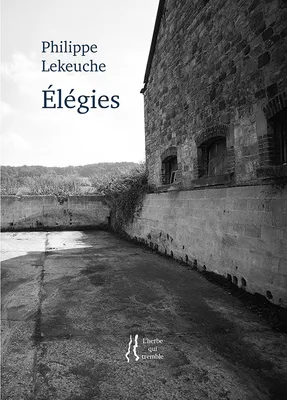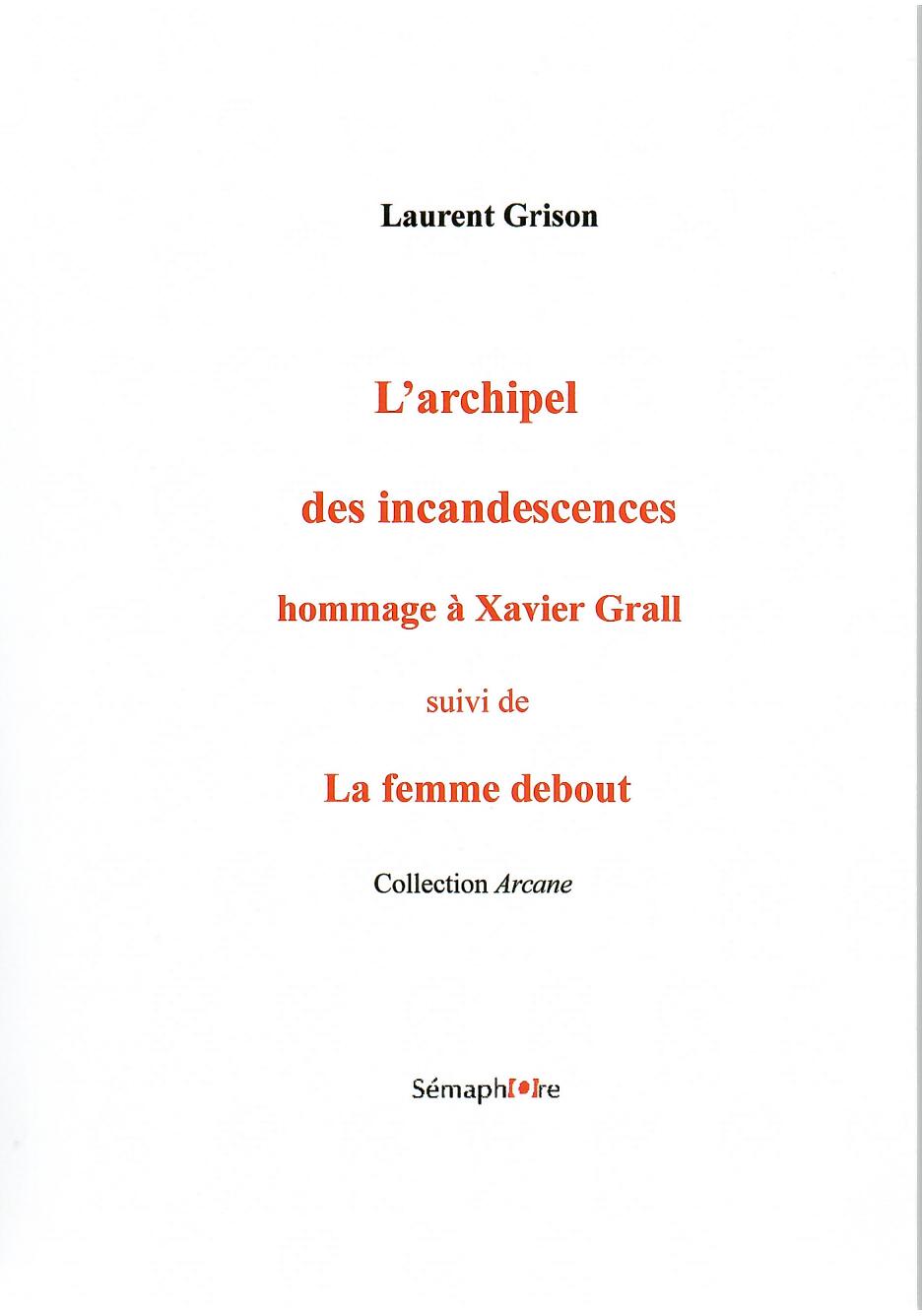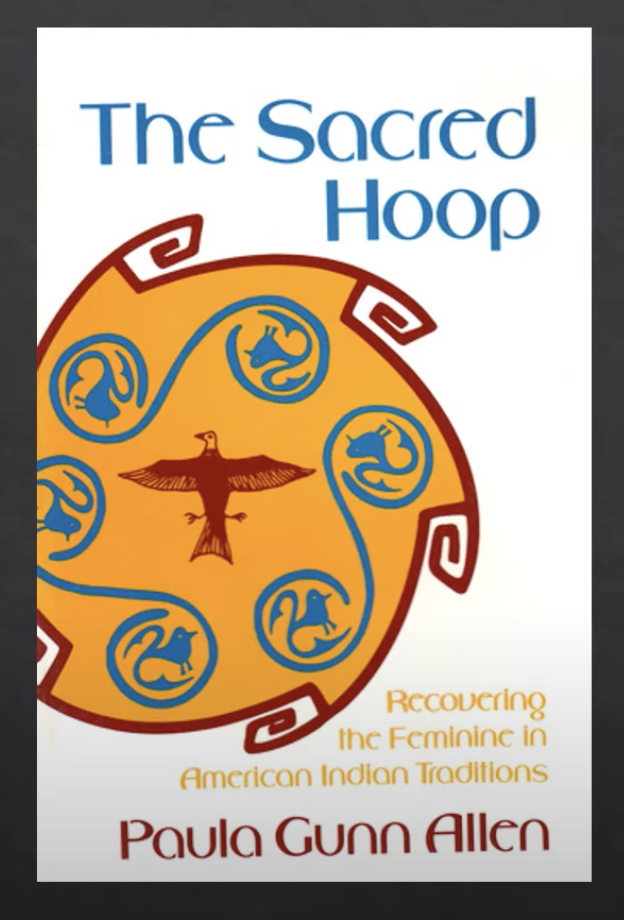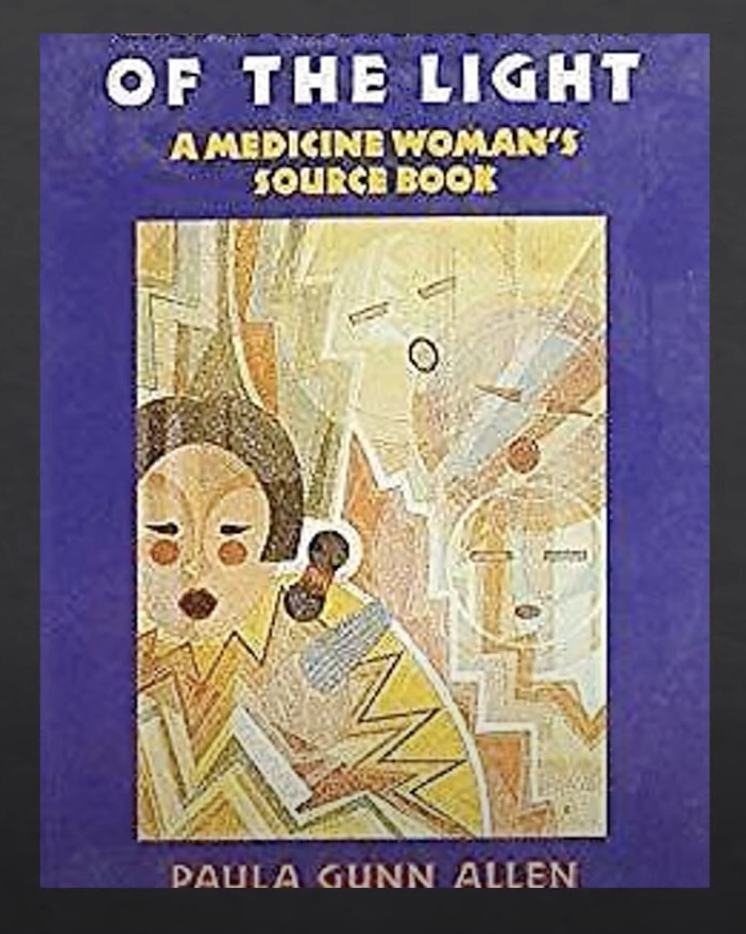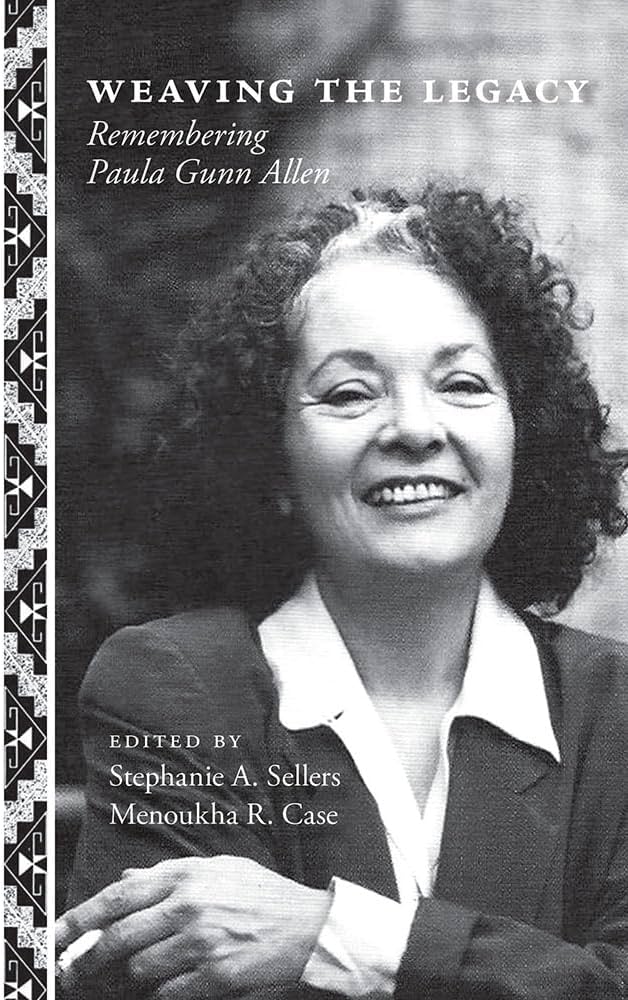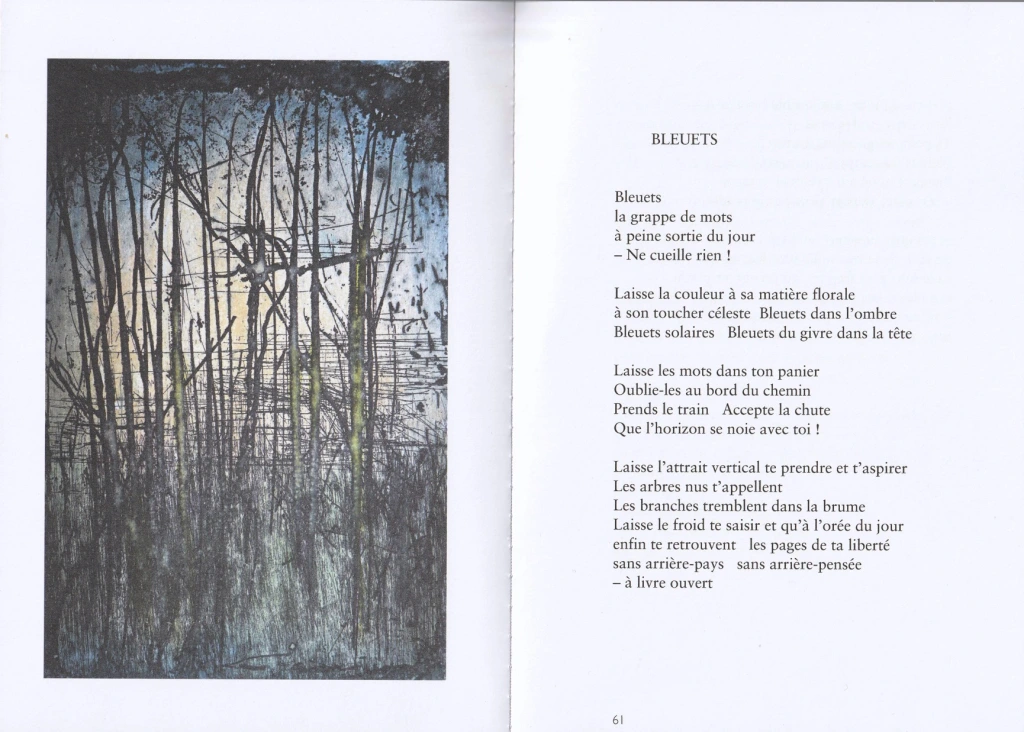Joanna Mueller, Zmieszane, (2000–2025) Poèmes mélangés
Présentation et traduction Alice Catherine Carls
Née en 1979 à Piła, Joanna Mueller est poète, essayiste, éditrice, et mère de famille nombreuse. Vivant à Varsovie, après avoir obtenu son doctorat en littérature, elle se consacre à la poésie depuis plus de vingt ans. Outre de nombreuses publications en revues, elle a publié huit recueils de poésie et quatre livres pour enfants. Elle a reçu le Prix de la Première Littéraire de Varsovie en 2010 pour son recueil d’essais intitulé Stratygrafie [Stratigraphies] et le Prix Silesius en 2023 pour la totalité de son œuvre poétique. Outre ces prix, elle a été nominée pour de nombreux prix littéraires. Elle est membre de l’association Wspólny Pokój, une association féministe qui soutient les femmes poètes et elle fait partie du mouvement néolinguiste polonais. Elle a également participe au concours « Sfotografuj Wiersz – Zwierszuj fotografię » pour lequel les candidats doivent prendre une photo et écrire un poème qu’elle leur inspire – ou vice-versa.
La liste de ces publications très variées annonce la teneur de l’oeuvre de Joanna Mueller : ekphrastique, contrapunctique, féministe, néolinguiste, hermétique, sa poésie exige une clé qui se trouve dans une culture littéraire et visuelle très étendue. La poète offre également une approche nouvelle de l’ekphrasis qui va beaucoup plus loin qu’une lecture d’un objet visuel fixe par les mots. Joanna Mueller reconstruit des objets visuels en faisant surgir une image neuve à partir de supports pas forcément « fixes » ni visuels, tels le cinéma, la chanson ou les rapports médicaux sur le traitement de l’hystérie féminine. Elle prend appui sur des œuvres très variées pour proposer une interprétation féministe qui présente les émotions pensées et désirs des femmes en termes de leurs droits. Ceci implique un contrepoint entre liberté, désir, et affirmation d’une part, et soumission au carcan patriarcal et social de l’autre. Comme dans la poésie de Tymoteusz Karpowicz, que Joanna Mueller connait intimement pour lui avoir consacré un volume d’études, le poème est une imbrication de mots où chacun a sa place et sa sonorité. Le poème est comme un puzzle, ce qui exige du traducteur un jeu verbal haut de gamme et du lecteur, la découverte d’une vaste mosaïque culturelle sans la connaissance de laquelle le poème perdrait son équilibre. Complémentant cet arsenal d’outils poétiques, Joanna Mueller reconnait volontiers l’influence des Surréalistes sur son œuvre, ce qui place cette dernière sur le fil du rasoir entre la réalité et l’imaginaire et entre l’acceptation et l’évasion.
Joanna Mueller lit le poème « waruj, wariuj, zawierz » ("attends, deviens fou, fais confiance") tiré du recueil de poésie Hista & her sista, publié en 2021 par Biuro Literackie.
Zmieszane (2000-2025)
Poèmes mélangés
dziewczyna której przerwano (p. 16)
balthus, 1934, 1949
innemu poddana graniu
jak każe pędzel roli klucz wioli
nowy akord kuck mal unde malum
z boku śpi ukulele gdy okulla
płaskobrzucha nieważka libellula
w łuk się gnie wirtuozka bezgłosu
chwyty skaczą jak pchły pod progami
palce szarpią napięte struny
a w punctum pępka wkłuty wgląd
łamie się virga neuma zanika
pożądlona przez oczy
nimfa z pękniętym gryfem
omdlały okaz który z pietyzmem
rozstrojono do wymotylenia
La fille, interrompue
Balthus, 1934, 1949
une libellule légère au ventre plat
ocullule soumise à un autre jeu
le pinceau dirige une clé d’alto
un nouvel accord kuck mal unde malum1
un ukulélé dort par terre
la virtuose du silence se cambre
les pizzicati gambadent en puces sauteuses
les doigts frottent les cordes tendues
le regard plonge dans le punctum du nombril
la virga s’interrompt le neume s'efface
dans les yeux plissés
la nymphe au manche fissuré
se pâme spécimen pieusement
excité jusqu’à la mue
arc d’joan (p. 22)
na melodię dumonta
od dusz zwierzęcych
dziewczynkę świrynkę
wezmą mnie i będę im zbrojna
jak ślepa arkada
możnowładcza pragma
królewska sakra
pułk jeremiad daremnych
uwiodę aż mnie dorwą
córki sajdaka twego
krzyżowo wysklepię się
naga który dla mnie
nad łąką napinasz łunę
arc de jeanne (p. 22)
sur une mélodie de Dumont
des âmes animales des champs
c’est moi qu’ils prendront
fille folle je les défendrai
comme une arcade aveugle
commandante toute-
puissante
royale sacrée
je guiderai le régiment grognard
jusqu'à ce que m’atteignent
les filles de ton carquois
nue je me cambrerai en croix
toi qui pour moi
baignes le pré de ton arc de lumière
powód się znajdzie (p. 25)
ale mam pod ręką tajną maszynę do przewrotów
Lucyna Skompska, „Hic et nunc”
jak drzemliczkę w losie łapie trzask spojówki
pręt się wpaja w krwiobieg w wargi bratek
jak na musiku stoję jak kajam się w majak
w klęku podpartym po pachwiny ubaw
jak dech po tracheo obrusz na obróżki
lecz na końcu języka zawsze mam przepraszam
panikarski nawyk pchnięcia aż do miazgi
cała para w gwizdek na tłumienie siebie
jak likwidacja pisków i farba do fasad
ciche cięcia do wnętrza ważne schować głowę
jak czyhanie na skuchę sztych w strefie spadkowej
jak kulejąca królica koziołkuję z ramy
on trouvera la raison (p. 25)
mais j'ai sous la main une machine subversive secrète
Lucyna Skompska, « Hic et nunc »
la conjonction se rompt comme une sieste du destin,
la tige se distille dans le sang la violette sur les lèvres
au garde-à-vous canot camouflagé
à quatre pattes rigolant jusqu’au cou
respirant post-trachéo, déchirant mon collier
mais sur le bout de la langue, prête à m’excuser
habitude panique de pousser jusqu’à la pulpe
toute la vapeur dans le sifflet pour se réprimer
liquidation de grincements et peinture de façade
coupures internes silencieuses se protéger la tête
guetter la tentation dans la zone glissante
hase clopinante je tombe du cadre
Szczodrak (p. 55)
wierszu wierszu szczodry wierszu
przejrzystego w męt nie fałszuj
nie zatrzaskuj w słusznym gniewie
jak odczytasz mnie niech nie wiem
głos mi z szumu wynegocjuj
ogołacaj i owocuj
karm niedosyt sypnij dreszczem
rozmienionej mów że jestem
wrogi gościu mir naruszaj
wypierane myśli wpuszczaj
za próg mowy a te błahe
pomnóż w sensy pod swym dachem
gdy się zmieszam z mierzwą zdarzeń
bądź ucieczki gospodarzem
w szczerym polu skrajem wiersza
przeleciała jaskółeczka
[wejdź]
Générosité (p. 55)
poème poème généreux poème
n’assombris pas la transparence
ne t’emballe pas dans une juste colère
si tu me lis je ne veux pas le savoir
dégage ma voix du bruit
dénude-la et fais-lui porter des fruits
nourris sa fringale donne-lui le frisson
dis au changement que je suis
l’ennemi hôte viole la paix
laisse les pensées refoulées franchir
le seuil de la parole et sous ton toit
féconde la trivialité en richesse
si je me mêle aux fétus de l’histoire
accueille-moi dans ma fuite
une hirondelle traversa
l’espace au bord du poème
[entre]
god in gotham betlejem w bedlam (p. 180)
żebro żłobu na opak grób
mur truchleje odchył głowy piąstki w moro
belki w oczach grot bez klamek
źdźbło obnażone pod obrusem śniegu
rąbek rwany z naszych bandaży
pępowina przesmyk pętla
god dans gotham, bethléem dans bedlam (p. 180)
l’osier de la crèche frôle la tombe
le mur tremble incline la tête poing en camo
poutres dans les yeux flèche sans poignée
blé dénudé sous sa nappe de neige
ourlet déchiré de nos bandages
cordon ombilical isthme boucle
o la la folie ofelie (p. 187)
Poszła za nim w obłęd.
- Grochowiak, Nowela IV (Poranek Wariatowej)
co się zaczęło dziać ze mną jest lepkie
muliste zaplata kłącza w warkoczach przydługich
rękawów przytachałam naręcze sprawunków
postanowiłam że kwiaty kupię sama
filuternie śmiechem obdarzam śmieciem
bratki jaskry palce palce fiołki ruta idź
w welonie z celofanu cofam dłoń równowagę
tracę wianek rwie się o konar próg
za którym przestaję stawiać opór dzięki
stokrotne o mój rozmarynie liżąca falo nade
mną filuj gdy wiolencja tłucze filety płuc tańczę
dychawicznie na imię mi ratuj ty diluj z tym dalej
oh là la folie ophélie (p. 187)
Elle le suivit dans la folie.
- Grochowiak, Roman IV (Le matin d’une folle)
ce qui commence à m'arriver est poisseux
tissage de boue dans les tresses de mes longues
manches j’ai emporté une brassée de provisions
j'ai décidé de choisir les fleurs moi-même
je joue à salir le rire et à rire de l’ordure
pensées boutons d'or digitales violettes rue des jardins allez
voilée de cellophane je retire leur équilibre à mes mains
je perds ma couronne elle se déchire à la branche du seuil
contre lequel je cesse de résister grâce à
mon romarin à la vague qui cent fois me recouvre
vois la violence me déchirer les poumons je danse
éperdument sauve mon nom, continue à dealer tout ça
stubezgłowa (filetowanie) (p. 37)
la femme 100 tetes
za te które potraciły dla was
spłyń do karmelu siostro
perturbacjo do burdelu półgłówku
harda hydra podnosi swoją
odrąbią odrośnie las w tej kobiecie
na stole sekcyjnym ość po ości
skrobakiem oka w brzuchu włos
po włosku z brodatego żartu wujaszka och
jak lubiły go czochrać w niedzielne
popołudnia żeby mu było lekko
sprawnie odwraca cięcie przyrastają łuski
aż do wyczucia kręgosłupa brzeszczot
gładzi wyoutowane wnętrzności otwórz
walizkę dobry człowieku dochował
sekretu wyborny trup na okrętkę
zszywa loop co wydziobał loplop
trudny do osuszenia ciek i jeszcze
jedna i jeszcze raz a kto z nami nie
La femme 100 sans têtes (filetage)
la femme 100 têtes
pour celles qui ont perdu la tête à votre place
nage juqu’au carmel o ma sœur
affoleuse de bordel imbécile mi-tête
la fière hydre relève les siennes
coupée cette forêt de femmes repoussera
sur la table de dissection os par os
gratte-yeux dans les poils du ventre
une blague en italien de l’oncle barbu oh
comme ils aimaient le frotter le dimanche
après-midi pour lui faciliter les choses
il retourne habilement la coupe repousse les écailles
jusqu’à la colonne vertébrale la lame
lisse les tripes éventrées
cet homme bon a gardé la valise
du secret cadavre exquis sur navire
recoud le loop2 picoré par loplop
difficile d’assécher le ruisseau et encore
une fois et encore une et celui qui avec nous ne
role playing: frollo (p. 201)
w kruczym profilu płaczliwy chłopczyk strzępi
kartki sroży karę za kres katedr tropi
zamach na gmach
trapią go kastaniety sarabandy
wersy przebijają bębenki smagłe smalą
sępi wzrok przykuwa choć
chciałby gładzić głodzi choć
pragnie pożreć rozżarza choć
syci go duchowa oschłość
z ambony głupia
koza quasi hexe
cygani archi
i kona
samo
ukojona
w węgle lewego skryptu w niemocy prawa
to zgładza tamto
role playing3 : Frollo (p. 201)
un garçon pleurnichant au profil de corbeau déchire
des pages épie les sévères punitions depuis la chaire
l’attaque de la baraque
la sarabande des castagnettes le trouble
les tambourins rehaussent les versets
son œil de vautour attire et
il aimerait caresser il a faim et
il voudrait dévorer il brûle mais
la sécheresse spirituelle le satisfait
de la chaire une stupide
chèvre quasi sorcière
gitane archi
et meurt
s’étant apaisée
toute seule
dans le feu des gauchères et l’impuissance du droit
l’un annihile l’autre
mężczyzna który pomylił
swoją żonę z brytfanką (p. 235)
kto jak nie on wpędził ją w lata
że teraz tylko procenty zbierać
z tego zmęczenia które narosło
w lokacie korzystnych tkanek
tania ta niezależność nie jest
do dna dokładała ze swego
w służbie bez żołdu żółcią nabiega
i kto to widzi nie on
cień po sobie wmurowała pod dom
bo w niej jest smutek nie seks
spotify zna ją lepiej niż mąż
tam dziś żaltrack z roberty flack
love the lie and lie the love
where’s that bee and where’s that honey?
where’s my god and where’s my money?
try to make it real – compared to what?
24.02.2025
L'homme qui a pris
sa femme pour une rôtissoire (p. 235)
qui sinon lui l'a tant poussée au fil des années
qu’il ne reste que des pourcentages
de cette fatigue qui s'est accrue
en investissement de tissus profitables
cette indépendance n'est pas bon marché
elle y a mis du sien dès le départ
au service sans solde carburant à la bile
et qui le voit certainement pas lui
elle a emmuré son ombre sous la maison
parce qu'elle est tristesse pas sexe
spotify la connaît mieux que son mari
et aujourd'hui le reproche de roberta flack
love the lie and lie the love
where’s that bee and where’s that honey?
where’s my god and where’s my money?4
try to make it real, compared to what?
24.02.2025
Notes
où est cette abeille et où est ce miel ?
où est mon dieu et où est mon argent ?
essaie de rendre ça réel par rapport à quoi ?
Première partie de l'entretien entre Karol Maliszewski et Joanna Mueller.