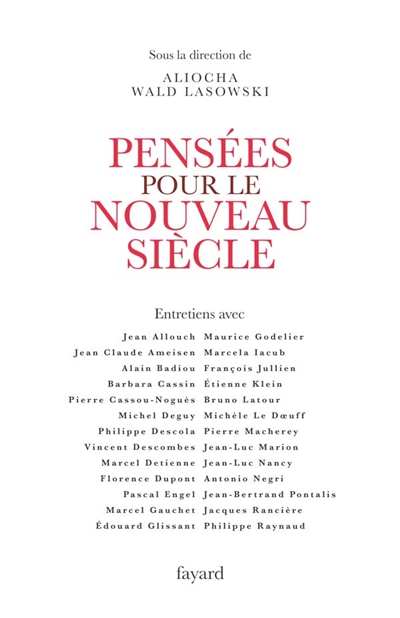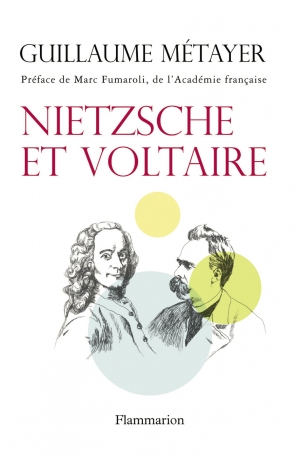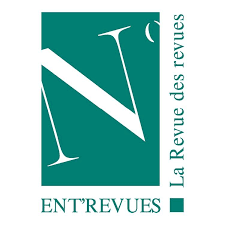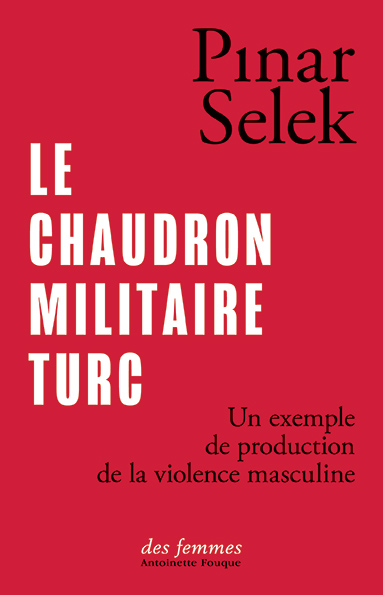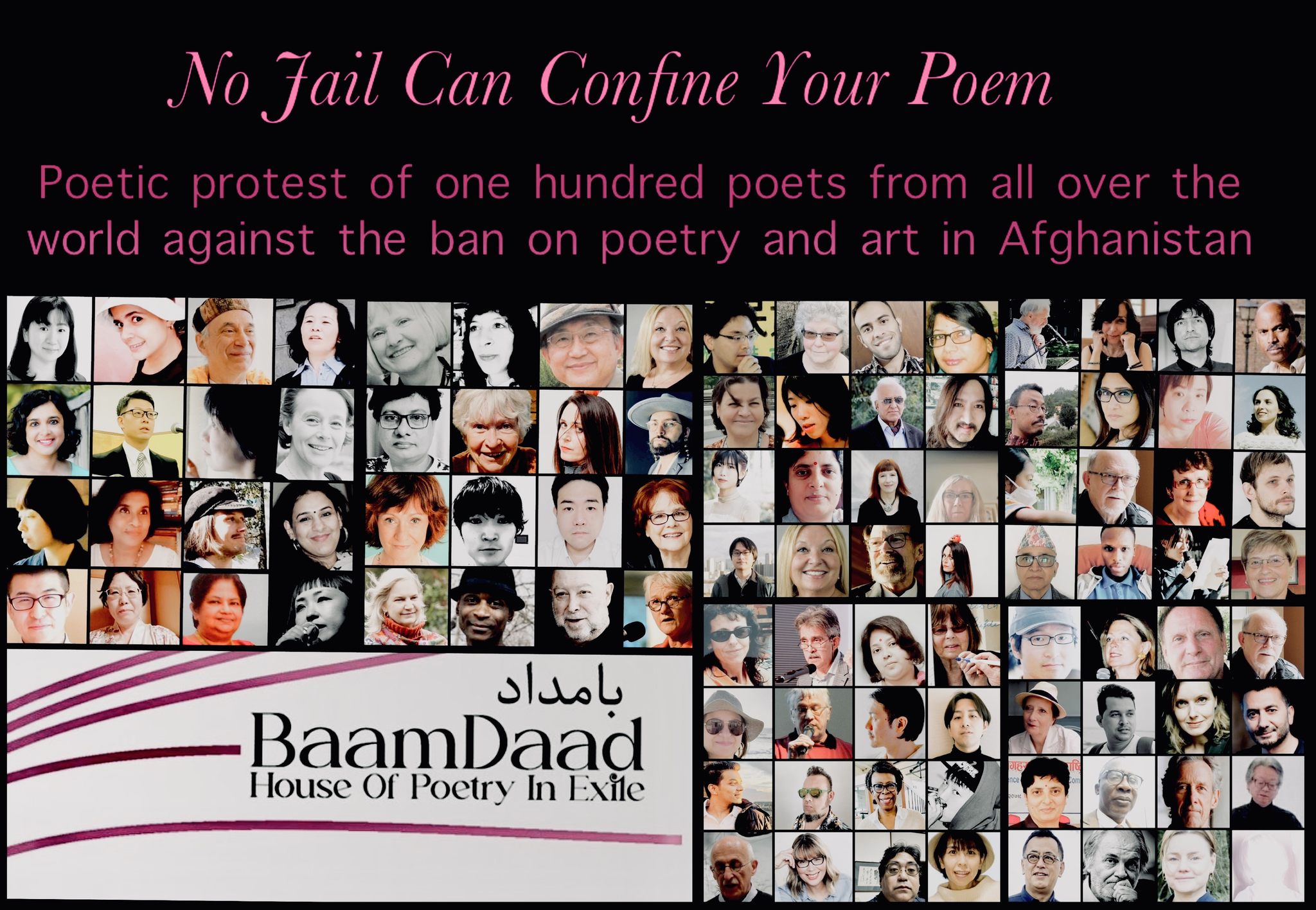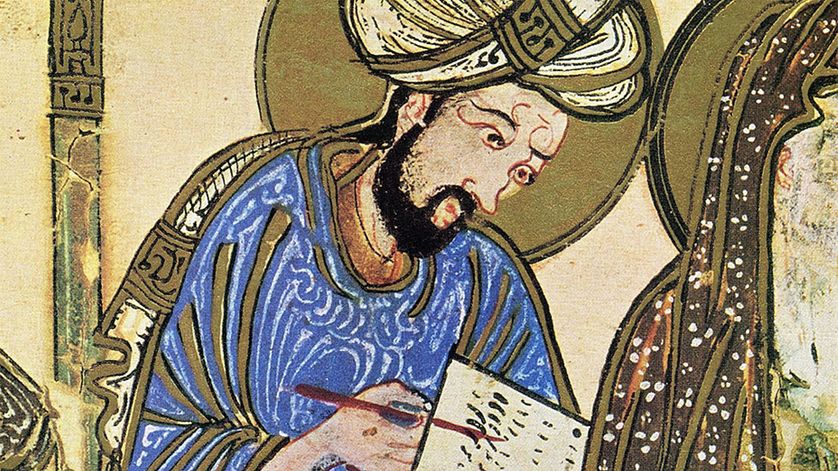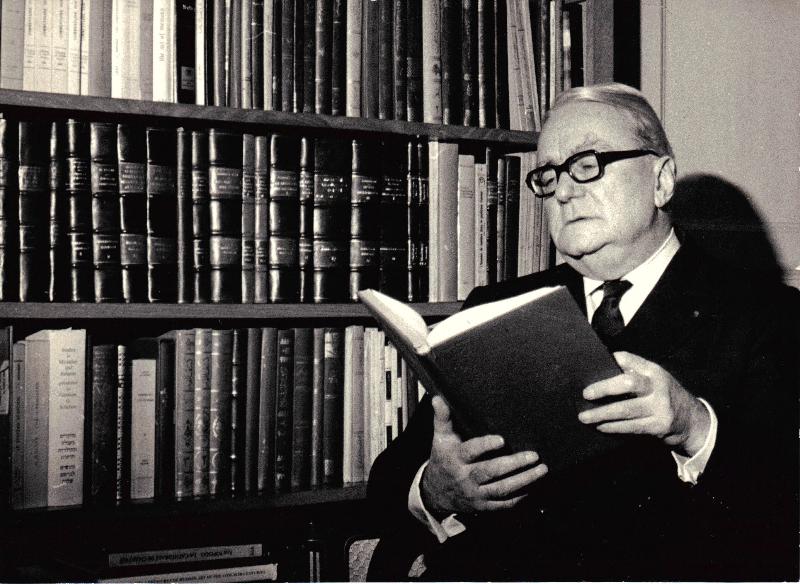Pouvez-vous également évoquer Ent’revues ?
Vous faites bien de poser cette question… En effet, même si en plus du Salon, nous organisons une soirées par mois, si nous favorisons la présence de revues dans d’autres manifestations comme le Marché de la poésie ou le salon Numéro R, avec le cipM de Marseille, Ent’revues n’est en rien une agence d’événementiel ! Son travail se déploie sous bien d’autres axes : la création, l’entretien quotidien, l’enrichissement de notre site internet qui compte près de 4 000 références de revues est l’un d’entre eux et non le moindre. Il permet à chaque revue du domaine francophone d’accéder à une « dignité bibliographique » qu’elle ne trouve nulle part ailleurs. Chaque revue créée reçoit, ainsi, une première lumière en occupant la Une du site. Depuis quelques années, nous l’avons enrichi d’un espace critique : ce sont plus de 600 comptes rendus qui témoignent de l’actualité éditoriale de nombre de revues. Là encore, nous pouvons affirmer sans forfanterie que nous leur offrons un service inégalé. Ce travail au long cours, avec ses plus de 200 000 pages vues, des usagers de 150 pays, participe assurément à la connaissance et au rayonnement des revues de langue française.
Ajoutons que, riche d’un Guide pratique à l’usage des revues, ce site s’impose aussi comme un espace d’information et de formation des revues : autre mission d’Entrevues.
Il faut bien sûr évoquer La Revue des revues, notre vaisseau amiral. Son rôle ? Inscrire le présent des revues, leurs mouvements contemporains dans une histoire plus longue, plus large, autrement prestigieuse et pourtant largement méconnue. Il s’agit à la faveur d’études, d’analyses, de plongées historiques de désenfouir l’histoire des revues, petites et grandes – les petites qui ont souvent su être autrement plus créatives, aventureuses que les plus renommées. En somme, leur redonner leur juste place dans notre histoire culturelle, dans nos modernités, les combats esthétiques dont elles ont toujours été les têtes de pont. Et ainsi tendre un miroir aux revues d’aujourd’hui qui mènent un même travail, sans cesse à faire valoir.
Du Salon de la revue au travail de fourmi du site en passant par les réflexions menées par La Revue des revues, Entrevues c’est la recherche de la base et du sommet ! Une architecture cohérente aux pieds fragiles et à la tête toujours aux aguets, le tout portée par une équipe minuscule…
Pourquoi les revues ? Quel est leur rôle, quelle est leur importance ?
Ah, la terrible question ! Selon les domaines, la nécessité est plus ou moins évidente. La poésie ne saurait se passer de ce terrain d’expérimentation, d’hybridation, de jeu aussi. Les sciences humaines, dans un contexte académique, cherchent plutôt la forme canonique, contrôlée par les pairs. Entre les deux, entre les champs, des formes plus ou moins pures, plus ou moins mêlées, mais toutes mues par la volonté d’échange, d’expression et de création. La motivation est le partage, la générosité : peu d’entre elles gagnent de l’argent, font vivre leurs initiateurs. Elles agissent comme des fécondateurs, précédant, accompagnant d’autres aventures, éditoriales, scientifiques, artistiques, militantes. Leur importance est aussi relative et difficile à évaluer. Si les revues ne sont plus les caisses de résonnance des débats artistiques, littéraires, politiques, elles constituent toujours des îlots de réflexion, de confrontation, d’expérimentation, de façon (trop) discrète, mais opiniâtre. Puisqu’elles ne sont pas rentables, qu’elles se heurtent vite à un problème d’échelle, de diffusion, pourquoi continuent-elles à se créer, et de la part de jeunes gens ? Il y a là un paradoxe alors, la moindre des choses est de reconnaître et d’accueillir au mieux ces entreprises, et continuer à les promouvoir.
Au cours de cette édition 2023 vous avez fait circuler une pétition. Pourquoi ? À quel problème est confronté le Salon de la Revue ? Est-ce que sa survie est menacée ?
Ent’revues n’est pas l’initiatrice de cette lettre ouverte.
Ent’revues a été créée en 1986 sur l’absence de lieu de visibilité des revues en tant qu’objets spécifiques, existant entre les livres et la presse. Les statuts fondateurs évoquaient la création d’un centre de ressources : le savoir accumulé entre les pages de La Revue des revues, l’annuaire entretenu des revues culturelles francophones, l’accueil fait aux revuistes, le repérage des créations, etc., voilà notre socle, notre ressource. Mais on nous en demande plus, du côté des statistiques, de chiffres pour lesquels il nous faudrait entrer dans des comptabilités largement artisanales, souvent personnelles, dans ce paysage complexe et mouvant des formes de revues évoquées plus haut. Il nous faut démontrer que le Salon est utile, et non un rendez-vous de copains satisfaisant un entre-soi, essentiellement parisien. Sinon la baisse de notre subvention, effective depuis deux ans, va se poursuivre et de façon drastique.
Or nous fonctionnons à deux permanents, dont un temps partiel. Il y a un moment ou ce ne sera plus possible. Nous sommes bien conscients qu’il nous faut trouver – c’est une incitation générale – des ressources autres. Dans cet esprit, nous allons notamment demander l’attribution du statut d’association d’intérêt général, nous permettant de solliciter adhérents, contributeurs et mécènes avec une déduction fiscale.
Le calendrier a joué contre nous : l’année 2020 a gelé tous projets. 2021 a été pour nous une année de déménagement, quittant l’ancienne adresse sans savoir pour quelle destination. Après trois mois « hors sol », nous avons atterri à la FMSH, boulevard Raspail, tout en préparant un salon, en sortant la revue, en poursuivant notre travail. 2022 est l’année des calages administratifs, ô combien chronophages, d’un retour à une forme de normalité : on nous écrête la subvention. Cette baisse se poursuit en 2023, alors que nous changeons de présidence et poursuivons nos actions, tout en travaillant de façon à exploiter nos annuaires, nos répertoires, nos bases de données : mais cela suffira-t-il pour répondre aux questions ? Et quelles sont ces questions ?
Nous avons informé nos exposants, nos adhérents de cette menace et l’initiative prise lors du Salon par des exposants, nous fut annoncée à sa clôture. Nous ne pouvions aller contre. Et nous rangeons, trions, archivons. Payons notre dû, remercions qui de droit. Et dépouillons sur les questionnaires soumis aux exposants, leur demandant « ce que vous faites là ? » Nous montrerons l’utilité du Salon, la nécessité des revues, l’intérêt général d’Ent’revues.
Nous voulons y croire et nous y préparons, poursuivant ce travail de fourmi. Dans les semaines qui viennent, des interventions à Nice, à Lyon, à Lille, deux rencontres prévues au Forum (Sociétés & représentations le 15 novembre, hommes & migrationsle 7 décembre. Et l’année prochaine, si tout va bien, nous reprendrons ces rencontres, en imaginerons d’autres, retournerons place Saint-Sulpice, organiserons le 34e Salon de la revue... Il nous faut avancer, avec et pour les revues.