Néhémy Pierre-Dahomey, RAPATRIES
Rapatriés désigne, métonymiquement, à la fois le quartier et ceux qui y résident. En donnant ce titre à son premier roman, Néhémy Pierre-Dahomey installe le lecteur dans ce lieu, symbolique de toutes les tentatives avortées pour gagner un ailleurs, qu'est un camp haïtien dédié à accueillir tous ceux qui, après avoir rêvé de partir, ont été contraints à un retour en arrière. L'héroïne de ce roman ne quittera pas son île et durant tout son parcours de vie tumultueux, elle sera aux prises avec un destin qui s'acharnera à la ramener toujours à son point de départ. Là où elle a toute sa vie, dans un mouvement concentrique fait de va-et-vient la retenant au cœur même de son île, Haïti
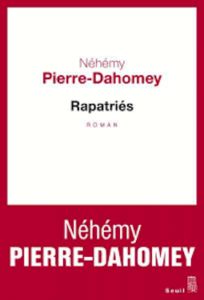
Néhémy Pierre-Dahomey, Rapatriés, Editions Seuil, 2017
tamponnée à la face du monde des années quatre-vingts comme le coin le plus pauvre, le plus crasseux et le plus misérable de l'Amérique entière.
Le roman s'ouvre sur une scène tragique qui nous ramène à notre terrible actualité où de nombreux migrants perdent leur vie en mer. Toutefois, il installe, dès l'incipit : « Belli marchait, vaillante et décidée, sur ce sentier aussi simple qu'un calvaire », la figure d'un personnage féminin fort et volontaire, celui d'une mère haïtienne qui part, non pour répondre à un désir d'ailleurs, mais par défi amoureux.
Belliqueuse Louissaint au nom et au caractère déterminés, personnage central du texte, a pris la mer sur le canot à voiles du capitaine Frère Fanon, « plus un petit caboteur qu'un grand capitaine des mers » qui « s 'était distingué en ayant touché plus d'une fois les terres de la Floride qu'il avait peuplées, en des temps moins difficiles, de quelques bonne dizaines de migrants ». Belliqueuse y perdra Nathan, contrainte lors du naufrage, à bout de forces, de lâcher son tout jeune corps dans les eaux turbulentes de la marée.
Son choix bien inconséquent toutefois et même irresponsable, révèle combien fragiles sont ces vies portées par la fatalité et le manque d'ancrage. Un personnage tout à la fois décidé et passionné mais perdu dans son désir de sortir de son destin, une femme qui aime et qui souffre. Des événements tragiques, résultat de choix hasardeux, la conduiront aux portes de la folie et de l'errance. Et cette errance sera à l'image de son seul désir, partir pour mieux rester auprès de celui qu'elle aime. Une tragédie universelle sans doute. Une tragédie comme il en existe ailleurs. Belli est une femme prête à tout, même à s'amputer d'une part d'elle-même, en renonçant à ses enfants, pour accéder à une vie nouvelle. Mais si le désespoir de Belli transpire dans son errance, sa nature impulsive l'aveugle. Belliqueuse porte bien son nom.
Partie suite à une ultime infidélité de l'homme qu'elle aime, Sobner Saint-Juste alias Nènè, elle reviendra « déterminée à aller mieux dans le meilleur des mondes avec l'homme de sa vie ». Cet homme qu'elle avait « l'habitude de maltraiter », jusqu'à le battre, « surtout quand il était saoul, en huit-clos ou en public », celui-là même qui lui mettra une raclée mémorable pour avoir commis cet « infanticide ». Pourtant, Belli « portait ce naufrage avorté dans le regard, en marchant comme elle seule sur la route étroite de Les-Miracles, quartier excentré de la cité ». Ce premier drame hélas sera suivi d'autres pertes, d'autres enfants que la mort ou le destin enlèvera à Belli. Il y aura Marline, une enfant de dix ans, fragile, tuberculeuse, puis ses deux autres petites, Belial et Luciole qu'elle choisira de « donner » à Pauline, une femme passionnément engagée dans la cause humanitaire qui « se disait révolutionnaire en son genre et travaillait à dégraisser ce système auquel elle avait accordé près de la moitié de son existence sur terre et toute sa vie professionnelle ». Combien d'enfants donnés à la mer ou à une autre mère ? C'est peut-être, en filigrane, une autre des intentions de ce livre qui pourtant ne s'étend pas sur des problématiques économiques ou sociales de l'île dont on sait qu'elle est soumise depuis longtemps à des conditions difficiles (climatiques, politiques, etc) mais qui montre combien le malheur peut marquer des êtres conduits par un destin implacable. C'est donc sans informer son infidèle mari (pour encore une fois se venger de lui) que Belli décidera de confier ses deux filles à l'adoption. Mais à quoi peut bien penser cette mère en avançant ainsi au devant de son destin de mater dolorosa ? On peut s'interroger sur le sens de la première épreuve qu'elle affronte comme une fatalité ; la perte de l'enfant de deux ans jeté à la mer, Nathan. Ce désespoir premier n'est-il pas fatalement annonciateur des autres catastrophes survenues ensuite ? Belli est-elle une mère indigne et abandonnique ou une femme soumise à son destin de femme insuffisamment portée, aimée, entourée ? Elle ira jusqu'à chercher quelque refuge ultime dans la foi et la dévotion chrétienne pour retrouver son mari parti, mais dans son échec à rejoindre sa fille par voie légale, elle perdra pied complètement. Quant à Belial qui n'est que beauté lumineuse, intelligence et douceur et que sa mère a oublié de nommer, elle s'auto-nommera de ce nom diabolique : « Cette petite s'est donné le nom du mal personnifié, l'autre nom du diable mentionné dans le manuscrit de la mer Morte de la grotte de Qumran. ». Bélial, par ce prénom « tragique » incarnera le mal dont sa mère souffre et par son propre exil pour la France, l'exil intérieur et carcéral de sa mère. Belial connaîtra cependant un destin moins douloureux peut-être, en partant, mais son histoire restera marquée par celle de sa mère. Luciole au nom magique partira quant à elle du côté des Etats-Unis sans qu'on puisse jamais savoir précisément où.
Ses dernières filles parties, son fils aîné tombé dans la déchéance, elle regarde son passé et son histoire personnelle trouée, son arbre généalogique difficile à reconstituer du fait des manques et des absences à soi, jusqu'à l'ultime catastrophe du 12 janvier, encore dans la mémoire de tous.

Pascale Monnin.
Elle n'en pouvait plus de ce monde où elle était retenue. Elle ne savait aucune magie qui ferait paraître devant elle, comme cela en urgence, la silhouette de ses enfants perdus. Elle s'en voulait à elle-même, à la scène originelle et floue de la perte de Nathan, à ce quartier qui n'était qu'un vaste inachèvement, un lieu raté, un acte manqué. Elle sentait le sang qui circulait chaud dans ses veines, des débuts de picotements, sa crampe au dos, et elle partait en délire contre son monde de sinistrés.
Porté par une écriture énergique, une narration très maîtrisée, des personnages dont on ne peut se séparer une fois le livre refermé, ce premier roman très prometteur peint la tragédie d'une mère, elle-même métaphore d'une île aux tourments incessants. A l'égal de ses aînés en littérature, Pierre Néhémy-Dahomey manie une langue riche de ses paradoxes comme ceux de son île, puissante, lumineuse, exubérante parfois, une écriture au rythme frénétique et enlevé.
Néhémy Pierre-Dahomey est né en 1986 à Port-au-Prince et vit depuis quelques années à Paris où il a poursuivi des études de philosophie. "Rapatriés" est son premier roman, Prix Révélation SGDL 2017.



