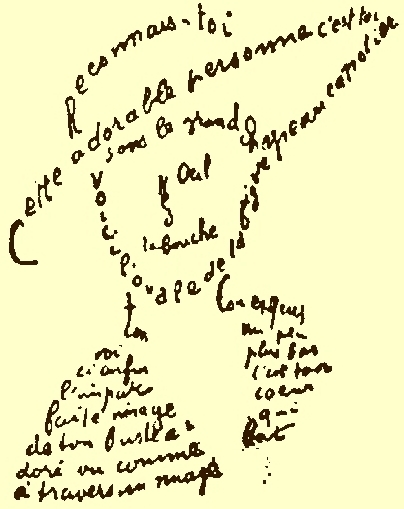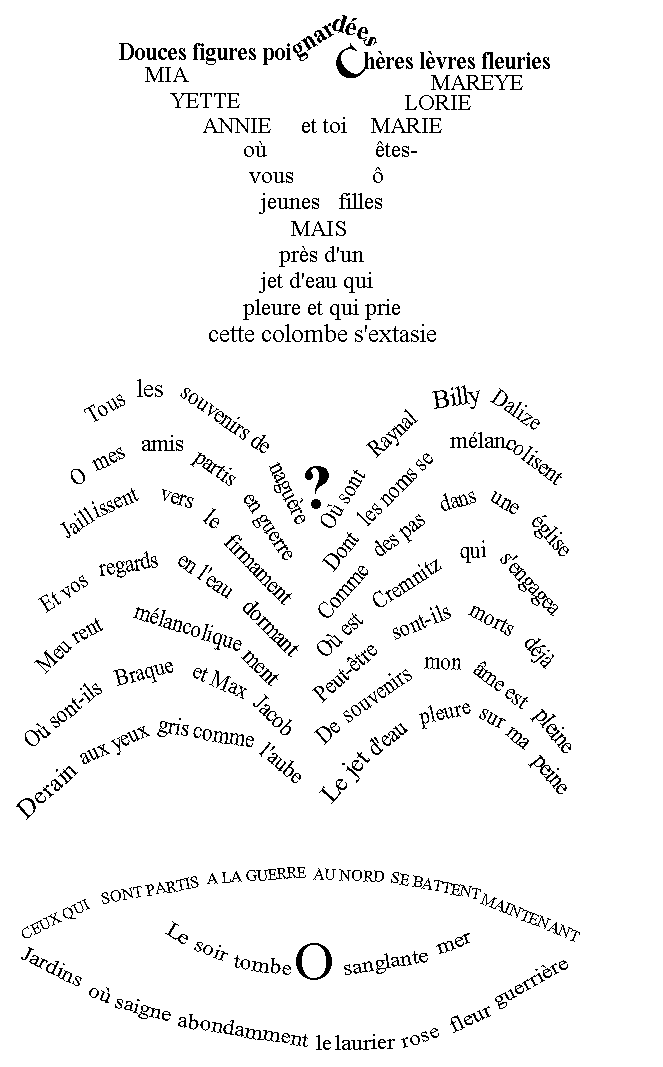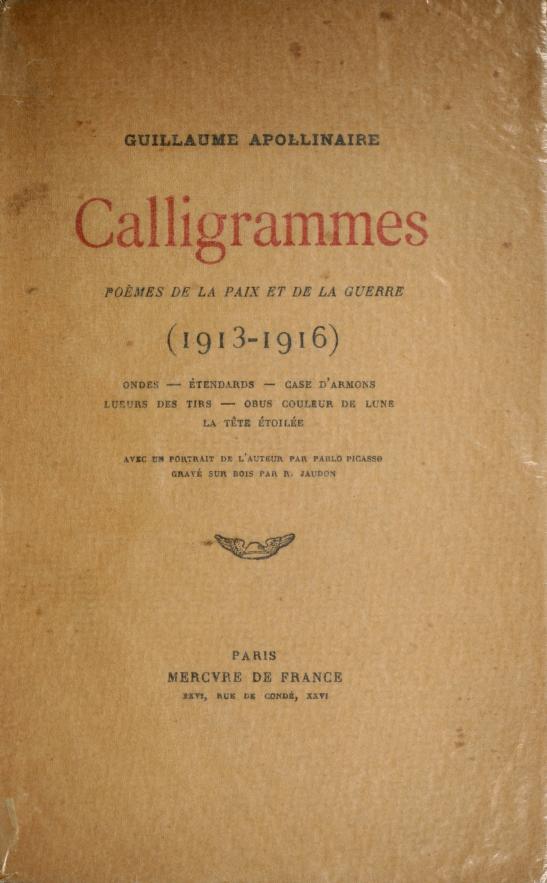Cathy Garcia, Graminées et autres poèmes
Graminées
Herbes sauvages
En longues pelouses
Échevelées
Tiges folles
Fruits secrets
Graminées
Striant le ciel
Cordes de violon
Détachées
S’en vont jouer
L’air du vent
Graminées
Partitions célestes
Quand je me roule
A vos pieds
Permettez que je vole
Un peu de vos parfums
Graminées
Qui font le pain
La galette
Le ventre plein
Depuis que les hommes
Vous ont cultivées
Graminées
Incendie de sève
Où je marche
Comme sur des braises
Dans le crépitement
Des sauterelles
Graminées
Innombrables
En fouets, en plumes
En aigrettes
Et même étoilées
La nuit vous respire
Et vous fait transpirer
Et galope entre vos jambes
La multitude des prés
Graminées
Je vous aime
Je vous le dis
Je vous aime
∗∗∗
Le Chant de la vieille
Corps tordu
Incendie
Calcinée
Je suis
Soumise
Tel fut mon satori
Ma beauté demeure
Hors de ta portée
Vie et mort
J’ai la connaissance
Des profondeurs
C’est pour cela
Que le serpent m’a aimée
Toutes les bêtes
M’ont apprivoisée
Pattes griffes
Plumes toisons
Je règne animale
Sur toute la création
Ma flèche touche au cœur
Tout prédateur nommé homme
J’ai initié bien des peuples
Qui m’ont nommé lunaire
De la génisse à la brebis
Pour m’asservir
Nombres de lois
Ont été dictées
Mais joug après joug
Je demeure l’Indomptée.
Je parle la langue des oiseaux
Qui lisent dans mon cœur
Les mauvais augures
Ne portent pas de plumes
Mais des bâtons cracheurs de feu
Des couteaux et des bombes
Au commencement des temps
J’étais déjà penchée
Sur le berceau de l’humanité
En moi était contenue
L’empreinte de toute forme
Et la mémoire des abysses
Ma puissance est immense
Je suis la porte des mondes
Je suis le cobra
Prends garde humain
Si tu ne respectes pas l’équilibre
Tu seras balayé pulvérisé
A genoux homme
Ferme les yeux
Ouvre ton cœur
Ton sexe est sacré
L’as-tu donc oublié ?
Allez viens danser avec moi
Sens-tu sous tes pieds
Le frisson des racines ?
Sens-tu le rythme du vent
Les tourbillons de la sève ?
Viens danser avec moi
Viens sentir l’étreinte
Et la lune dans nos veines
Je connais les partitions du frisson
Et les passes secrètes
Qui font du plaisir
Un art sacré
Je connais les paysages intérieurs
Des quêtes et des illuminations
Vers le nord hypothétique
Je vois au loin sur les plaines
La lente pérégrination des hommes
Pour se connaître
Il leur faut pénétrer la terre
Eriger des totems
Pour ensemencer les cieux
Mais ils se trompent
Et n’encensent
Que faux dieux.
Pour me connaître
Qu’ils suivent la piste
Féline.
Ils pourront me trouver aussi
Nue et lisse au creux des pierres
S’ils posent leur oreille
Contre les os de la terre
Ils entendront battre
Mon cœur
Je suis l’innocence faite chair
Mais ne te laisse pas bercer
Par la douceur de mes courbes
Une part de moi ne dort jamais
Sous le regard de l’Eveillée
Tu es nu comme un nouveau né
Mystère et magie
Art des saltimbanques
Depuis le début des temps
J’accompagne les nomades
Car mon nom est mouvement.
Je suis la première et la dernière
Sœur amante mère épouse
Je suis toutes en Une
Et Une en toutes
Je suis la Voie du cœur
La voix enchanteresse
J’ai pouvoir de vie et de mort
Tant de fois j’ai enfanté les ténèbres
Huilé la nuit de mon corps
Je suis le serpent primordial
Qui enlacera le monde.
Après tant de siècles à m’humilier
Comprendras-tu enfin ?
∗∗∗
Celle qui manque (extrait)
Si j’écris donc, je vais mot dire. Cris, clameurs, siècles, foules et le chuchotis d’une fleur.
C’est vrai, un rouge-gorge peut m’arracher des larmes. Une mésange au soleil. Du pain trempé, une flaque d’eau. Douce lumière du présent parfait. Le sourire intérieur s’épanche aux lèvres.
Partager ? Alors j’écris, je te parle, du fleuve, du cœur. Je te parle du labyrinthe et je crois savoir que tu m’attends là. Au centre, au cœur de la cible.
Noces dans un jardin adossé à la dormance. Érosion de l’épice. Mon nom tracé au parfum.
La conscience décousue rayonne. Une volupté violente gicle des fissures d’enfance.
Tout se fond, se confond, ombres dans la nuit. Périple vers la gorge douce et verte des grottes tapissées d’eau. Le château et la source, autobus de mes rêves, bouton à presser d’un blanc de lait.
Je cherche un lieu qui me cherche.
Aide-moi, ouvre-moi, sors-moi de ce trou où je suis tombée ! J’ai cru un instant, oui je t’ai cru. Je navigue seule pourtant. Je devine des sons, des mots, des odeurs, des sensations. Les vastes possibles…
Pourquoi cet entêtement ? Je me tords en point d’interrogation. Vertige de lettres. Je voudrais parfois être normale, c'est-à-dire comme tout le monde, mais comment font-ils ?
Dites-moi, comment font-ils pour avoir cet air-là ? Rien ne les étonne ? Tout est déjà pesé, soupesé. Rien qui n’ait son étiquette ?
Je les arrache celles qu’on m’a collées, je les déchiquette.
(…)
Il y a dix, vingt, trente ans et la vie passe. Inconsciente. Même nœuds, mêmes impasses. Nos grimaces et nos cris, étranges colifichets empruntés au théâtre d’ombres. Impasse des tourments, des rancœurs à déloger, des caillots de vanité.
Passez-moi la lame qui incise la matière du langage. Sève d’étoiles, draille des signes. Babel fond sous ma langue. J’en fixe simplement l’ombre sur le papier. Infini fugitif. Mes empreintes sur les neiges éternelles de l’inconnaissance.
Editions Asphodèle 2011