Étienne Orsini, DÉCHANTER, C’EST TOMBER D’UN REFRAIN EN MARCHE
Fin de miracle
Pourquoi les mots quand on les frotte
Ne font-ils plus de feu ?
Devra-t-on les jeter ces allumettes aux bouts noircis
Qui autrefois savaient édifier des brasiers ?
L’odeur du soufre s’est évanouie
Qui promettait la flamme
Fin de partie
La fin depuis longtemps
Avait été sifflée
Lorsque j'ai débuté
Comme être humain
Et aujourd'hui encore
Qu'une stridence me visite
En habits d'acouphène
Je la sais orpheline
Shibboleth
Interprété par un oiseau
Ce n’en était pas moins
Un authentique hennissement
Reconnaissable sans doute possible
À ses notes enchaînées
Gyere ki, te gyöngyvirág
Le monde s’écroulerait
-Et Dieu sait s’il s’écroule-
Une mélodie pourrait encore
Nous maintenir à flot
Un air venu de loin
Ou même de longtemps
Avec son roulement de larmes
Son muguet tout fané
Ses amours envolées
Une rengaine triste
Et si réconfortante
Prouvant par do plus la
Qu’il ya cent ou mille ans
Ces temps qui sont les nôtres
Avaient déjà pris fin
Semer l’ombre
Je m’éteins par hameaux successifs
Ajoutant à la nuit
En des endroits divers
Il n’est d’absence que je ne prêche
D’ombre que je ne sème
À me détacher des murets, des arbres et du ciel
J’ai pris le pli de disparaître
C’est une figure de danse
La seule
Qui me connaisse
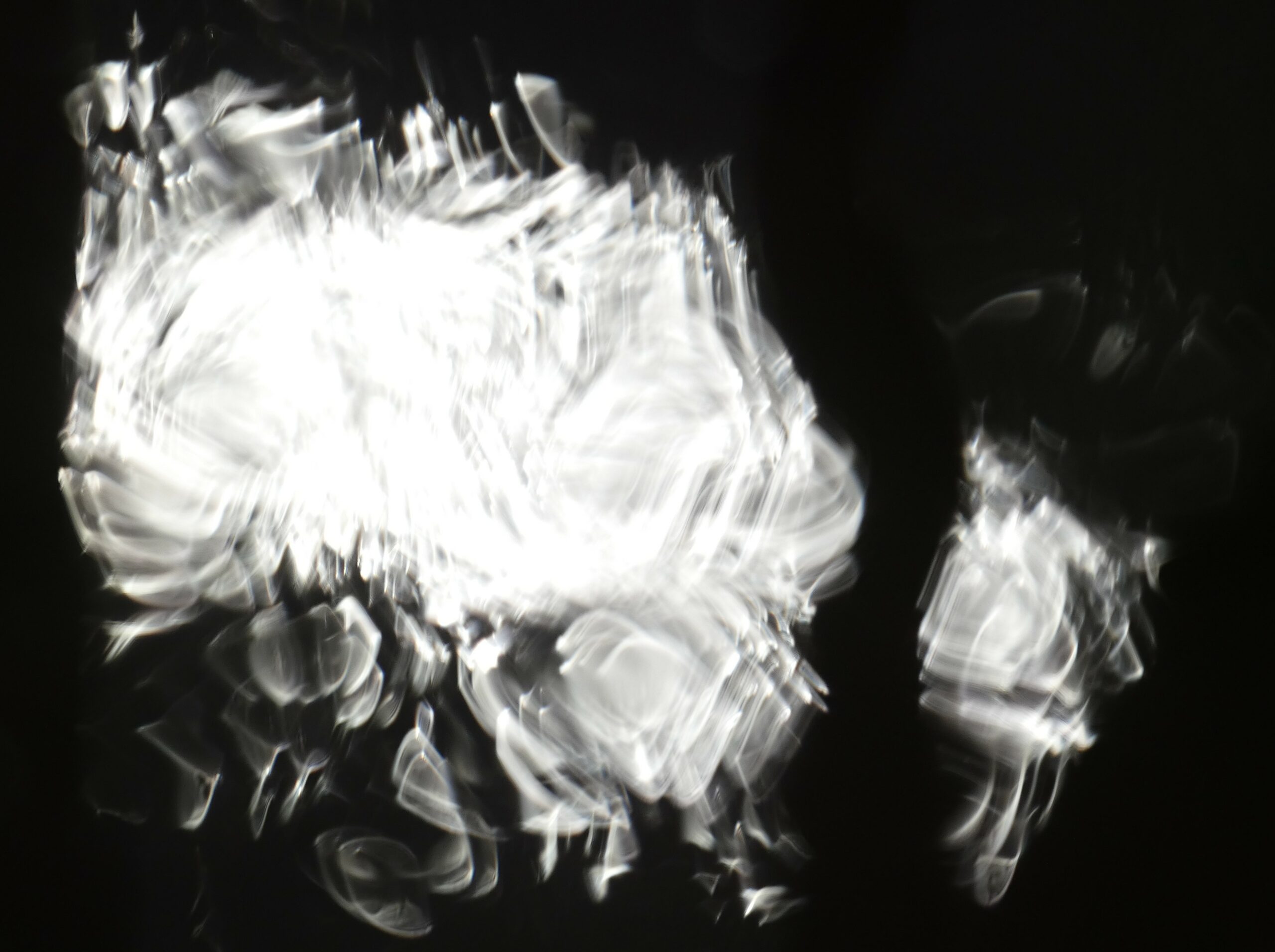
En toute confiance
On prête au taciturne
Toutes sortes de secrets
Sans confession, on lui donne
Le diable
Ou les diablotins
Comme un rêve de botox
Avec un visage à zéro
Sans traits
Sans rides
Sans expression
Ni guillemets autour des lèvres
Tu en ferais une belle page blanche
In fine
Quand nous irons vers le ciel bleu
Aurons-nous des ailes ?
Quand le delta nous happera
Serons-nous des fleuves ?
Ce que nous deviendrons
Le sais-tu, toi chemin
À nous attendre comme un chien
Tandis que nous rechaussons nos guêtres ?
Kantilène
Un poème est question d’acoustique
Si tu n’as pas la voûte étoilée
En toi
Tu ne l’entendras pas
Grande dépendance
Un bruit ne sait rien faire tout seul
De son propre chef
Il ne connaît pas
Retentir lui demande du renfort
Et tout un équipage
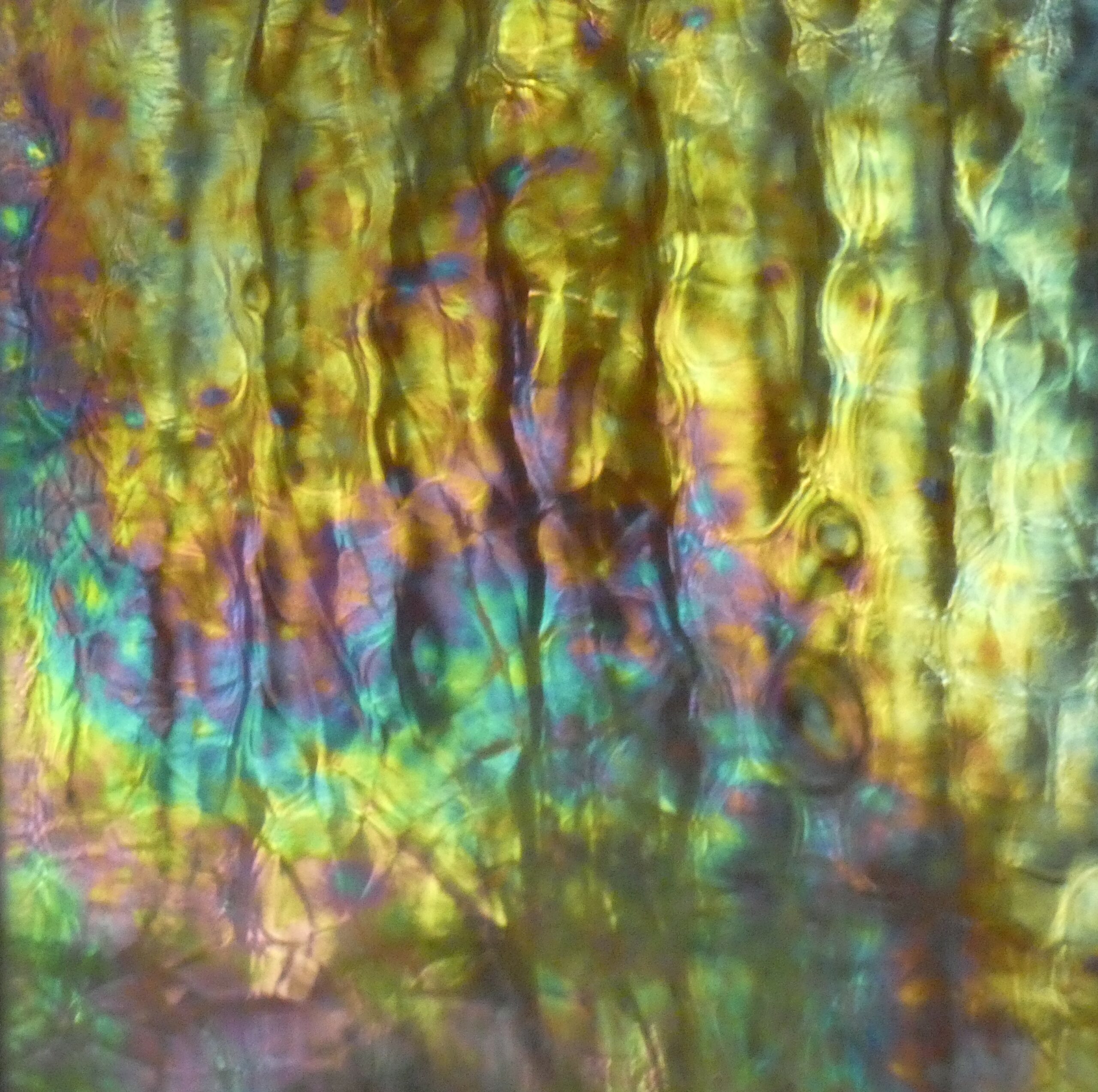
À même le jour
Je n’avais pas encore revêtu les contours
Qui séparent du monde
Ni endossé ces forteresses
Qui font de la vie un combat
Je me tenais dans le matin
À même le jour
Affranchi de mon corps
De mes humeurs
Et de l’histoire anecdotique des hommes
Autour de moi
Tant de noms voletaient
Bien assez tôt
Ils se poseraient
Sur les monts
Sur les sommets
Sur la vallée et sa rivière
Sur ce qui fut créé
Ou spontanément généré
De tout le plomb de leurs syllabes
Ils s’en iraient lester
Ce qui serait doté d’ailes
Ou élytres élan désir
Et générosité
Du poids de leurs diphtongues
Ils viendraient réprimer
La moindre tentative d’envol
Il serait peut-être encore temps
De souffler
De se faire pétale en surnombre
Sur la rose des vents
Pour repousser à pleins poumons
Les phonèmes invasifs
À moins de laisser une mémoire défaillante
Éroder la toponymie
L’onomastique
Estropier les savoirs
Ou flouter la chronologie
Un matin passerait
La ballustrade rouillée ferait
Une assez pâle figuration
Un coq chanterait
Depuis que l’angelus
A cessé de sonner
C’est à lui qu’il revient
De proclamer midi
L’heure de Damoclès
In excelsis
Au jardin, si la rose
Lance un pétale à ton passage
Estime-toi glorieux
À la dérive
Nous avons quitté le temps ferme
Pour dériver vers des peut-être
L’Histoire que nous étions
S’est disloquée à notre insu
Hier craquelle à nos tympans
Et nous ne savons plus l’entendre
Il faudrait éviter de trop mourir
Par les temps qui courent
Épilogue
Notre vie d’après
C’est en filgrane
Que nous la vivrons
Dans vos pensées de papier-bible
À la merci d’un froissement
Furieux ou
D’un départ de feu
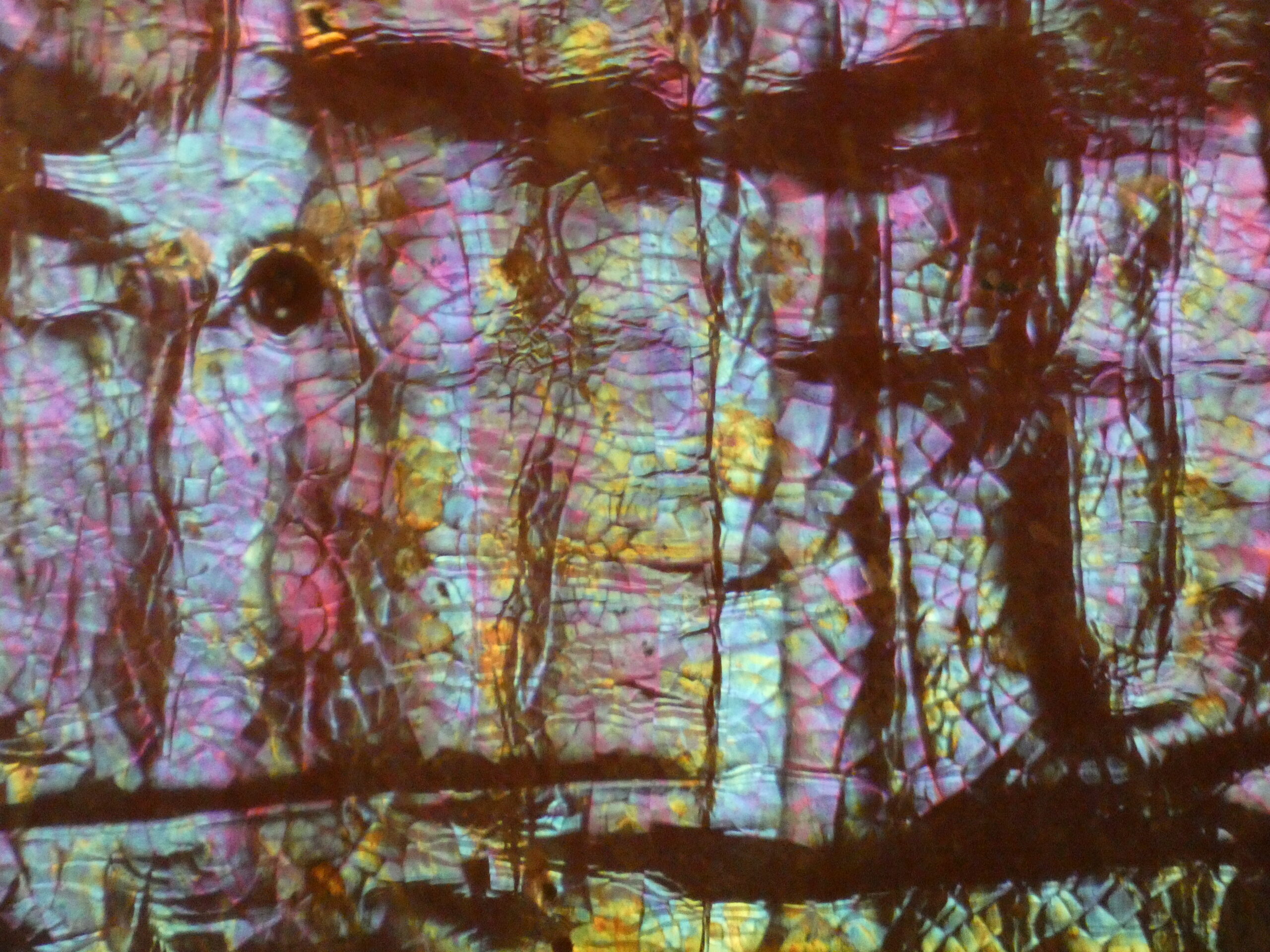
SON DIEU ETAIT VITRIER
Textes inédits d’Etienne Orsini
Son Dieu était vitrier. Ou savant Cosinus. Ou titulaire d’un œil de verre.
Le premier jour, il avait créé la lumière, le deuxième, l’éclat et le troisième, la transparence.
Comme il trouvait que cela était beau, il avait aussi créé l’homme afin qu’il puisse participer à ce spectacle, en tant que spectateur, reflet ou souffleur de serres.
Lui-même n’avait pas son pareil pour escalader du regard les plus hauts gratte-ciel, en quête de miroitements, de clins d’astres fabuleux, de pépites solaires. Il faisait les carreaux à l’aide de puissantes jumelles, les nettoyait de toute opacité. Il manipulait parfois les lamelles d’un ancien microscope à la recherche d’une lumière vieille d’au moins cent-cinquante ans. Peu lui importaient les vestiges de l’élevage de vers à soie, le naufrage de la vie minuscule et fragile ; seule comptait la lueur qu’il voulait coûte que coûte plutôt pâle, plutôt vive.
Quand il avait plu, il sortait de chez lui, à la vitesse des champignons. Il aurait pu manquer la flaque et sa lumineuse homélie.
Enfant, déjà, à l’aquarium, il n’avait pas vu les poissons, goupils ou raies mantas et les requins-marteaux lui avaient échappé. Une drôle d’irisation au bord biseauté d’une paroi l’avait retenu tout ce temps et il s’en souviendrait des décennies plus tard.
Depuis qu’il avait découvert les serres, il s’y rendait le plus souvent. À peine en avait-il franchi la grille, qu’il se sentait chez lui. Il ne rentrait pas de sitôt dans la cathédrale de verre mais l’entourait de trajectoires compliquées qui ressemblaient à des étreintes.
Sur les parois, tout faisait tache de couleurs. L’hibiscus tachait, le visiteur tachait, l’oiseau de paradis tachait et l’extincteur réglementaire.
Il jardinait avec les yeux. Sarclait et binait sans relâche pour voir jaillir de nouvelles fleurs qui n’en étaient que l’ombre.
Quand l’ayant contourné tant et plus, il pénétrait enfin au sein du Palmarium, on aurait juré qu’il s’était signé.
Son Dieu était vitrier. Venait-il de s’en souvenir ?
Aquariophile, son Dieu nous aurait observés depuis quelque point P inconnu de nous seuls.
Avec passion, tendresse et vigilance, il aurait assisté à nos évolutions parmi les eaux-fantômes d’un océan en ruine.
Rien de notre ballet ne lui aurait échappé. Il aurait perçu sans faillir sous le plus infime de nos gestes un battement de nageoire. Sous chaque frasque, une virevolte.
Aquariophile, son Dieu nous aurait restitués à notre préhistoire.
Son Dieu nous aurait esquissés.
Tracés non pas créés.
Sur un tesson de pluie.
Avec toute la minutie d’un maître-verrier
Et la désinvolture d’un soudard
D’un trait d’esprit
Il nous aurait émis
Comme autant d’hypothèses
De plus en plus
Invérifiables
Son Dieu pratiquait la lecture rapide.
S’il nous lisait, c’était toujours à la vitesse de la lumière.
Et s’il nous feuilletait, il mettait nos yeux hors d’haleine.
Au bruissement de nos corps, on sentait sa présence,
ses pupilles érudites et ses mains palpitantes.
Avec la fougue d’un autodidacte,
sans mesure ni méthode,
son Dieu pratiquait la lecture rapide.
Son Dieu avait l’oüie cristalline, de celles qui vous métamorphosent les noirs torrents d’insultes en cascades de louanges.
Muni naturellement d’un tel appareil auditif, comment aurait-il entendu nos péchés, nos turpitudes, nos peines et nos supplications ?
Il faut imaginer son Dieu en parfait mélomane changeant nos croassements sans même s’en rendre compte en joyaux mélodiques.
Amateur éclairé de la musique des sphères, son Dieu avait l’oüie cristalline.
Une libellule prouvait son Dieu mieux que Thomas d’Aquin.
Syllogisme parfait au bleu irréfragable.
Indice pur et concordant.
Dès lors qu’elle enseignait au peuple des roseaux
CQFD de vie sur le tableau d’azur,
une libellule prouvait son Dieu mieux que
Thomas d’Aquin.
Son Dieu entrouvrait des clairières dans la forêt des cœurs.
Tachetant d’espérance le marasme vert sombre,
il suffisait qu’il passe pour dissiper les ombres.
Élagueur accompli de nos mélancolies,
son Dieu entrouvrait
des clairières
dans la forêt des cœurs.
Son Dieu taillait tantôt des diamants à Anvers, tantôt, dans l’Univers, sculptait des firmaments.
L’instant d’un œil, il polissait des mondes. Pour rien, pour la beauté ou pour passer comme on tricote, toute l’éternité.
Quand son Dieu dirigeait une chorale de lucioles, les étoiles affluaient de galaxies lointaines.
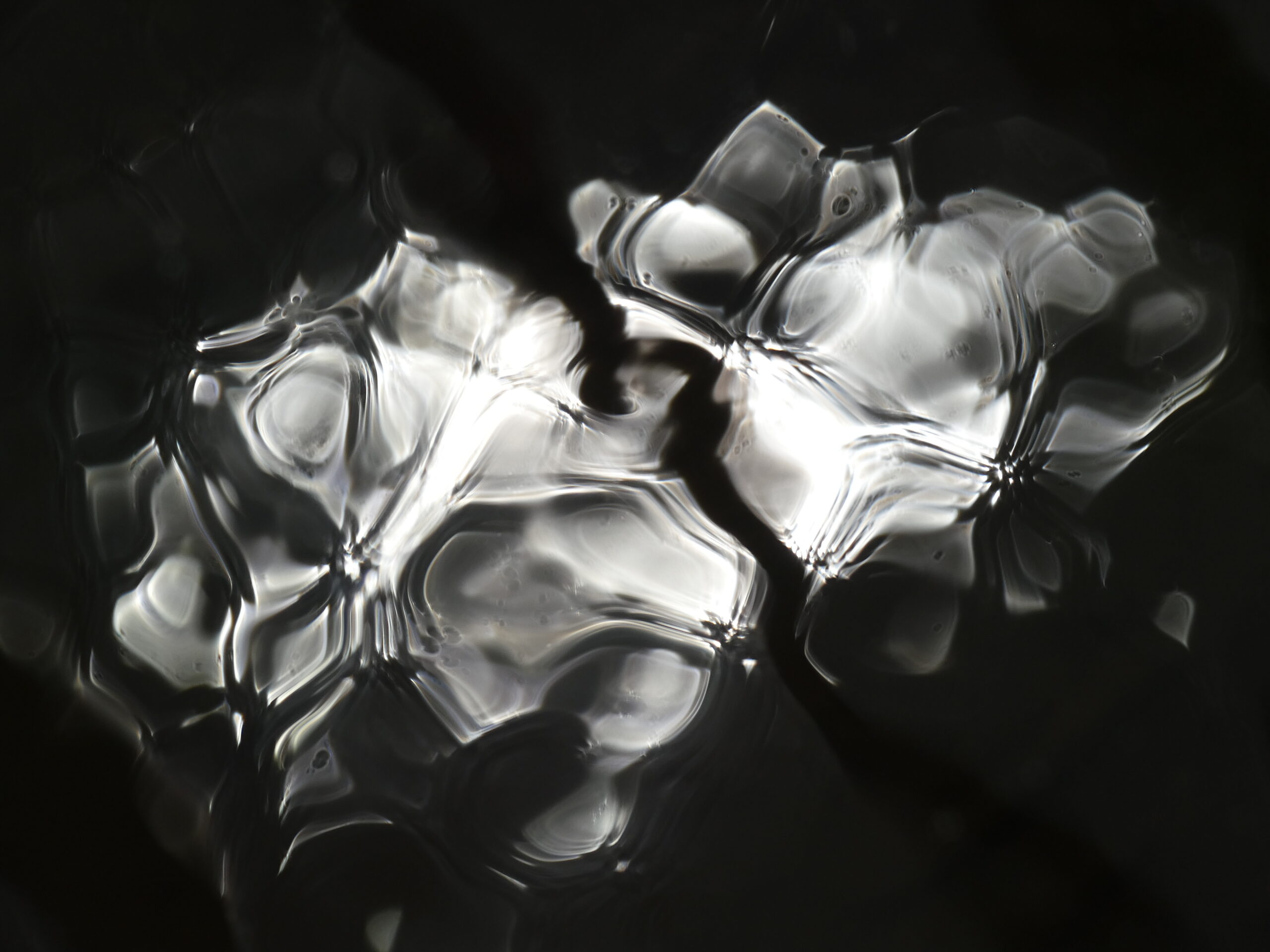
Photos © Etienne Orsini
