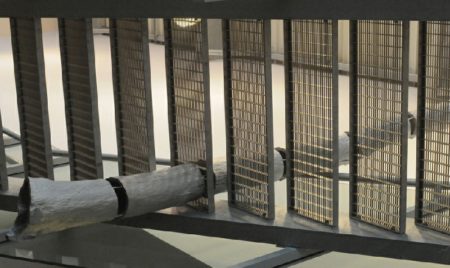Lee Sumyeong : poèmes présentés et traduits par Marie-Christine Masset
Escaliers froissés
Je grimpe les escaliers,
escaliers froissés
À chaque marche,
les menaces disparaissent.
Deux personnes se battent
elles jettent les escaliers ;
tout le monde se bat.
Une personne coupe le bras d’une autre personne
et le jette au loin.
Le bras jeté au loin
revient
et grimpe les escaliers.
Je fais des roulés-boulés et
bascule vers moi, fréquemment.
Je grimpe les escaliers
mais les escaliers sont invisibles.
Je m’assois sur l’échafaud
mais je suis déjà décapitée.
La danse des dents
À chaque fois qu’il rentrait à la maison, ses dents tombaient. Il mettait ces dents tombées dans un verre dans la salle-de-bain, regardait dans le verre et souriait avec sa bouche édentée. Au matin, il les remettait une à une dans sa bouche et sortait.
Une nuit, alors qu’il était rentré épuisé chez lui, il s’est réveillé en entendant un bruit étrange provenant de la salle-de-bain. Il s’est levé pour voir et s’est aperçu que les dents étaient sorties du verre et qu’elles dansaient, cliquetant en se percutant. « Cela a l’air marrant. Prenez-moi avec vous, » a-t-il dit et une dent a répondu, « rejoins-nous. » Il a commencé à danser. Alors toutes les dents sont retournées dans le verre.
Il s’est affairé à vendre tout le fatras que contenait son sac. Il a toujours travaillé dur mais peu de personnes achetaient ses trucs, aussi son sac était-il lourd matin comme soir.
Quand il est mort, son sac, et tout ce qui était à l’intérieur, ont été éparpillés ici et là, mais les dents qui étaient dans la salle-de-bain ont été enterrées avec lui. Chaque nuit, il danserait avec elles.
La Pluie Gauchère Tombe, La Pluie Droitière ne Tombe pas
Quand je marche avec toi main dans la main
la pluie gauchère tombe, la pluie droitière ne tombe pas.
Pour nous, il y a toujours trop de mains
et je me souviens de ce moment quand mes mains se sont divisées en deux.
Ce moment où des ciseaux transparents sont descendus.
Réveillant les pas —
Il y a-t-il quelque chose dans les pas ?
Ils sont faits de quoi ?
Pour nous, il y a toujours trop de pluie
la pluie gauchère tombe, la pluie droitière ne tombe pas.
Quand je marche avec toi main dans la main
nos corps nous abandonnent.
Nos corps nous regardent d’en bas.
Nos boutons tombés, errant ça et là,
les nombreuses boutonnières,
En elles
la pluie gauchère tombe, la pluie droitière ne tombe pas.
Quelque chose que la fenêtre réfléchit
Je regarde la fenêtre. Quelque chose réfléchi dans la fenêtre.
Est-ce la pensée de quelqu’un, et je ne sais pas ce que c’est. Je suis détenue dans la
pensée de quelqu’un.
Si je suis la pensée de quelqu’un, je matérialise la pensée de quelqu’un. Je ne peux pas l’ouvrir et
m’échapper.
Pendant un moment, je
perce le rêve de quelqu’un et entre en lui.
Je l’arrête.
Le rideau s’envole. Je suis étonnée d’être aussi près. J’essaye de faire tournoyer sa pensée
mais au même instant je l’enferme. Un à un, mes gestes.
Quelque chose se reflète dans la fenêtre.
Maintenant la pensée de quelqu’un est déchirée.
Un entrepôt
On s’est rencontrés dans un entrepôt.
Habillés comme ceux qui y travaillent
on a utilisé tout notre souffle
parlant lentement, des mots purs.
Les produits étaient très connus.
Les ventes augmentaient continuellement.
Pour vérifier quels produits étaient dans l’entrepôt,
on allait d’un bout à l’autre,
puis on partait dans une autre direction
et on revenait. On n’arrêtait pas de retourner
à des endroits où on était déjà allés.
On n’avait pas l’intention de prendre quoi que ce soit.
On allait et venait comme des personnes responsables.
Un stylo à bille et un téléphone portable dans la poche de nos pantalons,
et parfois on se tenait dans un coin pour répondre au téléphone,
ces fois-là on avait l’impression de ne pas pouvoir bouger d’un pouce.
De différentes manières, la répartition des produits était fantastique
il y avait plein de sortes de produits et ils étaient tous mis ensemble
et quand nous ne savions pas comment trouver les produits,
notre progression, en touchant les produits au hasard, était fantastique,
tout le monde dans l’entrepôt avait l’air fantastique.
Mais avant de quitter l’entrepôt, soudain
quelqu’un se met à pleurer sans raison.
Quelqu’un se met à vomir.
Quelqu’un se met à les tapoter dans le dos.
Quelqu’un se met à rejoindre l’endroit,
et d’autres se mettent à faire pareil.
Il vous est demandé de parler à l’extérieur du bâtiment.
Il y avait un signe, « Silence »,
mais depuis un certain temps on papotait,
faisant du bruit d’un coin à l’autre.
Se souvenant du « Silence » avant de quitter le bâtiment
quelqu’un se met à fermer sa bouche.
Quelqu’un se met à faire pareil.
Petit à petit le silence règne,
il devient encore plus silencieux
jusqu’à ce qu’enfin à un moment donné nous nous taisions tous à merveille.