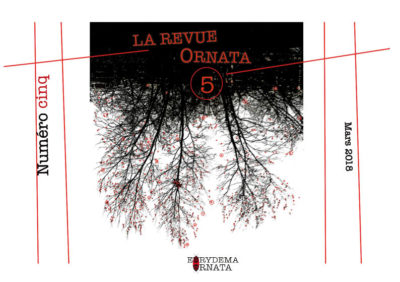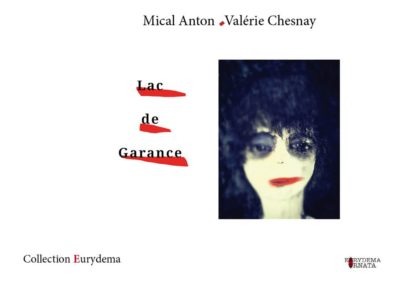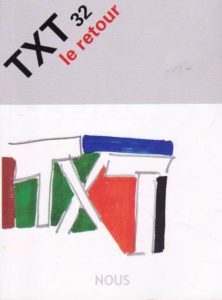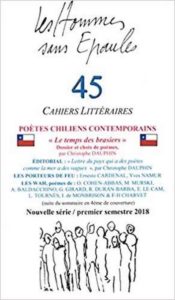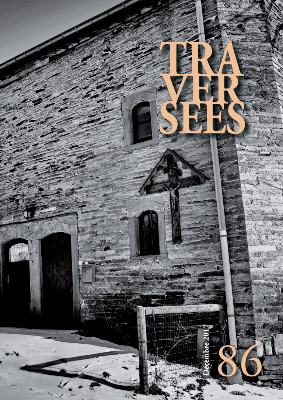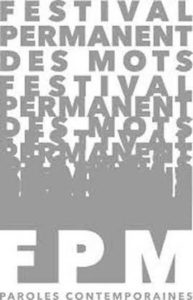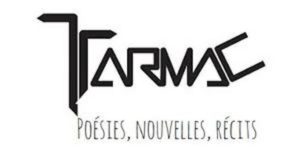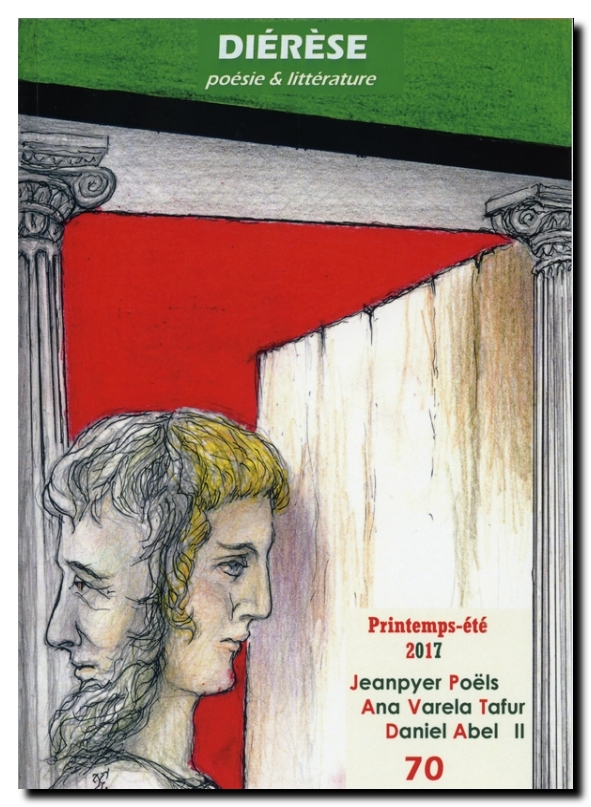Legs et littérature n°8
Legs et littérature n°8
Revue haïtienne
Spécial Marie Vieux-Chauvet
Ce numéro 8 de Legs et Littérature entièrement consacré à l'oeuvre de Marie Vieux-Chauvet, regroupe dans la première partie, huit articles autour de ses principaux romans, révélateurs de son engagement et quelques réflexions sur les personnages féminins importants ; une partie est consacrée à deux portraits de l'écrivaine ; une autre présente chacun de ses romans ; dans la partie « création » de la revue, chacun des auteurs présentés rend hommage à l'écrivaine, et enfin des repères bibliographiques sont donnés en toute fin.
Est-ce un hasard si un jour, Legs et Littérature m'a demandé une première contribution à leur toute jeune revue (née en 2013) ? Mon attachement pour la littérature des Caraïbes était déjà ancien, et celui pour Haïti m'était venu à ma découverte de l'oeuvre de Frankétienne pour laquelle je me suis vite passionnée. Grâce à un ami haïtien, j'ai pu lire ensuite René Depestre, Lyonel Trouillot, Dany Laferrière, Marie-Célie Agnant, puis Stephen Alexis, Yanik Lahens, et dernièrement Mackenzy Orcel et James Noël.
Frappée par la luxuriance de cette langue colorée et si vivante, qui savait apporter des images fortes et réinventer une langue, c'est sans aucun doute Marie Vieux-Chauvet qui me l'a rendue encore plus proche.

Legs et littérature n°8, Revue haïtienne, Spécial Marie Vieux-Chauvet.
Et j'ai donc proposé ma lecture du chef-d'oeuvre, Amour Colère et Folie, son oeuvre la plus lue et la plus contestée aussi, pour ma deuxième contribution à Legs et Littérature. Parce qu'elle portait une dimension féminine de révolte et d'engagement, sensible à la condition humaine des plus pauvres et aux drames sociaux, non, ce n'était pas un hasard ; toute ma réflexion et mon intérêt pour la littérature tourne depuis toujours autour de cette thématique entre Parole et Silence et ce, dès mes premiers travaux à l'Université, notamment sur Camus et ensuite dans mes propres écrits.
Comme le rappelle Carolyn Shread, dans son éditorial à ce numéro spécial consacré à Marie Vieux-Chauvet, ma réflexion lors de ma contribution à ce numéro (dans mon article Engagement et résistance dans Amour Colère Folie) s'est en effet concentrée autour de la parole de Marie Vieux-Chauvet, celle qu'elle a osé prendre par l'écriture de fiction pour dénoncer la violence de la dictature de son pays. J'ai voulu souligner le courage et l'audace dont relève son écriture tourbillonnante, un courage et une audace qui pourtant lui ont valu bien des ennuis et querelles familiales et sociales.
Cette parole qu'il fallait oser prendre, pour dénoncer, a son corollaire, le silence et Carolyn Schread le souligne dans son éditorial. Un silence dans lequel la plupart plongeait pour se cacher et d'autres pour mieux réfléchir. Un silence qui est fait d'abord de la terreur portée par la tyrannie de la dictature mais un silence nécessaire parfois pour demeurer serein au milieu des tempêtes. C'est de ce silence à soi (comme on a une chambre à soi...) pour contrer la violence et la peur, auquel Carolyn Schread fait référence à propos de Marie Vieux-Chauvet, non que la peur ne l'ait jamais atteinte bien sûr mais le besoin de dire était bien plus fort.
- Le premier article s'appuie sur la Correspondance entretenue entre Marie Vieux-Chauvet et Simone de Beauvoir. Son auteur, Kaïama L. Glover voit en l'écrivaine une théoricienne sociale, orientée vers « une critique féministe des sphères privées et intimes » que la publication de Amour Colère et Folie, grâce à Simone de Beauvoir fera entrer Marie Vieux-Chauvet chez Gallimard en France. C'est en effet une femme courageuse qui devait faire face à la domination masculine (son mari y compris) et celle d'un pays aux prises d'un dictateur et « en tant que bourgeoise, mulâtresse, femme et écrivain, Marie Vieux-Chauvet se situait dans l'oeil du cyclone sociopolitique qu'était l'Haïti de Duvalier, écrit Kaïama L. Glover.

Son livre devait se vendre et être lu, c'est ce qu'elle souhaitait plus que tout au monde même s'il était cause du malheur qui l'entourait et l'a conduite à l'exil. Elle dut se résigner à écouter son mari et récupérer le stock, le détruire après que plusieurs membres de sa famille ait été assassinés.
L'oeuvre de Marie Vieux-Chauvet est une critique radicale de la société haïtienne et cette critique socialeest au fondement de l'ensemble de son oeuvre romanesque
« Claire, entre conformisme et révolte », article de Ulysse Mentor, propose une lecture de la trilogie Amour Colère et Folie,orientée vers un des personnages principaux « silencieux » et complexe, celui de Claire, héroïne du premier récit Amour.Ce personnage mutique dont la révolte contenue explosera dans l'acte meurtrier en toute fin, est une femme dont la colère est également la résultante de passions intérieures puissantes, révolte contre l'autorité parentale, amour incestueux et inavoué qu'elle éprouve pour son beau-frère, désirs puissants d'exister et qui voient triompher dans le dénouement la dimension politique du récit.
L'article intitulé « Les Rapaces : un choc salutaire pour les consciences » de Marc Exavier propose une réflexion sur le roman Les Rapaces paru en 1986, ouvrage posthume qui revient sur les monstruosités du régime Duvalier. On y voit toujours ce combat de Marie Vieux-Chauvet pour dénoncer l'injustice et la misère sociale dans un désir profond de réveiller les consciences.
Les Rapaces dénoncent ces chefs qui ont tous les droits et laissent mourir de faim les enfants. Roman saturé d'horreurs mais dans une écriture toujours juste.
- Dans l'article de Max Dominique, il est question de trois héroïnes Lotus (dansFilles d'Haïti), Rose (dans Colère) Claire (dans Amour) mais aussi de Marie-Ange (dans Fond des nègres) et Minette (dansLa Danse sur le volcan).
Il y est rappelé en particulier combien l'écriture romanesque de Marie Vieux-Chauvet a pu scandaliser et « dissipe l'aura d'espérance et d'utopie que soulevait par exemple le lyrisme de Roumain ou l'imaginaire follement optimiste et baroque d'Alexis ». C'est que c'est une écriture qui oppose une volonté de résistance et de lutte dans l'espace privé et social des personnages.
- Yves Mozart Réméus s'intéresse dans son article La danse sur le volcan : entre histoire, fiction et féminismeà la manière particulière dont Marie Vieux-Chauvet a choisi de réécrire le récit de vie d'une actrice haïtienne (Minette) et la dimension idéologique de ce choix de l'auteur dans le contexte de l'histoire d'Haïti, au XVIIIe siècle à St Domingue sous la domination colonialiste, Minette incarnant alors un personnage « à la frontière de la scène et de la résistance ».
la comédienne fictive, à la différence du personnage historique, est consciente qu'elle peut se servir de l'art comme d'une arme », ainsi si la véritable Minette pouvait refuser de jouer des pièces locales en créole et préférait le Français, de « bon ton » (selon le récit historique qu'en a donné Fouchard), la Minette de Marie Vieux-Chauvet « fonde sa position sur son respect de la dignité des Noirs.
La distance que prend l'auteur dans son roman vis-à-vis des récits historiques se traduit par une image plus positive de la femme et des métis.
Elle permet aussi de donner à ce personnage réel, un nouveau destin, celui d'une femme bien plus libre encore qu'elle ne l'était, d'une liberté qui aurait atteint à l'universalité, à quelque chose de plus grand qu'elle.
-Jean James Estepha dans son article intitulé La maison : lieu de refuge et de combat dans l'oeuvre de Marie Vieux-Chauvet s'intéresse aux lieux et propose une grille de lecture de ce lieu qu'est la maison, point de départ dansAmour, Folie etLes Rapaces, de toute révolte, à la fois lieu de refuge pour se cacher et se libérer et lieu de combat et de résistance. « Comment une maison peut être non seulement le lieu où l'on construit une œuvre mais aussi le lieu où l'on peut détruire une autre ».
- « Violence, refoulement et désir dans Amour et Colère »titre l'article de Dieulermesson Petit Frère, lequel analyse la psychologie des personnages féminins pris en étau entre une éducation rigide et féroce et des désirs de liberté légitimes en regard de leur histoire sociale. La violence tant sexuelle que physique sourd de ces pages lumineuses, contenue et étranglée qu'elle est par la force de ces désirs de liberté et de vengeance. Elle naît de l'humiliation et de la frustration (amoureuse par ex pour Claire dans l'amour qu'elle a son beau-frère, dans Amour). Ainsi comme le fait remarquer l'auteur de l'article, la violence n'existe pas seulement dans le camp des bourreaux et elle accompagne la révolte. Dieulermesson Petit Frère souligne ici la violence qui traverse l'écriture de Marie Vieux-Chauvet pour exprimer la défaillance de la justice et ces sentiments de vengeance qui sourdent d'un passé lointain.
Les deux portraits sont rapportés par Dieulermesson Petit Frère dans « Chronique d'une révoltée », « auteur qui dérange et parfait symbole de l'écriture du roman moderne haïtien » et une rencontre entre Marie Alice Théard et Jean Daniel Heurtelou, neveu de Marie Vieux-Chauvet.
Dans la partie création :
-Le récit tendre de Serghe Kéclard : un amoureux des livres nous raconte son rêve de rencontre avec l'auteur et sa passion amoureuse pour l'oeuvre et la personne de Marie Vieux-Chauvet,
-Un poème de Iména Jeudi (auteur publié aux Editions Temps des cerises) : « Vivre est en moi frôlement de vertige cohorte de soupirs qui font signe d'avancer dans l'acte net des ombres arrêtées en flagrance de lits d'orgasmes en délits d'infinies défaites » (extrait deFaillir propre),
-un billet à Marie Vieux-Chauvet signé Marie Alice Théard, une lettre à Marie, signée Mirline Pierre.
L'année 2016 a mis à l'honneur Marie Vieux-Chauvet, pour le centenaire de sa naissance, lors de la vingt-deuxième édition du festival « Livres en folie », l'événement culturel le plus important en Haïti, après de longues années de silence après sa mort.