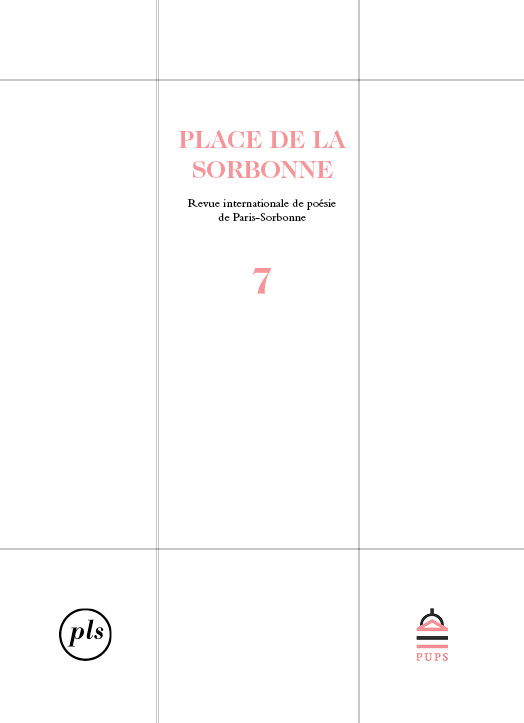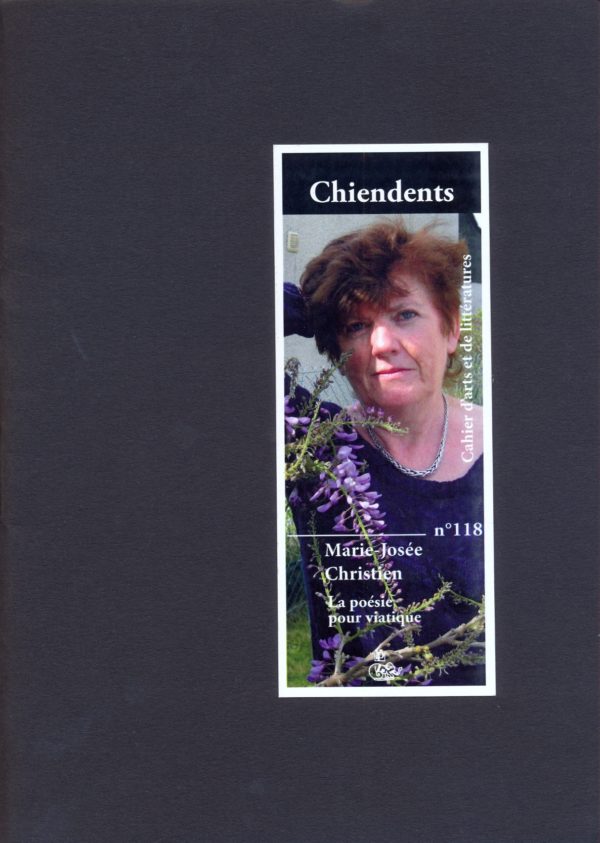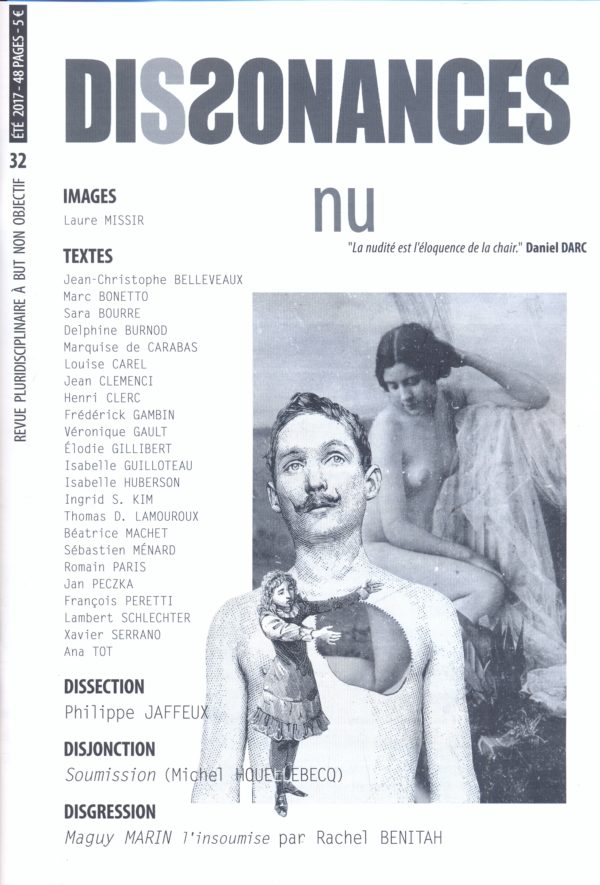Place de la Sorbonne n° 7
Qu’ajouter après l’éditorial de Laurent Fourcaut qui ouvre cette livraison annuelle forte de plus de 400 pages ? Tout y est dit, ne reste plus qu’à lire attentivement ce n° 7 de Place de la Sorbonne.
La première partie est consacrée à Olivier Barbarant, spécialiste d’Aragon mais aussi poète : étude sur la poésie et poèmes inédits. Une étude qui s’attache à montrer comment le quotidien (le réel) peut être à l’origine du poème, quotidien qui ne se confond pas avec la contingence dit Barbarant :
La fêlure, la fragilité, la douleur du deuil personnel, y empêch(ai)ent toute mise au pas de la voix » (p 17)
Il était bon que ces choses-là fussent dites. Les poèmes se veulent illustrations de ce que recèle l’étude (à moins que ce ne soit l’inverse). Suit un entretien avec Djamel Meskache des éditions Tarabuste réalisé par Laurent Fourcaut pour PLS. De cet entretien, il faut retenir ce que dit Meskache : à propos de la diffusion et de la distribution des livres qu’il édite, il répond, à la question posée sur la portion congrue des étals de poésie et de la faiblesse en mètres linéaires des rayonnages de cette même poésie chez les libraires : « Admettons qu’ils ne soient pas nombreux : cela ne dit rien de l’état de la poésie en France. Tout au plus, ça décrit l’état de renoncement dans lequel la médiocrité ambiante tente, sans toutefois y parvenir complètement, de plonger une part de plus en plus importante de nos concitoyens » (p 32). Dont acte.
La deuxième partie de la livraison annuelle est consacrée à la poésie contemporaine de langue française : une anthologie de 15 poètes (sur 107 pages) suivie d’une série de notices consacrées à ces poètes qui court sur une trentaine de pages. Il faut noter la diversité des poètes présentés, PLS n’appartient pas à une école littéraire ! J’ai découvert Julien Blaine par sa revue Doc(k)s, il y a déjà de longues années ; je le retrouve ici égal à lui-même, iconoclaste d’une certaine poésie. Je retrouve un Blaine paradoxal qui donne à imprimer ses poèmes alors qu’il est hostile au livre. Comment aborder les poèmes ici reproduits ? Comme la volonté de détruire la poésie du passé, comme l’œil qui voit et qui note ? J’ai bien aimé les poèmes de Murièle Camac pour leur atmosphère ; parmi les poètes connus (de moi), j’ai apprécié Francis Combes pour son usage du réel, sa façon de coller à ce réel. Les routes de mica d’André Ughetto me plaisent pour leur lyrisme et leur côté expérience… Jean Renaud et ses compressions de textes m’ont intéressé car la poésie est expérimentation : et là, je ne suis pas déçu de cette importation d’une technique de la sculpture. GB (Gérard Berthomieu ?) explique longuement dans sa notice ce que voudrait Jean Renaud : essai ou notice ? Cette mini-anthologie permet au lecteur de trouver son dû ; elle rappelle que la poésie est condamnée à innover sinon elle se cantonne dans la répétition des formes du passé. Les notices rappellent le rôle indispensable des revues comme banc d’essai de l’écriture poétique… Cependant le signataire ces lignes se pose une question : aimerait-il moins la poésie que dans sa jeunesse ? S’intéresserait-il moins aux nouvelles écritures poétiques que dans sa jeunesse ? Il est vrai qu’il en a vu (et lu) de ces expériences sans lendemains, ce qui explique qu’il soit de plus en plus difficile.
La troisième partie explore une partie du continent de la poésie de langue allemande : quelques 120 pages sont réservées à ce domaine… Plus précisément, le titre de cette séquence est : « Six poètes germanophones européens », six poètes qui ont choisi d’écrire en allemand alors qu’ils sont nés dans un autre pays européen. De l’essai introductif de Bernard Banoun et d’Aurélie Maurin, il faut retenir ces mots : « … c’est dans les frontières de pays européens de langue allemande que vivent des écrivains étant passés à l’allemand » (p 150). De 1985 à 2016, le Prix Chamisso (du nom d’un noble français qui émigra en 1792 et qui passa à l’allemand tant par ses poèmes que par un conte justement célèbre, La Merveilleuse Histoire de Peter Schlemil ) récompensa de tels écrivains mais il s’arrêta en 2016 pour la raison qu’il s’agirait là de marquer comme étrangers ces auteurs… Essai fort intéressant au demeurant.
Pour Maja Haderlap les choses sont simples : écrire en allemand permet au slovène d’exister par la traduction de la langue de Goethe. On est loin de la revue poétique croate Le Pont (qui exista dans les années 60-70, au siècle dernier), encore que les traductions en anglais, en allemand, en français et en italien étaient nombreuses. C’est le problème des langues minoritaires qui est ainsi posé. Haderlap s’interroge : «une langue sait-elle tirer une autre à soi / ou seulement la repousser ?» (p 163). Mais en même temps, elle interpelle le lecteur, seul capable de comprendre. Cependant les autres poètes ne manquent pas de poser des questions révélant le passage d’une langue à une autre, avec mine de rien, des contradictions internes clairement exprimées. Aurélie Maurin ne manque pas de remarquer qu’elle s’est fait aider par Christophe Manon qui ne parle pas un traître mot d’allemand ! À l’opposé des poètes écrivant en vers qui maîtrisent l’allemand et souvent la langue de la minorité à laquelle ils appartiennent : c’est révélateur de ces moments de suspension où la langue hésite. C’est passionnant, jusqu’au bilinguisme de José F.A. Oliver (p 219-220) !
La partie suivante est intitulée Contrepoints : des praticiens des beaux-arts passent au crible de la langue leurs productions respectives ; fragments d’entretien pour Claudine Griffoul (à propos de son travail plastique), comment passer du monotype au discours, de l’eau forte au texte, de la linogravure au poème ? Hugues Absil commente par des estampes, aussi les poèmes de Katia Sofia Hakim. De cette confrontation naît du sens qui doit beaucoup à l’exégèse de Laurent Fourcaut.
La séquence qui suit consiste en commentaires dûs à Catherine Fromilhague de plusieurs poèmes de Paul de Roux : réinscription dans l’histoire de la poésie, le commentaire du premier poème m’a paru très savant, décryptage de la métrique du poème pour le deuxième… Voilà qui prouve que parler de la poésie est un vrai travail. Catherine Fromilhague, très attentive, signe de véritables essais au déroulé du poème de Paul de Roux dans lesquels elle met en lumière les caractéristiques de cette poésie…
La livraison se termine par trois séquences : Échos qui donne à lire un essai de Christian Doumet qui est par ailleurs membre du comité de rédaction de Place de La Sorbonne, essai consacré aux rapports entre poésie et politique ; De l’autre côté du miroir qui regroupe des hommages rendus à des poètes lors de leur disparition et enfin Comptes-rendus & Livres reçus où l’on retrouve de multiples signatures dont celle de Laurent Fourcaut qui est décidément infatigable.
Je n’aurai fait que survoler ce numéro d’une richesse insoupçonnable, manque seulement l’index des n° 1 à 6 de PLS pourtant annoncé en quatrième de couverture. Il fallait bien un mastic et le voilà !
*