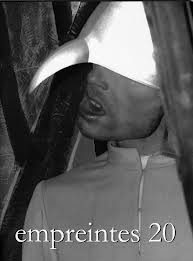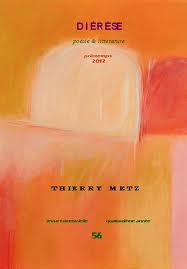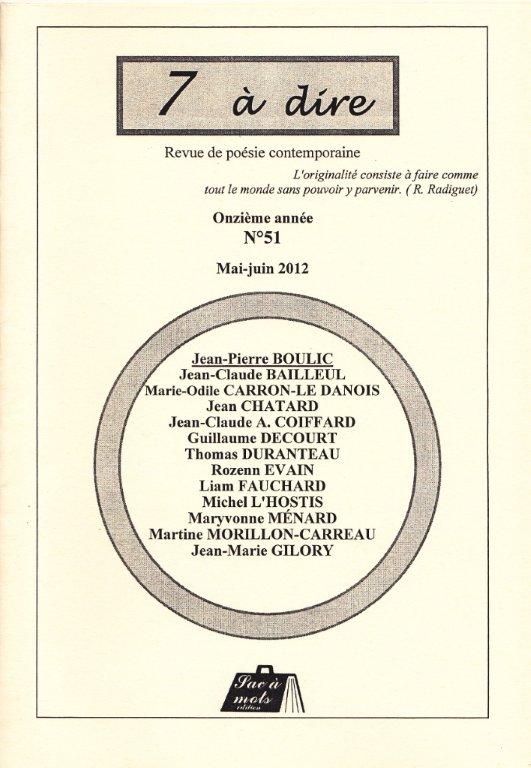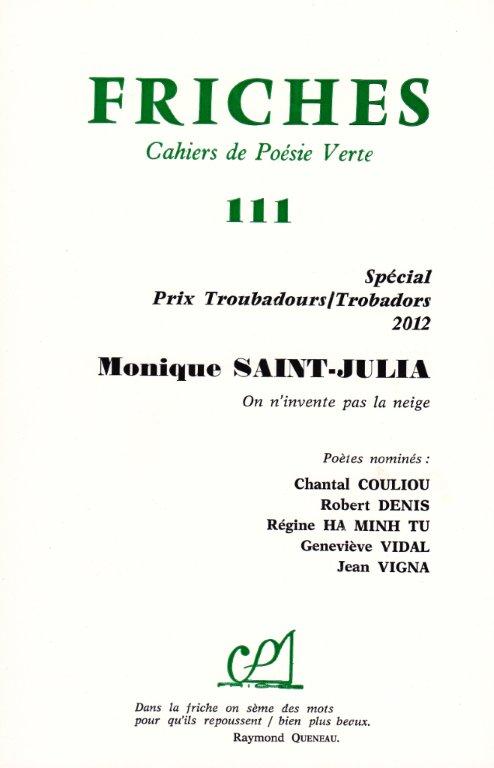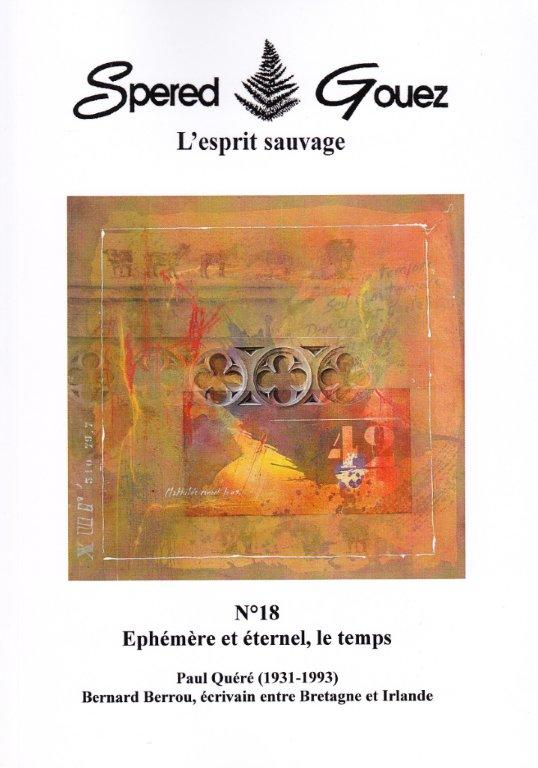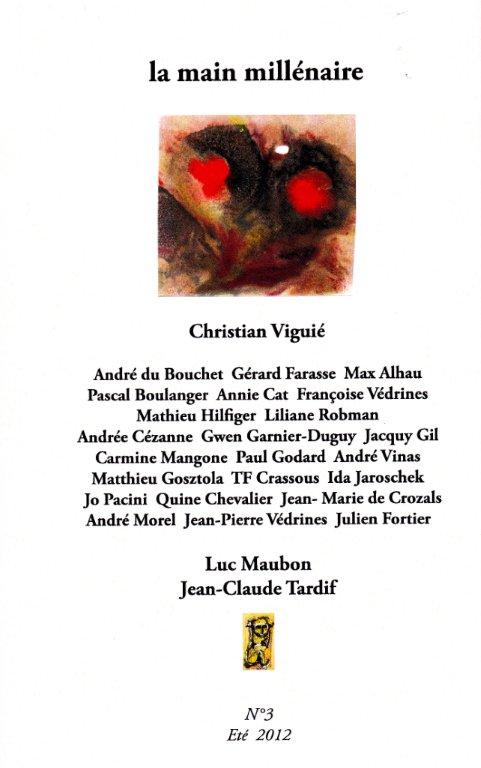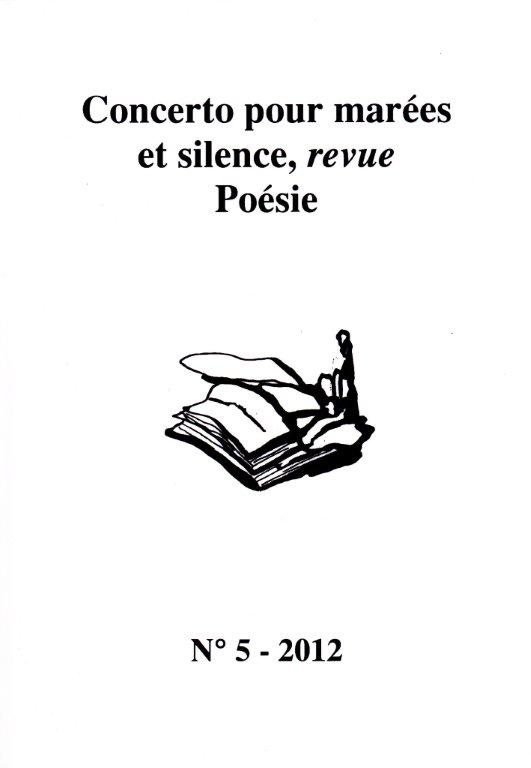LETTRES ROUMAINES n°1. 136 pages. Rédaction : éditions Non Lieu, 224, rue des Pyrénées, Paris 20.
Lettres Roumaines est une revue des plus atypiques. On ne peut s’y abonner, pas plus que l’on ne peut l’acheter : elle est gratuite ! On imagine, en lisant cela, qu’il s’agit d’une revue d’aspect négligé. Pas du tout, au contraire, la présentation est impeccable, au même titre que la mise en page. Imprimée sur papier glacé, la revue est richement illustrée par des gouaches et des acryliques, en pleine page et en couleurs, de Nicolae Paduraru, peintre d’une cosmogonie onirique d’êtres hybrides. Coordonnée par Petre Raileanu et coéditée par les éditions Non Lieu et par Copyro (qui est une société de gestion des droits d’auteur, qui rassemble un grand nombre d’écrivains roumains), la revue Lettres Roumaines entend présenter des livres et des auteurs qui ne sont pas connus au-delà des frontières de la Roumanie. L’objectif de cette démarche est d’éveiller la curiosité des éditeurs français, de l’espace francophone et des lecteurs pour cette partie de l’Europe longtemps restée dans l’ombre, malgré ses liens jadis très étroits avec la France (la liaison intellectuelle et artistique Bucarest/Paris fut des plus importantes au XIXe siècle, comme dans la première partie du XXe siècle : Istrati, Enescu, Brancusi, Fondane, Brauner, Voronca, Sernet, Hérold, Ionesco en témoignent). Cinq auteurs sont ici présentés en plus du peintre Nicolae Paduraru. Les romanciers Iacob Florea, Radu Tuculescu, Dumitru Radu Popescu ; le poète Ioan Es. Pop qui, né en 1958 et auteur d’une œuvre importante a, nous dit-on, influencé la génération des années 90 ; l’essayiste Ioan Aurel Pop. Lettres Roumaines est assurément un beau projet ; une revue de qualité et de pure découverte pour le lecteur français.
***
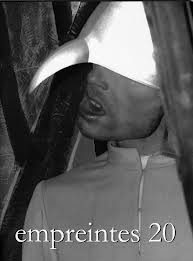
EMPREINTES n°20. 48 pages. 8 €. Abt (4 n°) : 30 €. Rédaction : 102, Boulevard de la Villette, 75019 Paris.
Ce n°20 n’échappe pas aux règles d’ouverture et d’originalité qui caractérisent la revue depuis ses débuts. 48 pages au format 21 x 28 cm. Papier glacé épais. Au sommaire, le Musée Jeanne d’Arc de Rouen, par Claude Brabant, les proses décadentes (1886) de Léo Trézenic, une présentation de la grotte (art brut) et de la maison de Jean-Michel Chesné, des proses et poèmes de Jean-Michel Maubert, Jean-Pierre Le Goff, Bernard Dumortier, des dessins étonnants de Guy Ferdinande, Tristan Félix, Jacques Touchet. Une revue atypique, inclassable, à découvrir absolument.
***
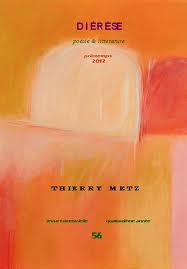
DIÉRÈSE n°56. 350 pages. 15 €. Abt (4 n°) : 38 €. Rédaction : 8, avenue Hoche, 77330 Ozoir-la-Ferrière.
Dans la « Chronique des revues » des HSE n°34 (2012), nous avons salué le numéro de référence, donné, sous la houlette d’Isabelle Lévesque, par Diérèse n°52/53, sur Thierry Metz. La boucle messine était-elle bouclée par ses quelque 328 pages ? Non et la revue de Daniel Martinez remet le couvert avec un deuxième numéro spécial, rassemblant les poèmes inédits de Thierry Metz, des textes d’Isabelle Lévesque, Pierre Dhainaut, Éric Dazzan, Didier Periz ou Christian Viguié. Un beau numéro enrichi par une belle iconographie, des témoignages et des entretiens. « Plus que tout autre », nous dit Daniel Martinez, « Thierry Metz aura su capter, à l’aune d’une existence rien moins que banale et dans les marges du quotidien, une mesure de l’absolu : au coeur, et au-delà des messages du monde, portant la braise à son bois. L’assise, et l’élan recherché, du regard aux signes, à leur transcription, ensemble nous fascinent. Sans jamais effacer donc la relation au référent, sa poésie saisit d’emblée la note juste. »
***

CHIENDENTS n°14. 36 pages. 4 €. Rédaction : 20, rue du Coudray, 44000 Nantes.
Chiendents est la nouvelle revue éditée par les éditions Petit Véhicule. Ce numéro est entièrement consacré au poète et dessinateur Jacques Basse qui, depuis dix ans, travaille sur une collection de portraits (d’écrivains, poètes…) au crayon, qui compte maintenant quelque quinze cents pièces. Six volumes de son travail, sous le titre de Visages de poésie, ont déjà paru aux éditions Rafael de Surtis, éditeur chez lequel Basse a également publié quatre livres de poèmes (« Une écriture fine, aérienne, ciselée dans la force de vie », nous dit Paul Sanda), dont récemment Échos et murmures (2012). « Chacun des tomes de Visages de poésie peut se lire comme une ouverture à l’univers complexe de la poésie vivante, bien plus instructive que certaines anthologies ou panoramas prétentieux », écrit Georges Cathalo.
***
COUP DE SOLEIL n°86. 40 pages. 7 € le numéro. Abt (3 n°) : 19 €. Rédaction : 12, avenue du Trésum, 74000 Annecy.
Des poètes et leurs inédits. À l’honneur dans ce numéro 86 : Lionel Ray (Te voici au plus noir de cette cave - Où tu brilles - Comme une rose inépuisable), Jacques Brossard (Le silence refait en pensée - Ce chemin qui le relie au bruit), Jean Chatard (La nuit raconte ses voiliers), Jean-Louis Bernard (Le vent trappeur pose ses collets), Jean-Louis Jacquier-Roux, Annie Salager, Valérie Canat de Chizy (Les sentiers mènent à des châteaux en ruine) et Jeanine Salesse (Nous nous touchons pour ne pas tomber). Suivent des notes de lecture et des chroniques, dont un beau portrait de Michel Dunand, le maître des lieux, par l’éditeur Jacques André, qui écrit : « Vous savez que le bonheur ne s’achète pas en parcelles numérotées sur la terre. Et si nous voulons rencontrer la plénitude, il faut aller à sa rencontre, de partout, et de toujours, car la félicité ne tombe toute rôtie que dans la bouche des imbéciles. Et c’est ainsi que vous gagnez le monde, dont vous nous rapportez quelques paillettes, comme autant de trésors ravis aux abysses de l’inconscient du monde. » Ces propos sont parfaitement justes. Pour le vérifier, il suffit de se reporter aux deux dernières plaquettes de Michel Dunand, Mourir d’aller (Jacques André éditeur, 2012) et Tunis ou Tunis (Berg édition, 2012). Le poète d’Annecy (ville où il dirige, non seulement la revue Coup de Soleil, mais également la Maison de la Poésie), Michel Dunand, qui se revendique poète de l’homme ordinaire (ce qui n’est évidemment pas pour nous déplaire aux HSE, les Poètes de l’émotivisme et de la Poésie pour vivre), écrit pour ne pas sombrer. Résister. Témoigner. Dunand nous dit aussi : Moi j’écris. Je lutte avec les mots. - Je me bats. - Mais je bâtis. Avec Mourir d’aller, le voyage est toujours de mise (l’Italie et Moscou, ici), mais le ton est peut-être plus grave qu’à l’accoutumée : je meurs d’aller, nous dit le poète. La mort revient entre les lignes, mais elle attendra, j’ai un cœur neuf, rétorque celui qui jette ses yeux - Pour voir - Mieux voir. La plaquette Tunis ou Tunis a la particularité d’être éditée en bilingue (arabe/français) et à Tunis (Tunis a tourné la page. - On béatifie les blindés). Un bel ensemble qui permet au poète de célébrer une fois de plus le désert (Le désert me devancera toujours. - J’admire éperdument - ce grand marcheur), mais aussi la ville, le pays qui a conquis sa liberté : On ne confisquera - jamais le langage. 6 Il poursuivra sa route.
***
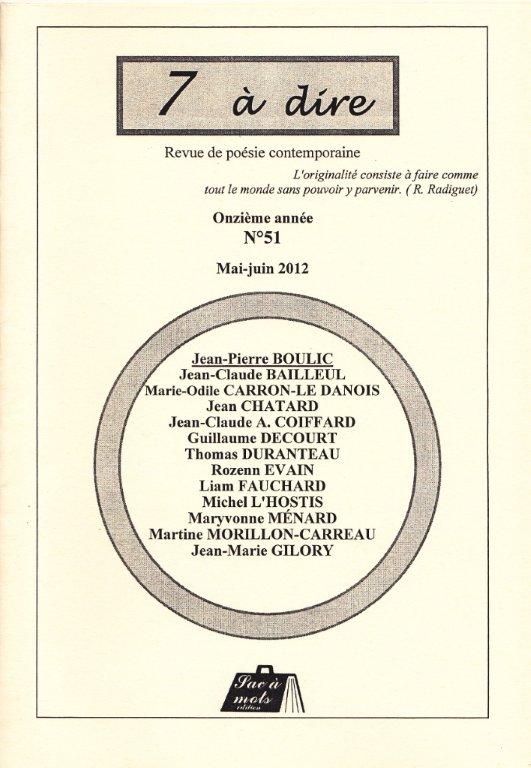
7 à dire n°53. 20 pages. 4 € le numéro. Abt (5 n°) : 18 €. Rédaction : La Sauvagerais, La Rotte des Bois, 44810 La Chevallerais.
Cette livraison s’ouvre sur un hommage à Henry Bauchau, décédé en septembre 2012 à l’âge de 99 ans ! Suivent des poèmes et des textes de Patrice Blanc, Jean Chatard, Gilles Lades, Danièle Corre. Jean-Marie Gilory donne une très belle note de lecture sur Mains d’ombre (LGR/HSE, 2012) d’Elodia Turki : « Or voici que resurgit ici le poème, en sa précise et vive langue de poésie. Dont notre revue sut orner ses pages au long de quatre numéros, égrenant une quinzaine de textes de haute tenue. Mains d’ombre est tiré de la mer de la mémoire qui n’arrête pas ses allers et venues de marées chez Elodia Turki. »
***
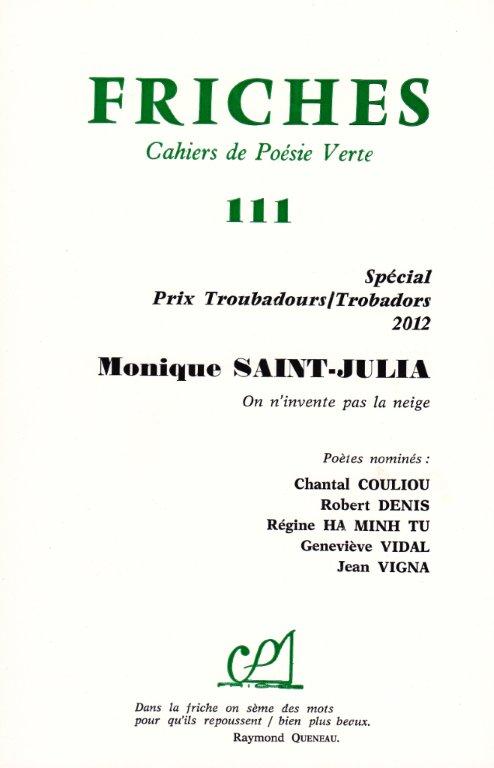
FRICHES n°111. 70 pages. 12 €. Abt (3 n°) : 25 €. Rédaction : Le Gravier de Glandon, 87500 Saint-Yriex.
Ce numéro est consacré au Prix Troubadours, qui est décerné tous les deux ans. La revue Friches édite le recueil du lauréat, en 2012, Monique Saint-Julia, avec On n’invente pas la neige. « J’écris pour retrouver une voix, une musique, le parfum de moût fermenté, sentir sous la main le sifflement de la rampe cirée, retrouver des prés fleuris de jonquilles », dit elle-même Monique Saint-Julia (auteur prolifique, qui publie également Regards croisés, éd. de l’Atlantique). Les autres nominés sont Chantal Couliou, Robert Denis, Régine Ha Minh Tu, Geneviève Vidal et Jean Vigna.
***
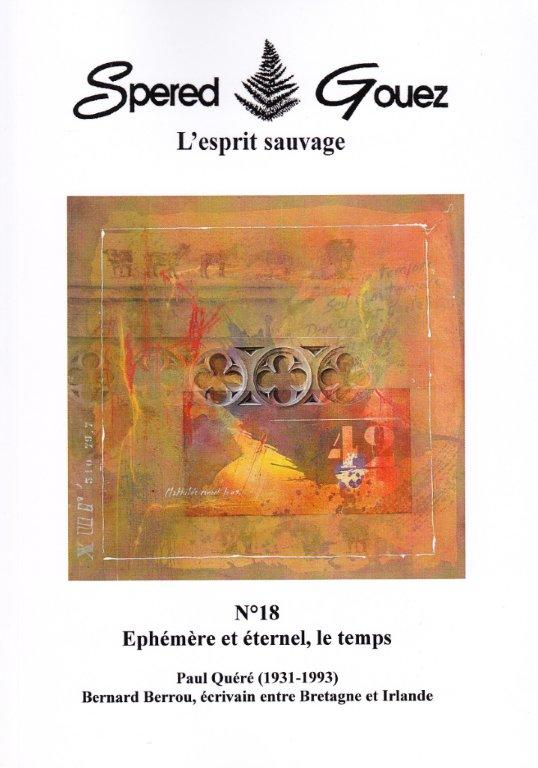
SPERED GOUEZ n°18. 164 pages. 15 €. Rédaction : Centre Culturel Breton Egin, 6, Place des Droits de l’Homme, BP 103, 29833 Carhaix Cedex.
Un numéro dense, avec de nombreuses chroniques et notes de lectures sur des revues et sur des livres. Le choix de poèmes du numéro est placé sur la bannière de « l’Éphémère et éternel, le temps ». Chaque instant contient sa perte - et tout ce qui précède, écrit Marilyse Leroux. Dans son éditorial, Marie-Josée Christien revient sur participation aux Rencontres de Lorient, sur le thème de l’engagement poétique. « Voilà bien longtemps, écrit-elle, que personne ne parlait plus de « littérature engagée ». Pourtant, entre les omniprésents donneurs de leçons d’hier et le silence sidéral des écrivains d’aujourd’hui, il y a place pour une parole discordante, courageuse, solidaire… L’engagement poétique, plus que jamais d’actualité, n’est bien sûr pas pour nous synonyme de poésie engagée. C’est la poésie elle-même qui est résistance et engagement. C’est elle qui fonde et dirige notre vie. » Comment ne pas donner raison à M.-J. Christien ?
***
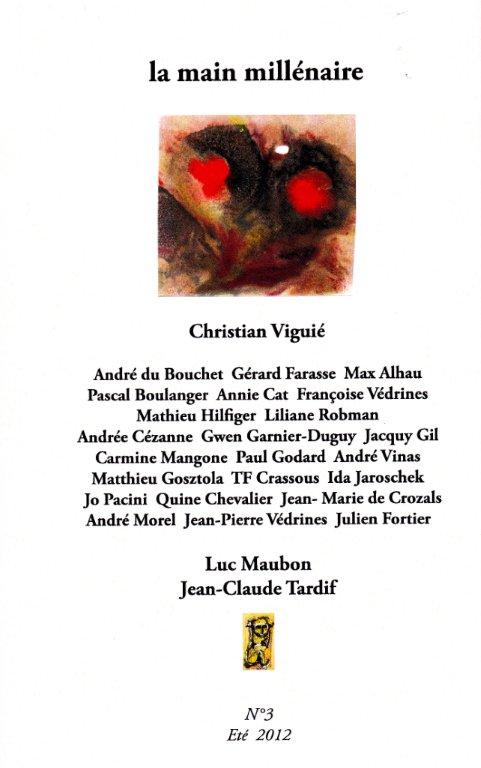
LA MAIN MILLÉNAIRE n°4. 148 pages.15 €. Abt (3 n°) : 36 €. Rédaction : 126, rue du Canneau, 34400 Lunel.
La main millénaire de Jean-Pierre Védrines fête sa première année d’existence. Une belle réussite. « Publier des auteurs qui ont du plaisir à écrire, qui ont le don du poème et l’ardeur de la vie ». La revue est demeurée fidèle à sa ligne éditoriale, tout au long de ses quatre premières livraisons. Un seul regret : le peu de pages consacrées à l’appareil critique. Au sein du numéro 3, nous avions particulièrement aimé, de Jean-Pierre Védrines lui-même, le long poème, « L’ombre », qui donnait assurément le la de cette fournée : La flamme avant l’incendie est le pressentiment de sa douleur. Ce numéro 4 tient ses promesses. Jean-Vincent Verdonnet et Jeanne Bessière (que je découvre) sont mis en avant. Le premier est loin d’être un inconnu. Quant à la deuxième, ce fut une découverte. Jeanne Bessière est pourtant née en 1929 et est l’auteur de treize recueils de poèmes : La nuit s’étale - tache d’encre inexplorée. Suivent de bons poèmes inédits de Claudine Bohi, Christophe Dauphin (La nuit s’allonge dans un galet - N’en sortent que les dents de la rage), Matthieu Baumier, André Prodhomme (je pris alors en main l’urgente alternative des poètes celle qui crie à chaque mot il faut changer le monde pour qu’enfin il devienne la poésie la vie), Patrick-Pierre Roux, Alain Piolot (écrire, c’est résister)… En fin de numéro : trois belles proses d’André Morel, J.-P. Védrines et Patricia Grare.
***
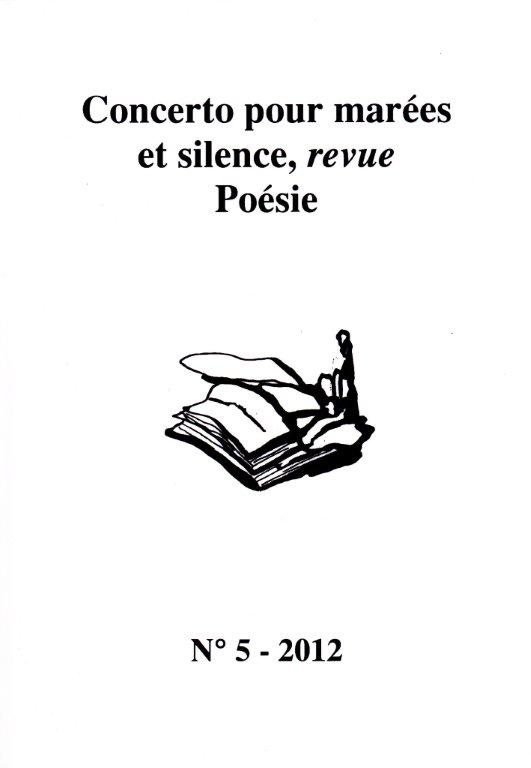
CONCERTO POUR MARÉES ET SILENCE n°5. 14 €. Rédaction : 164, rue des Pyrénées, 75020 Paris.
Concerto pour marées et silence est une revue annuelle axée sur la création poétique. Il n’y a pas de rubriques clairement identifiées au sein de Concerto pour marées et silence, mais trois mouvements : Moderato, Adagio et Allegro, au sein desquels cohabitent textes de création, articles et notes de lecture. Parmi les poètes, citons Patrice Blanc, Claudine Bohi, Bernard Fournier, Annie Le Gall, Danièle Corre ou Nicole Hardouin : Demande ton chemin aux bourgeons - ils viennent de si loin. Pour la partie critique : une belle évocation de Serge Brindeau par son épouse Paule, ainsi qu’entre autres, une note de lecture fouillée de Gérard Cléry sur Mireille Fargier-Caruso. Cette belle partition est orchestrée et dirigée, depuis 2008, par Colette Klein, infatigable animatrice de la scène poétique, mais aussi et surtout poète de talent : Les paysages déversés par le rêve ne connaissent jamais le nom du dormeur (in La neige, sur la mer…, La Bartavelle, 1997).
***
INTRANQU’ÎLLITÉS n°1. 200 pages. 20 €. Rédaction : passagersdesvents@gmail.com.
« Ne vous fiez pas à l’île, qui saute aux yeux comme une proposition de soleil, de clichés de sables fins. On est souvent conduit à percevoir l’île comme un territoire replié sur ses bornes, où il suffirait de pivoter sur un pied pour en faire le tour. Le préfixe In dans IntranQu’îllités pourrait même renvoyer à la négation de l’insularité. Ce titre est une manière, une astuce pour apostropher tous les imaginaires du monde, pour pénétrer les interstices et naviguer dans l’air/ère d’une île-monde », écrit James Noël. IntranQu’îllités, revue littéraire et artistique haïtienne, élaborée par James Noël (poète) et Pascale Monnin (plasticienne), est une émanation de l’association Passagers des Vents, première structure de résidence artistique et littéraire en Haïti. Revue littéraire et artistique, IntranQu’îllittés fait la part belle aux imaginaires du monde en rassemblant dans son premier numéro une quarantaine de contributions avec des participants comme Ananda Devi, Charles Dobzynski, René Depestre, Valérie Marin La Meslée, Francis Combes, Sébastien Jean, Hubbert Haddad, Sergine André, Makenzy Orcel, José Manuel Fajardo, Michel Le Bris, Dany Laferrière, Mario Benjamin, Paul Harry Laurent, Patrick Chamoiseau, Marvin Victor, Thélyson Orélien, Frankétienne. La revue se propose d’être une boîte noire qui capte et rassemble les mouvements, les vibrations et autres intranquillités créatrices. Déconstruire les frontières, faire tomber les murs visibles et invisibles par le biais de l’imaginaire. Rendre compte de la beauté du monde envers (en vers) et contre tout, à travers les mots et toutes autres formes d’expressions artistiques de notre temps, tel est le but fixé par toutes ces voix intranquilles qui fourmillent ce beau rêve. Au-delà des frontières le plus souvent artificielles entre les disciplines de la création, seule compte à nos yeux la poétique, meilleure paire de lunettes pour regarder le monde !
***