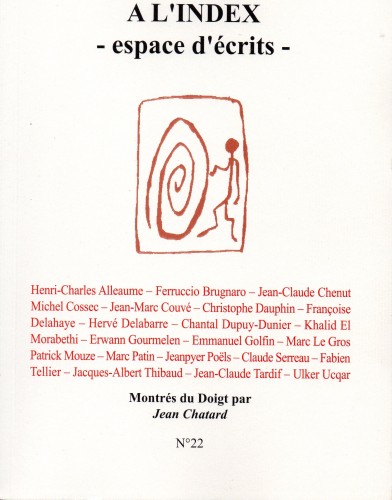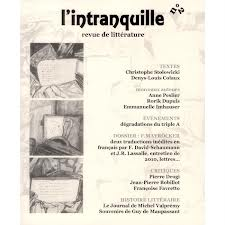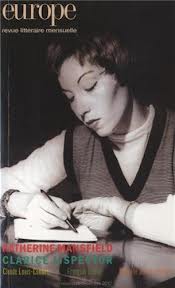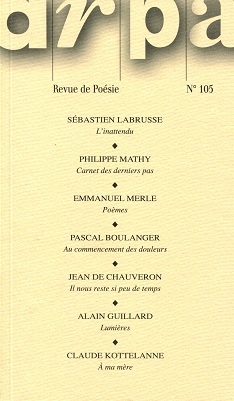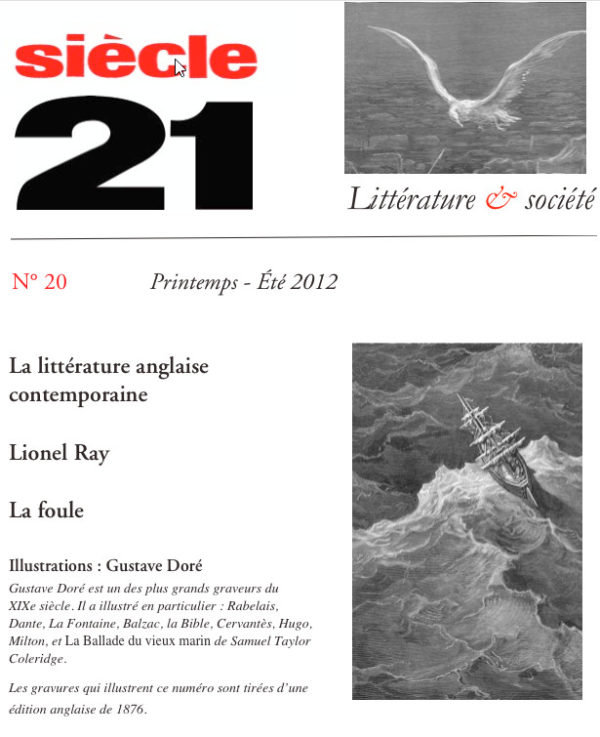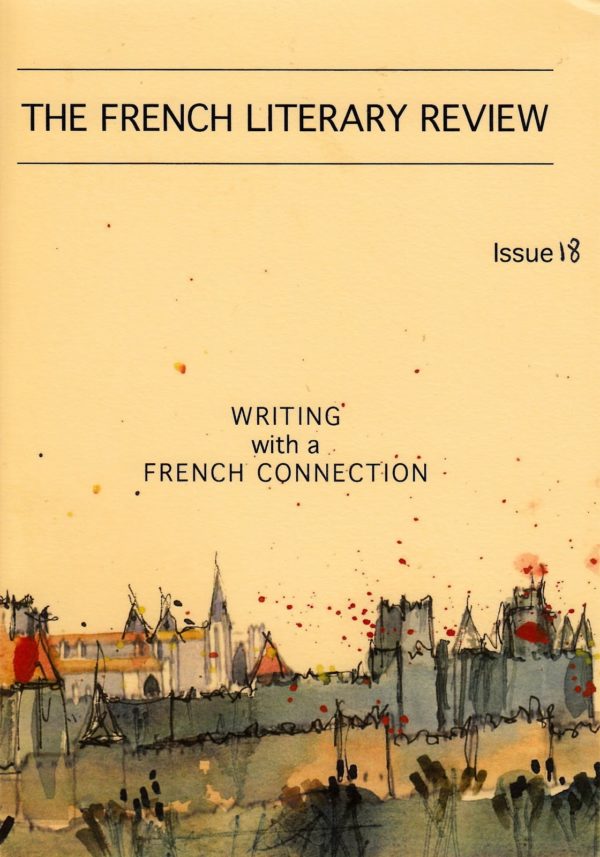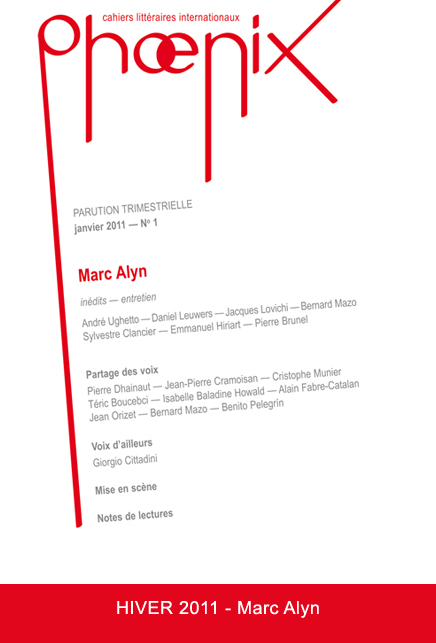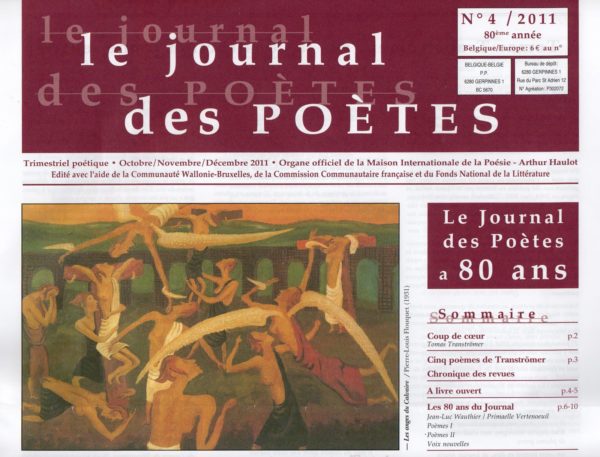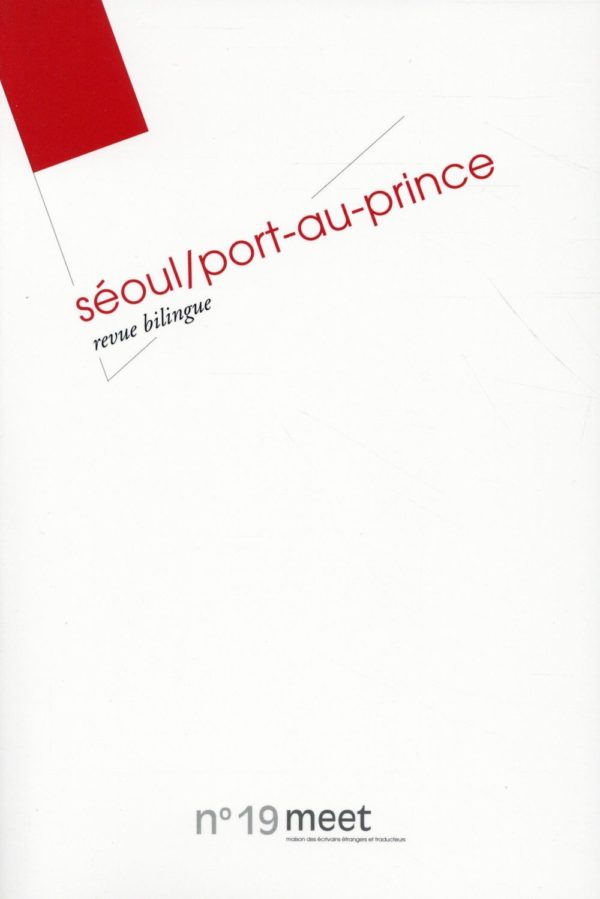La revue TRACES N° 176 fête en janvier 2013 ses 50 ans d’existence
Claude Serreau ouvre ce numéro 176 ; pour ceux qui ne connaîtraient pas l’histoire de la revue , l’ami , le collaborateur ,le compagnon en poésie de Michel-François Lavaur depuis un demi siècle ,s’en fait l’historien. Pour lui, MFL est : « celui qui a réussi à faire d’une revue artisanale un document essentiel et un témoignage sans égal pour qui veut et qui voudra connaître ce que fut en France et en particulier dans l’Ouest, au cours des cinquante dernières années, une vie au service de la Poésie. »(p. 5), ce que confirme Jean-Claude Vallejo à la fin de ce numéro : « Traces est un cas unique, et je suis convaincu, d’accord avec le poète et éditeur Bruno Doucey, avec qui j’ai eu l’occasion d’en parler, alors qu’il dirigeait encore la maison Seghers, qu’il n’est pas pensable pour nous d’occulter la contribution de la revue Traces et de MFL à ce demi siècle de la vie poétique française. »(p.72)
En page 7 l’article de presse annonçant en janvier 1963 la sortie d’une nouvelle revue de poésie Traces , montre que déjà en ce numéro 1, Claude Serreau, Pierre Autize, Jean Bouhier, Georges Drano, Gilles Fournel, Jean Laroche et James Sacré avaient répondu à l’appel ; avec de tels poètes, cette revue commençait sous de très bons auspices.
Le poète Hamich Tibouchi offre aujourd’hui à Michel –François Lavaur un très beau poème pour toutes les traces remplies de vie (p. 14)
Une lettre de Alain Lebeau retient l’attention, touche au cœur, elle trace le chemin qui mène à l’ami quand les souvenirs ensoleillent l’automne, quand la vie a passé et que les gestes se font plus lents mais que forts d’une vie de poésie et d’amitié, on peut se parler en silence…
Georges Cathalo offre un bouquet de vœux, retenons celui-là : « J’aurais voulu retrouver les milliers de lettres et de courriers divers que MFL a offerts à ses amis et à ses correspondants afin de composer un monument épistolaire. » (p.21)
Michel-François Lavaur, le poète, le dessinateur, le revuiste est aussi un mail artiste.
« Jour de fête , comme chez Jacques Tati, celui où l’on recevait une lettre de Lavaur(…) ces enveloppes singulières, dont les formats et les papiers inattendus s’ornaient de dessins et de textes à la fantaisie colorée, humoristique, ludique, parfois aussi mélancolique. » Martine Morillon Carreau (p.40)
« J’ai eu l’immense joie, avec ses réponses, de découvrir le mail art. Un vrai cadeau que de recevoir ces enveloppes travaillées, illustrées, ornées, calligraphiées, jouant aussi avec les couleurs des nombreux timbres… » Jean –Claude Vallejo (p.71)
Odile Caradec qualifie de saint laïque celui qui a consacré une grande partie de sa vie à la poésie, dans un esprit total de gratuité et de fraternité.
Qu’est-ce que la poésie ? À la définition que donne Patrice Angibaud pour qui la poésie est prière, MFL répond : « tu me dis, et je te le concède, que le poème est une prière. C’est vrai , si prier c’est ouvrir nos portes secrètes au visiteur étranger qui vient avec franchise ; si prier c’est se dépasser pour déboucher sur l’autre et non s’en remettre à quelque dieu, voire à un démon, pour éponger nos appétits de privilèges, ici-bas ou dans un monde posthume ; si c’est chercher la communication au plus intime de nos êtres, sous la carapace d’attitudes et de manigances que la hiérarchie et le qu’en dira-t-on imposent, peu ou prou, même aux plus rebelles à leur joug(…) mais que jamais l’écrit ne soit ce monument de « mastuvu » sur notre vanité. » (p.46).
Parole de vérité que celle du poète, reçue il y a 40 ans , Patrice Angibaud nous la donne aujourd’hui à méditer car elle garde toute son actualité… « En cet aujourd’hui où les mots sont vidés de leur sens ; en cet aujourd’hui où l’attention à l’autre est de moins en moins une préoccupation ; en cet aujourd’hui où seuls comptent le chacun pour soi, l’apparence et le clinquant. »( P.Angibaud)(p.46)
Pascale Lavaur nous offre un texte émouvant qui nous dit le maître d’école et surtout le père qu’il fut, hommage plein de tendresse filiale : « Ma maison est l’école et mon père est le maître d’école… »
Eric Simon fait revivre la soirée du 24 février 2009 au café de la Rotonde à Nantes où il avait invité MFL : « et je garde en mémoire comme un précieux joyau ce poème entendu en occitan de la bouche même de Michel-François Lavaur, le timbre de la voix et l’accent restaurant l’expression vibrante de chaque syllabe, dans sa valeur de sens et d’émotion. La Rotonde, ce soir-là, s’éclairait d’une lumière persistante, celle de la bonne étoile. »(p.62)
Ce N° 176 est aux couleurs de l’amitié et de l’affection, il est un cadeau pour les lecteurs, avec lui en ce début d’année 2013 la poésie brille haut et loin.
Pour conclure cette présentation, un extrait du poème de Jean Dif qui dit si bien cette fraternité poétique qui a animé cette revue, elle explique sans doute sa longévité et elle a fait de Michel-François Lavaur un passeur en poésie qui laissera durablement son empreinte dans le paysage poétique de la deuxième moitié du XXème siècle.
« Comme un facteur choisissait
sur le chemin des cailloux
pour son palais des merveilles
patiemment dans ta fourbithèque
pendant près d’un demi siècle
tu as noué et renoué
la longue chaîne des poètes
venus de tous les horizons
qui se lisant les uns les autres
se reconnaissent sans se connaître
(…)
mais voici que le temps s’en vient
et de nous rassembler à nouveau
pour un dernier feu d’artifice… »
………………………………………………………………………………..
De nombreux poèmes à découvrir, la plupart inédits de : Claude Serreau, Martine Morillon- Carreau, Hamid Tibouchi, Guy Chaty, Claude Cailleau,Roland Halbert, Emmanuel Hiriart,Gilles Lades, Bernard Le Blavec, Jean Dif, Didier Cléro, Michel L‘Hostis, Bernard Picavet, Michel Baglin, Jean-Pierre Mestas, Jacques Simonomis, René Cailletaud, Hugues Pissaro, Gérard Prémel, Jean-Claude Coiffard, Jean-Pierre Poupas,Jean-Pierre Poëls,Rüdiger Fischer,Amédée Guillemot , Jean-Claude Touzeil,Moreau du Mans, Norbert Lelubre, Robert Momeux, Jean Laroche, Dagadès et Michel-François Lavaur.
Des illustrations de : Hugues Pissaro, Hamid Tibouchi, Gérard Sendrey, Claudine Goux, Krystel Lavaur, Pierre-Marie Eades, et Michel-François Lavaur.