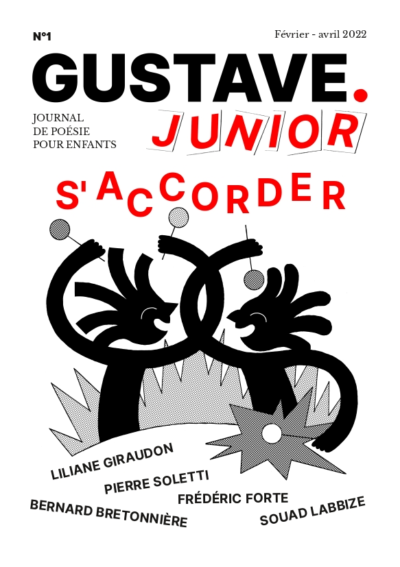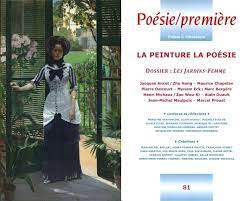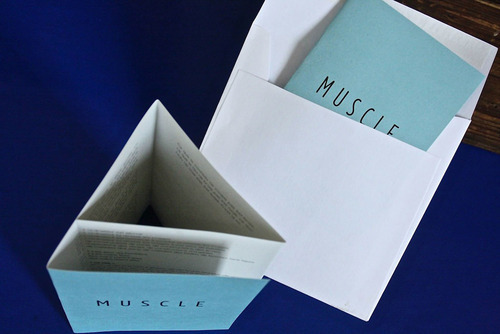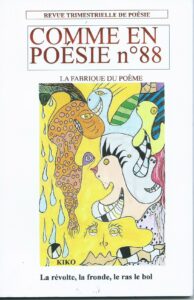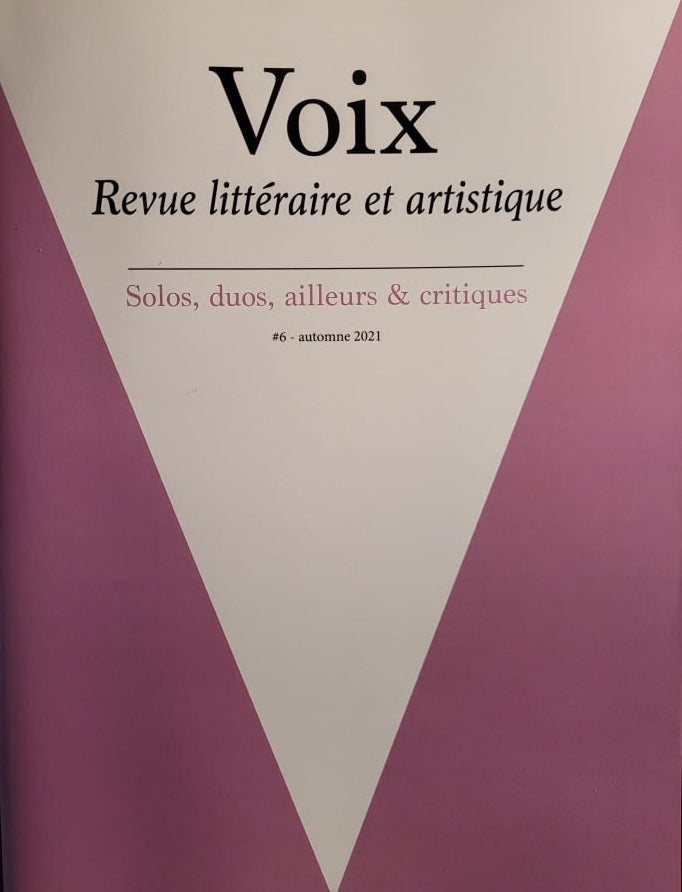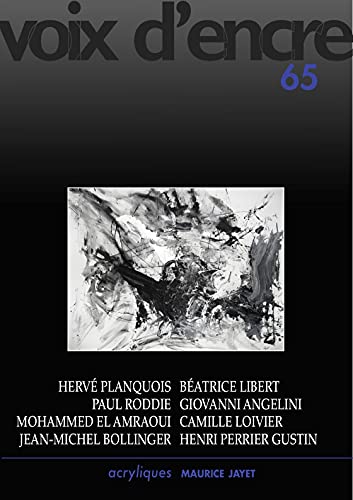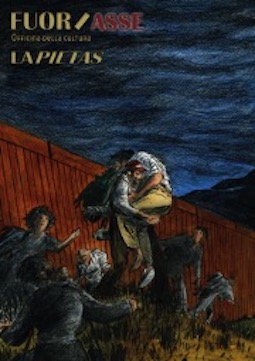Possibles N°23, revue de littérature
La revue de littérature Possibles, fondée et dirigée par Pierre Perrin, entame un renouveau. Elle abandonne la virtualité de la toile pour renaître, trimestriellement, sous forme de livre d’encre et de papier.
Créée en 1975, ses numéros, successivement ronéotés puis imprimés paraissent pendant 40 ans. Puis, à partir de 2015, ils sont publiés en ligne. Le concept : consécration, révélation, re-visitation, recommandation. Quatre auteurs sont présentés chaque mois au fil des soixante-deux numéros. Au total ce sont trois cents poètes qui figurent dans Possibles depuis sa création.
Mais d’où vient ce titre « Possibles » ? La réponse de Pierre Perrin nous est donnée dans la quatrième de couverture : « Le titre Possibles signifie que chaque poète proposé existe à la mesure de votre plaisir de lecture. »
Dans ce numéro, le plaisir est à la hauteur des poètes choisis, poètes qui, pour reprendre l’expression de Pierre Perrin, « redescendent de l’internet au bon livre ». En effet, leurs poèmes sont parus en ligne entre octobre 2015 et février 2021.
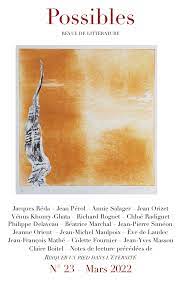
Possibles, revue de littérature, N°23 - Mars 2022, 120 pages, 15€.
On peut y lire Jacques Réda, Jean Pérol, Annie Salager, Jean Orizet, Vénus Khoury-Ghata, Richard Rognet, Chloé Radiguet, Philippe Delaveau, Béatrice Marchal, Jean-Pierre Siméon, Jeanne Orient, Jean-Michel Maulpoix, Ève de Laudec, Jean-François Mathé, Colette Fournier, Jean-Yves Masson et Claire Boitel.Leurs poèmes, en vers et en prose, nous parlent de séparation, d’absence, de vieillissement, d’amour, de mort, de vie avec la mort, d’éternité. La quinzaine de notes de lecture — écrites par Pierre Perrin le plus souvent et sur les auteurs présents dans ce numéro — est introduite par Risquer un pied dans l’éternité, dédié à Jeanne Orient (extrait d’une conférence donnée en 2003).
Dans Risquer un pied dans l’éternité il est question du pouvoir de l’écrivain, capable « d’ouvrir grand les portes de la prison », mais aussi de la nécessité pour lui de publier et d’être reconnu par ses pairs, de ses mille raisons d’écrire, l’acte d’écriture étant « une communication où l’on change moins autrui qu’on ne se transforme soi-même », de la façon dont il écrit : « l’écrivain apparait inspiré quand les mots attendus sont ceux qu’il n’attend pas », dans la voix d’encre de son monologue, l’écriture éclaire son âme dans sa solitude car l’écriture participe à la spiritualité « il n’est pas question d’être dieu, ni d’encens, encore moins de gourou ; il s’agit d’une marche vers une lumière qui grandit en soi-même ».
Un cheminement, une quête qui habite tout poète, et qu’illustrent parfaitement ces mots de Béatrice Marchal (page 47) : « – Il arrive que les mots permettent de construire des demeures – demeures de mots animées par la joie, éclairées par l’être, ouvertes à l’esprit, qui abritent la vie nécessaire à la plénitude recherchée.»1
Note
- Béatrice Marchal, Un jour enfin l’accès, suivi de Progression jusqu’au cœur, L’herbe qui tremble, 2018.