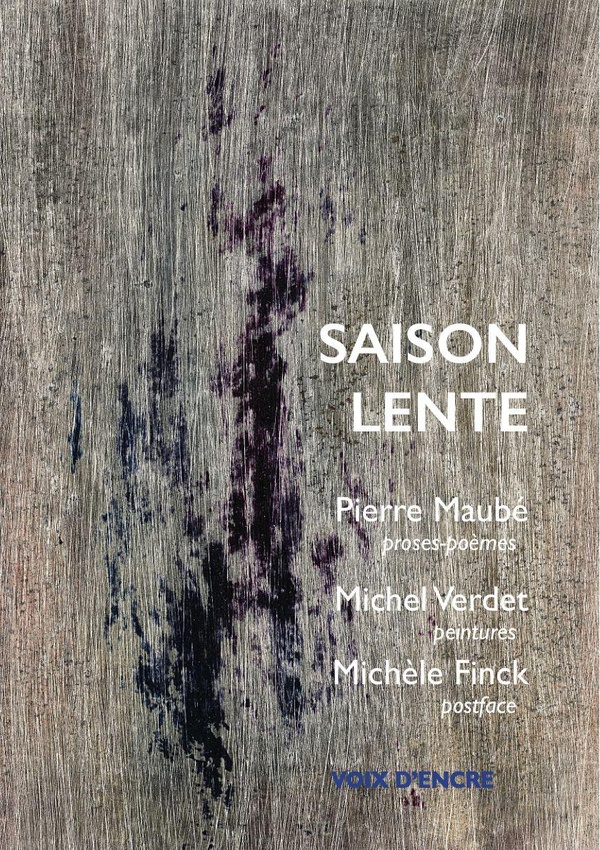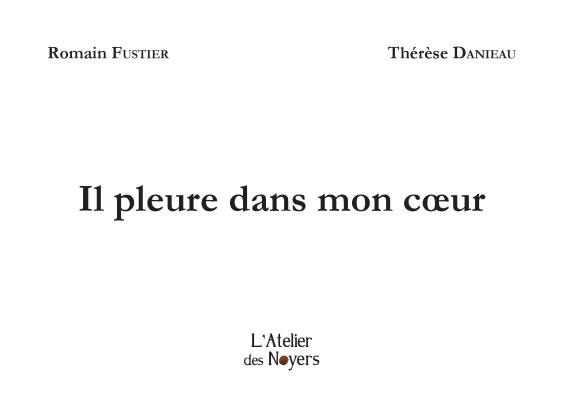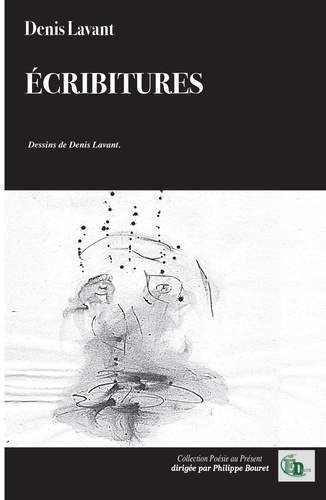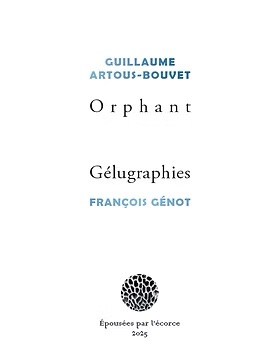Aux éditions Inclinaison : Daniel Becque, Bénédicte Niquège
Une visite d’été à Uzès a permis de découvrir, à l’angle de la rue du Docteur Blanchard, dans le quartier « médiéval », la librairie et maison d’édition Inclinaison, et de converser un moment avec son libraire-éditeur, entre autres choses de la Bretagne et de ses chemins côtiers, et bien sûr de la poésie. Sa collection « Cordes tissées » a maintenant bien dépassé la dizaine de titres, et proposes de petits fascicules, légers, plus hauts que larges et couleur ivoire, d’une trentaine, quarantaine, parfois cinquantaine de pages. Elle édite une poésie vivante et non-compassée, une poésie maitrisée mais sincère, sensible, musicale, réfléchie, d’auteurs variés dans leur existence comme dans leur inspiration. La parité hommes / femmes y est à peu près totale, et même rythmique (un homme, une femme, un homme, une femme) et contribue à la variété des voix et des sensibilités, pour qui feuillette les opus, rangés sur leur modeste table, derrière la porte d’entrée de la librairie. Le prix, modeste et uniforme de 3 euros par volume (une seule exception), inscrit aussi la disponibilité poétique dans une démarche où le souci monétaire passe résolument à l’arrière-plan. Les factures de poésie, elles, sont tour à tour ingénieuses ou intimes, mais toujours justes. La disponibilité poétique du langage s’y montre dans une agréable variété, qui ne va pas, toutefois, jusqu’à l’hétéroclite, et l’on est tenté de penser que c’est aussi l’ensemble éditorial (pour l’instant suffisamment modeste pour être embrassé d’un seul regard) qui fait « œuvre », œuvre d’éditeur. Pour un peu, l’ensemble mériterait d’être thésaurisé d’un coup. On a cependant sélectionné ce jour-là deux volumes, qu’on attire à l’attention du lecteur de Recours ; ils ne sont pas les plus récents, mais ont paru d’une qualité particulière, que le « plus tard » d’une autre lecture n’a pas démenti, ni le suivant : le n° 6, À la Saint-Nestor, et Autres invocations roborantes, (2010), de Daniel Becque, et le n° 8, F (x), (2010), de Bénédicte Niquège.
*
Le premier pratique cette poésie des choses vues, ressenties et jugées, « journal politique et intime du temps présent », pourrait-on dire, héritière du Vigny d’« adieu, voyages lents » (et de bien d’autres en vérité), où le vers, long et libre, généralement, mais rythmé, dit l’ironie, le dégoût, la tristesse, mais aussi la nostalgie (« Nous n’allions pas à la pêche ce jour-là, car à la Saint-Nestor / Rien ne mord se plaisait à dire mon père »), l’acuité du regard sur le monde, la révolte, l’idéal ou le sens du meilleur.
L’hybride de tramway et de métro qui s’ébranle du centre de Rouen / Et rejoint la lisière de ce qui reste / De la forêt de Rouvray où autrefois sur les grands chemins / Bandits et coupe-jarrets guettaient pèlerins et diligences / Où aujourd’hui quelques bâtiments universitaires / Grelottent sous un crachin discret encore que peu bienveillant / L’hybride aux faubourgs disais-je fait arrêt à la station Ernest Renan / Quartier nouveau de modeste et respectable tenue d’où branche (d’arbre) / À l’oblique une rue Antonin Artaud et l’on commence ici dans ce quartier / Si paisible et si peu propice au effusions révoltées du poète / À se demander comment ces deux-là cohabitent dans leurs patronymes (…)
*
La seconde, qui sait ?, plus pascalienne, semble suivre la tradition mathématicienne (qui sait : roubo-queneausienne ?) qui combine l’interrogation sur l’x identitaire, la profondeur métaphysique du sujet numéral, l’angoisse de l’identité charnelle décharnée par le nombre, et le « jeu », celui des calculateurs, mais aussi celui de nos bons rhétoriqueurs, qui, de Guillaume de Machaut à Pernette du Guillet au moins, ont enchanté le formalisme et l’ont pensé comme chant. Jeu-chant, Chant-jeu, permanence de l’impermanence et rire ludique de l’angoissante condition : Bénédicte Niquège est manifestement dans cette tradition.
Port Sort Mors Fort / Corps. / Joie Poids Moi Loi / Roi. / Vie Gît Puits Luit / Rit. / Le sire pèse son sort. / Le sort pèse sa vie. / La joie gît au port. / Le poids quitte son lit, / mort. / Morte. / Mors. / Morse. / COURSE : / l’Amour cours. / (…)
Parfois plus romantique, parfois plus « flesh », ironique et charnelle… Mais toujours avec un écho caractéristique des 15e-16e-voire début 17e siècles en ligne de basse, au détour lexical, par exemple d’un « non prévoir » :
Un nœud battant l’alvéole. / La tête, bille d’assaut, coincée entre le je donne et le je retire. / Zone floue dévalée de non prévoirs, / Cercle où les choses vieillissent sans changer d’âge : / trop proches pour détourner la joue, / trop incertaines pour offrir la bouche.
*
Autre lecture d’été : les petites pièces du théâtre poétique de Catherine Gil Alcala, aux Éditions de la Maison Brûlée, qui sont entre Jarry, Beckett et les farces, soties grotesques et satires allégoriques du moyen-âge. Les deux volumes de 2015, La Tragédie de l’Âne, suivie de Les Farces Philosophiques et James Joyce Fuit … Lorsque un Homme Sait Tout à Coup Quelque Chose, suivi de Les Bavardages sur la Muraille de Chine proposent une poétique tonique, vivante et scénique, qui se situe entre logorrhée-jeux de mots et ironie farcesque, érotico-scatologique, éructante, mais portant toujours la marque des angoisses intimes de la condition humaine et des violences faites au présent, féminin ou pas.
ANTONIN ARTAUD — La concierge soulève ses mamelles de louve, imitant un souffle d’abjecte nativité.
LA CONCIERGE — J’aurais dû être chanteuse mais j’ai épousé mon mari, cet idiot ! Il l’a fait tout de suite un enfant et à l’accouchement ça m’a ligaturé les cordes vocales ! (James Joyce Fuit… p. 41)
Le sujet parlant, syrien, peut-être, parisien, joycien, qu’importe, de Catherine Gil Alcala, est l’universel violenté. Il peut lasser, in extenso, mais comme le réel des souffrances, il est à prendre comme tel, corps et langage martyrisés, saignants, coulants, se déversant ; pas si loin non plus des gueuloirs flaubertiens, mais version vomie, brute, avant le cisellement « bourgeois » que le fracas des guerres (de 14 et d’après) ne permettra plus :
Commotions d’émois, se cogne aux femmes glacées derrière les vitres intransparentes, s’agrippe à l’espace vide, s’appuie sur des façades s’effondrant en un fracas de rire, faciès de mascarades des villes de cinéma sous les bombe ! (…)
Dans le sas d’ombre des abris mentaux des nuits, dans le vertige des pénombres orageuses, titube enivré des ténèbres, aspirant l’air pluvieux, buvant le tord-boyaux crépusculaire, se mouvant dans le tâtonnement des ombres, glissant dans les doigts mouillés des frondaisons. S’enfonce, s’effondre dans un rectal tunnel de rats, se réfugie prostré, empoissé, bossu des trombes, grelottant… (James Joyce Fuit… p. 12–13).
*
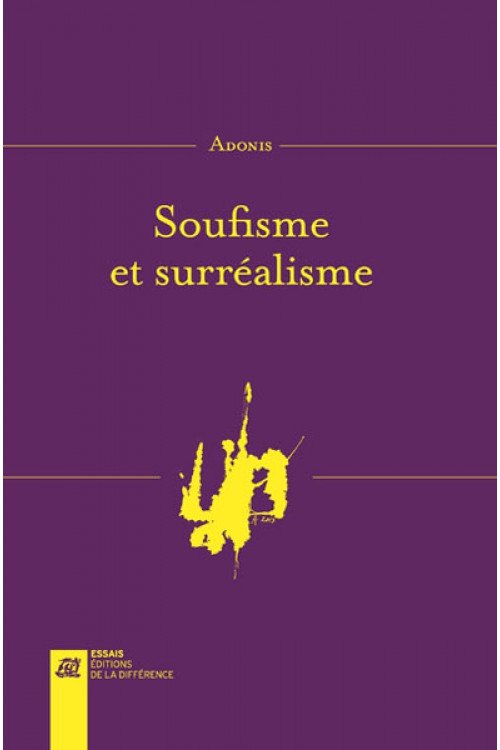
Dernière lecture, plus théorique, qui conviendra aux plages de temps de l’automne comme elle a convenu à certaines plages d’ombres pensives de cet été, en étrange mais URGENT contraste avec ses violences d’églises et de bords de mer : le livre d’Adonis sur Soufisme et surréalisme (La Différence, 2016), traduction française (enfin !) d’un livre paru en arabe sous le même titre en 1995 (c’est-à-dire, si l’on se souvient bien, quatre ou cinq ans après la première Guerre du Golfe) et encore en 2005. Après les violences hallucinantes de la Première Guerre Mondiale, le Surréalisme de Breton rompt en visière avec la Raison triomphante et son verbiage intoxiquant et mortifère. Il part à la recherche d’un sur-réel plus heureux, inversant la dialectique hypocrite du dit/caché en dialectique merveilleuse du caché/dit. Libérant ostentatoirement l’imaginaire, il pratique l’écriture automatique, etc. : ainsi « les surréalistes connurent, par la pratique, des moments d’extase semblables à ceux que les soufis ont rapportés dans de nombreux ouvrages » (p. 48). Le soufisme, de même, en un sens, libère la pensée des carcans autoritaires de la raison démonstrative ; se présentant comme une mystique heureuse du dieu caché et de la vérité occulte, il cultive l’accès à l’inaccessible. Pensée libre (et souvent persécutée), pensée libératrice, le soufisme a des points communs avec l’approche surréaliste du sens. Adonis ne pousse pas jusqu’à une illusoire volonté de superposer exactement les deux pensées, mais il montre les implications ressemblantes sur les plans éthiques et esthétiques (la connaissance, l’imagination, l’amour, l’écriture, l’image, la création, l’affirmation de la vérité). Niffarî et Rimbaud se rejoignent, grâce à Adonis, dans une poétique générale de « l’invisible visible » qui, ayant pour garantie l’indicible de l’être, se propose aussi en talisman contre les dogmatismes.
Car « à mesure que la vision s’élargit, l’expression se rétrécit », dit Niffarî.
…Pour peu que sérénité et humilité s’en mêlent, cependant, se dira-t-on ! Car l’exaltation visionnaire n’a la propre mesure de son humilité interprétative, face à l’Absolu, que si la conscience de l’in-savoir l’emporte sur la jouissance malheureuse d’affirmer.
Ce livre (pas toujours facile, il est vrai) contribuera à la jouissance heureuse de comprendre, plutôt qu’à celle d’affirmer.