De mots… à vous (11) : Gabrielle Althen, LA CAVALIÈRE INDEMNE
Ce livre s’ouvre sur l’urgence d’une invocation : « réapprendre la vie sauve, la violente, l’alarmante vie sauve ! » (p. 9). Un cri sort de la gorge d’une femme qui est de retour, et qui, après bien des guerres, continue à chevaucher vie et parole sauves, toujours attelée à sa quête de lumière. Elle a émergé des combats qu’elle a menés, et même si elle y a laissé des plumes, « indemne » elle reste pourtant, soit intègre, entière, intacte et fière, car elle (l’) écrit. Cette victoire fort émouvante rappelle la « renaissance » chantée par René Char au sortir d’une maladie grave, au début de Lettera amorosa : sa joie, son retour aux plaisirs charnels. René Char dont Gabrielle Althen cite deux vers en exergue à son texte « Le printemps » justement : « Du vide inguérissable surgit l’événement / et son buvard magique » (p. 15). Et la voix de la poète leur fait écho : « je me disais qu’une vie qu’approuve une caresse est plus grande que la montagne » (p. 48). Elle raconte les « vagues [qui] se dénouaient », le « triomphe sur la guerre, triomphe sur la nuit intestine et son paquet d’entrailles, triomphe sur nos peurs consanguines, duplice est le fond de la mer, triomphe sur le fond de la mer ! » (p. 14).
Les cavalières ont de tout temps enflammé l’imagination car elles respirent la désinvolture, l’indépendance et l’audace, mais aussi l’étrangeté, la solitude : tous les ingrédients de la liberté de pensée et d’agir propres à celles (et ceux) qui vivent en poètes. Leur langue suprême est celle de la poésie. La « cavalière indemne » est une femme d’action et de rébellion, une poète en puissance car une poète en vie. La rescapée est rentrée, elle raconte. Elle raconte car elle a vécu, sans séparer la tristesse de la vie, et la vie de la poésie : « La vie est là. La vie est toujours là, et nous rebâtissons nos palissades, sans bien savoir que nous habitons le cercle de son œil » (p. 57).
Au sein de ces textes lyriques sont évoquées diverses luttes contre la vie : contre la peur de vivre, contre la douleur de vivre, l’absence d’enfance (« vous dont fut mordue l’enfance », p. 23 ; « l’ensemble avait lieu, faute d’amour, sur une route dure où manquait une enfance », p. 51), l’absence de sens, la pauvreté (matérielle et spirituelle), la perte d’espoir, « le cœur cassé » (p. 69). Ce n’est qu’en vivant – et en aimant – que le cœur peut se briser. Ainsi, l’écriture vient à la cavalière, car l’écriture se vit. Et la poète de citer les mots suivants du Psaume 129 : « Tant ils m’ont traqué dès ma jeunesse / ils n’ont pas eu le dessus » (p. 23). Cavalière indemne, qui doit la vie et la parole sauves à la poésie, et c’est pourquoi Gabrielle Althen nous livre un texte exigeant, sibyllin, qui appelle à la réflexion, à la méditation. Comme tout texte qui renferme un secret, il ne se livre pas d’emblée, sans être hermétique pour autant. Ses mots de divine tristesse étoilent la nuit noire d’un « ciel vide de chimères » (p. 21), éclairant le mystère humain, que Gabrielle Althen, en tant que poète qui recherche l’humanité, persiste à sonder, pour se souvenir de ce que c’est, que d’être humaine.
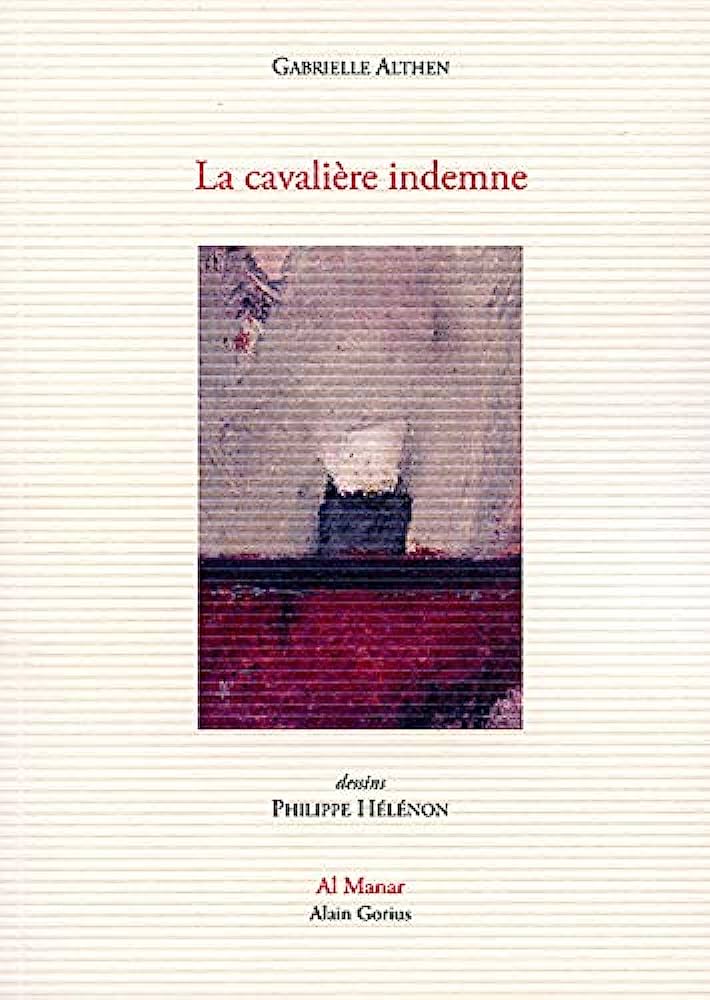
Gabrielle Althen, La Cavalière indemne, Al Manar, 2015, 86 pages, 16 €.
Élégance, finesse, souplesse d’une prose poétique qui révèle en même temps qu’elle déroule, sa colonne vertébrale de langue de « funambule entre l’avers et le revers de l’émotion » (p. 33), et de « danse à l’étincelle de chaque pas » (p. 33). Effets d’échos qui scandent la réflexion, invitent en douceur à la prolonger – à « s’inviter de durer » (p. 36) – sur une langue qui émeut car elle sait toucher « au front » (p. 35), avec ses images qui s’y ouvrent comme des fenêtres, sur « le feu de chaque jour » (p. 53), que la poète nous fait rechercher, aimer.
Des échos, des ondes, pour la fluidité d’une langue qui à la fois trace des chemins et se faufile dans ses rais de lumière. Une langue qui résonne avec les préoccupations de tous ceux qui écrivent, car il me semble que La Cavalière indemne porte sur l’écriture, plus précisément sur la parole poétique. « Bâtir n’est pas un geste simple » (p. 61) : quel est le mystère de l’écriture ? Gabrielle Althen pose la question ainsi : « Que veut me dire mon sang ? Je le demande du fond de ma poitrine. Je le demande à mes tempes qui battent. Nulle réponse qui convienne. [...] j’apporte ma truelle et mes mains, avec un peu de ma mémoire, pour y bâtir – qui sait ? – moi aussi un hangar pour le ciel » (p. 60). Cette magnifique dernière phrase fait du ciel un avion, de l’écriture un abri ; et elle n’est pas sans nous rappeler le travail de bâtisseur de René Char. Maurice Blanchot en avait parlé en ces termes : « Sa poésie est révélation de la poésie, poésie de la poésie et, [...] poème de l’essence du poème » (La Part du feu, 1949).
À la page 39, il y a ces phrases, que l’on pourait interpréter comme déplorant une certaine défaillance en poésie : « Il faut noter que, malgré la sincérité de son envie de pleurer, ses pleurs, comme lui, sont vacants. Le vent passe au travers, mais leur confie pourtant le son de ses volutes. L’homme, qui paraît n’en rien savoir, se blesse parfois au front sur le bord du premier miroir où il s’enferme ». Cependant, la voix qui énonce cela pardonne car elle « retiendra qu’il y a des offrandes » (p. 39). Et la voix de continuer sa méditation – « Si tu revêts une robe de mots pâles sans laisser place à ton silence, à quoi penseras-tu ? » (p. 40) – en suggérant que rien ne vaut, en poésie, ce qui nous effraie le plus : « la parole nue » (p. 40), qui « dans un sens, ira jusqu’au silence et dans l’autre, jusqu’à un visage autrefois vu de près » (p. 41), celle qui « fore dans l’hiver des tunnels où manquent des étoiles » (p. 42), et qui recueille « ce qui palpite » (p. 44). La parole poétique serait la « proximité du désastre, fin du caprice, dépaysement de l’idée, – vois-tu, mes mains ouvertes sont sans prises, mais la parole les regarde, asquiescement sans point d’étreinte, auréole sans effort, avec des ors flexibles comme d’absolues promenades » (p. 63).
Gabrielle Althen est de ces vrais poètes pour qui l’écriture est une affaire de voyage, de parcours, avec et dans la parole : ses textes révèlent le monde tout en montrant l’élaboration de la langue employée à le représenter, et à en raviver les couleurs. Il se produit donc une double exposition, comme en photographie, puisque sont juxtaposés ou associés des sujets et des niveaux de réflexion différents pour créer une image unique et encore plus chargée de sens, telle que celle-ci, magnifique : « Il y a simplement que se taire ouvre une cathédrale » (p. 13).