Éric Brogniet, Le nuage et la rivière
Glissés entre des pages de neige, le nuage et la rivière d’Éric Brogniet
Le nuage et la rivière, deux éléments du monde, avec pour cadre le silence dans ce bord à bord avec l’infini comme un surcroît de présence : « Il n’est de livre sans blessure / Neige l’hiver, neige la vie ». Dans l’œuvre d’Éric Brogniet, le maximum d’appropriation est constitué par le maximum de dépropriation : « Il faudra donc se dénuder à l’os ». Le texte, « Le poème aux lèvres/ Nues » prend totalement sens lorsqu’on comprend, en un seul mouvement, les termes de réversion comme un « inaudible cri » dans l’échange des qualités opposées : « la brûlure et la glace ».
« La détresse et la clarté » évoquent paradoxalement une harmonie dans une tenue réciproque des contraires entre dehors et dedans : « Le paysage est à l’intérieur / De qui le regarde ». La montée en puissance ne se fait plus linéairement mais dans la courbe qu’implique l’équilibre des forces en tension : « Et la lucidité de ses décombres », intersectant deux mouvements recourbés contraires d’une logique dichotomique reprenant la phrase nervalienne : « La nuit est blanche et noire ». La force du poème rend possible l’échange, le vertige : « Un silence est-il aveu ou désaveu / Ou peut-être un simple vacillement / entre l’un et l’autre ? ». Cette démarche s’impose alors dans l’évidence immédiate d’une seule tenue, d’un même souffle : « Parce qu’il n’est nulle issue / Où l’on puisse dire / C’est ceci ou cela ».
Dans cet art poétique où le poète parlant « avec des lèvres de verre / Avec les mains du givre », doit pourtant laisser une trace et écrire « sur la neige le récit de [sa] vie », paraît la facilité parfaite de l’esprit poétique au plus haut du difficile, tout proche et difficile à saisir. « Mystère » que met également en exergue Éric Brogniet : « A chacun son énigme », son mystère, sa part d’ombre, et « sa part claire » qui constitue aussi « la réponse » : « Être […] / Et ne pas être n’est pas une option ». Le poème d’Éric Brogniet dans ce va-et-vient oxymorique manifeste une présence énigmatique, écliptique, comme un clin ou un battement, présence qui déroute toujours de nouveau le sens, la situation, la substance.
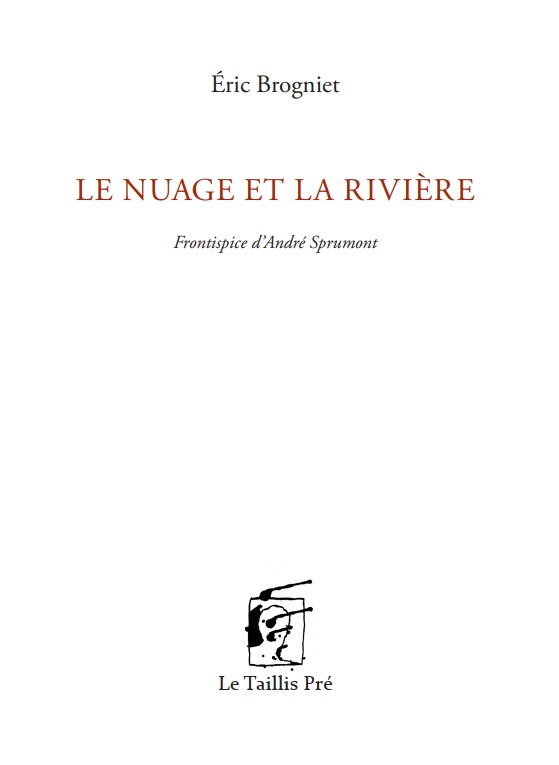
Éric Brogniet, Le nuage et la rivière, La Taillis Pré, 2025.
Telle est l’exigence nécessaire, propre à cette poésie. Elle ne se donne qu’à côté d’elle-même, soudain et toujours de nouveau. Le poème est arrachement mais aussi rencontre, par un double mouvement, un rythme tout à la fois de séparation et de réconciliation, la poésie n’étant possible que dans la déchirure même et la nostalgie qu’elle induit comme un contrepoint nécessaire à la création d’un cristal de rythme : « Ni le cœur la clarté d’un cristal ». La poésie, c’est la vie, la question forant la question, la rencontre avec une couleur, des instants de merveille : « La rose est dans la rose ».
Quelque chose passe entre les bords du poème, des événements éclatent, des phénomènes fulgurent, la splendide apparition est constituée d’un air plus léger : « Ce qui vous traverse / Vous élève/ Vous allège ». Le soleil et un « bleu silence » créent la sublimité : « Ce qui en l’homme / Indique le sublime et la hauteur ». Malgré le petit univers souffrant de l’homme « son aptitude à se pourrir la vie », il reste, la surprise, la création, la soudaineté absolue : « La danse éblouie de l’univers », l’être étant l’unique événement où les événements communiquent. Comment ne pas reconnaître ce monde qui se donne à voir comblant comme une offrande le champ du regard : « Le saule sous la neige / Calligraphie / Du silence ». Voici la pulsation désirante l’être : « Ce fut sous le signe du soleil / Dans un jardin aux multiples charmes / Vertu des plus lointaines magies ». Ici, s’ouvre la possibilité d’une révolution poétique, venue sur des pattes de colombe. Et ce sont lignes nécessaires que ces retours aux événements fondateurs et aux origines du monde, là où se bâtissaient les montagnes et se dessinait la course des fleuves. Là où, portés par la poésie, nous rencontrerons la belle image du ciel et du fleuve « engendreurs de nuages ».
Le poète doit lier, transmettre l’éclair, restaurer le nuage de consonance, rapprocher l’infini et les hommes, devenir l’accord qui comme Empédocle défait et renouvelle le monde, « épargner », au sens de Rilke, de l’humain et du divin. La neige, la transparence, la lumière, le cristal. Chute de neige, chute de signes. « Rose noire » posée sur la neige. Poudre sur le paysage. Gaze de givre sur les branches. Dans le poème, on écoute tomber la neige qui ne fait aucun bruit, on sourit au silence qui s’épaissit, au ciel qui se vide de sa nuit, à la terre qui redevient blanche. La blancheur du papier évoque la neige, l’encre est elle aussi comme une nuit blanche qui vous attend. Il s’agit alors de créer la neige, de faire neiger sur le papier « laisse vierge la page », de tenter de saisir par des signes l’insaisissable de la neige, et de la page. Pourtant si la neige est bien de ce monde ci, elle est aussi autre chose, elle reste l’énigme, elle demeure le nom d’autre chose comme l’ouverture d’une dimension autre.
La neige constitue cet art poétique du retrait : « Ne rien écrire sur la neige », suggérant l’inscription d’une absence. L’écriture insaisissable de la neige reste de l’ordre de la retenue, du dessaisissement et d’une langue qui se dérobe constituée par des traces et des effacements. Le geste de l’écrivain est geste de distanciation, de dessaisissement, de retrait. Désormais la nudité est dénuement comme vœu de pauvreté « Sans craindre la neige ajoutée à la neige », comme voie de pauvreté. La poésie, elle, se décline dans un dessaisir de brasier blanc et de neige. Le monde est tiré vers le blanc confondant la fin et le commencement. La poétique d’Éric Brogniet, est celle du fragile, de l’intouché qui forment une image de l’infini. La profusion du blanc, vite devenue l’idée d’une fuite ou d’un envol, enjoint de saisir avant que tout n’échappe, se contrastant de l’impression d’un noli tangere de neige. Le désir, l’impossibilité, de toucher la merveille laissent chance à la fragilité car le poète « a eu le temps d’imprimer leur filigrane sur la page ».