Fabien Abrassart, Si je t’oublie
Quels que soient les lieux traversés par ce livre, quelle que soit l’implication de l’être humain, Si je t’oublie, se prolonge par un espoir et même une joie dans la chaleur de la précarité de l’existence. Recueil, poèmes ne sont jamais clos par la mort. Poèmes au parler dur, tranché, il y a une saccade des mots qui ne s’accommodepas de l’hypocrisie. Sous la langue, un parler net qui ne fait pas de concession.
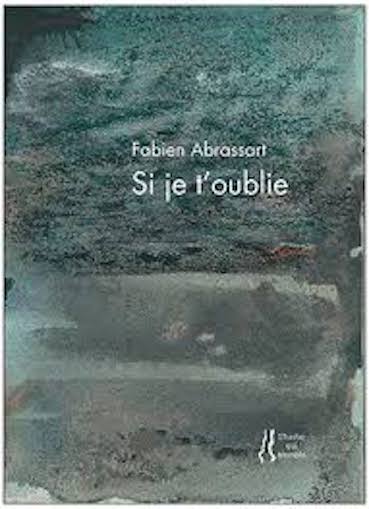
Fabien Abrassart, Si je t’oublie, Editions L’herbe qui tremble Préface de Philippe Lekeuche, Peintures de Marie Alloy.
L’hyperbate y est souvent présente qui déjoue le sens ordinaire des mots pour nous renvoyer à plus de force, plus de précision aussi. Des images se mêlent, s’interpénètrent, se rassemblent, voire se bousculant et se heurtant dans l’espace du texte que la pensée a décousu, obligeant le lecteur à établir des raccords pour assurer de nouvelles connections. Doutes et incertitudes surgissent non sans une certaine tendresse qui tourne le tragique en ridicule pour mieux le supporter. Peut-être, y a-t-il un léger ricanement pour fuir le dégoût et ne pas soulever la douleur.
Jérusalem, Auschwitz sont deux pôles entre lesquels les poèmes se concentrent. Les mots à rouvrir des situations se brûlent au réel et ne rachètent rien : « Il s’agit bien plutôt de ne pas oublier qu’on est humain » nous dit dans la préface Philippe Lekeuche. On sent une colère rentrée, les mots font barrage et disent en même temps d’ici à là le toujours possible. La langue dans sa structure ordinaire est insuffisante à rendre le réel. Il y a un monde qui se trouble sous la plume de Fabien Abrassart, puis qui revient à lui, un échange entre la rêverie et le réel, le soutenable et l’insoutenable. L’auteur recherche une langue mieux adaptée à ce qui est à dire, mais introuvable par l’impossibilité de ramener l’événement à son exactitude qui sans cesse se dérobe à l’entendement. La raison bascule, les mots ne parviennent plus à s’exprimer. Emotion et raison se mêlent inextricablement sans partage possible, rendant aux poèmes une tension, une gravité, un poids qui nous touchent sans nous permettre de crier. Nous sommes quelque part prisonniers du système. L’individu en tant que chance n’y a pas cours. C’est au vif de l’être que se mesure la souffrance : Nous avons le mal de naître, nous en sommes la victime à repousser la mort.
Poésie d’un univers étrange où malgré le dire, quelque chose reste incommunicable comme enfoui dans une profondeur personnelle qui reste néanmoins collective à celui qui sait. Chemins tantôt tortueux, tantôt évidents, nous continuons d’aller entre des titres évocateurs d’un monde bien concret et sécurisant dont on a parfois l’impression qu’il se cherche entre les répétitions et s’acharne à relever l’impossible : masquer le réel. Du monde ordinaire, nous basculons vite dans l’horreur dissimulée sous les mots qui ne font jamais directement violence, mais suggèrent le pire au passé comme au futur. Malgré la Jérusalem céleste, il n’y a pas de rachat possible : avec quel fil recoudre/c’est impossible un poème d’amour/cela n’encre plus depuis. Que faire ? je vous parle et puis non rature. Dire n’a plus de sens devant certains faits, la parole ne coïncide plus, elle n’est même plus une représentation, mais une chose de trop. Elle réclame le silence de la méditation, une autre langue qui ne soit pas l’ordinaire, un recours malgré tout à la poésie comme seul lieu habitable dans l’inhabitable, comme une constatation et un désir : tendre ta parole/vers l’autre évaporé dans la brute. Si je t’oublie, nous reste-il quelques espoirs à reculer la mort de quelques poèmes. Le poème d’amour peut-il surmonter l’horreur et le dégoût. Dans le dédale des mots, le poème s’obscurcit, mais l’image veille et réactualise le réel dans un sursaut d’énergie que cachait l’ordinaire de certains noms écrits sans majuscule :auschwitz. Poésie qui ne se laisse pas éparpiller mais se recentre pour se reconcentrer vers le même point, la même obsession de l’humain dénaturé. Il y a une obstination qui refuse de refermer les faits et nous les rend par hallucinations mentales intolérables. Il y a une sublimation du concret vers l’abstrait. Voilà ce qui donne à ce recueil, lisibilité et acceptation parce qu’il devient objet du dedans, objet de maîtrise. Fabien Abrassart rend le mur à son écho, les faits retournent à la parole exclusive, au sol par raclement et par mémoire. Face à nous-mêmes, le questionnement rappelle un danger toujours présent. Nulle lueur cependant par ce blanc maquillé, nous sommes bien seuls, chacun avec ce recueil entre les mains. N’oublions pas la belle préface de Philippe Lekeuche, qui avec simplicité, éclaire ce recueil rempli d’érudition et de sagesse. Les peintures de Marie Alloy sont discrètes dans leur force à signifier l’horrible dans presque rien, presque un effacement qui en fait un profond présent, une suggestion plus forte que l’évidence. Me reste face à ce recueil, le sentiment d’avoir si peu dit : présence présente et qui échappe par sa densité.
« Penser un monde où l’unité de mesure ne serait plus le groupe identitaire, avec toute sa malfaisance, mais, enfin, l’individu »
Stéphane Sangral